Dernière mise à jour : 24/11/2021
Carbone, tout le monde n’a plus que ce mot à la bouche. Pointé du doigt comme le mal du moment – dérèglement climatique oblige – on en oublierait presque que nous en sommes composés. Il faudrait ne plus en émettre, le transformer ou encore le stocker – on ne veut plus le voir pointer le bout de son nez. Et le sujet est brûlant en agriculture. C’est à la fois un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi celui qui aurait le potentiel de stockage de carbone principal dans son plus simple apparat, le sol. Triste paradoxe d’ailleurs, l’atmosphère contient trop de carbone alors que le sol, lui, en manque.
Les outils de mesure, les modèles et les méthodes de suivi du carbone se développent. Les labels et cadres de certifications apparaissent. Un marché du carbone se met en place. Nous nous concentrerons ici bien évidemment sur l’agriculture mais nous nous permettrons quelques digressions sur le secteur forestier. Source de motivation ou d’inspiration pour certains et d’inquiétudes pour d’autres, le sujet du carbone ne fait pas l’unanimité. Il n’en reste pas moins que la thématique est passionnante. Entre défenseurs du climat, avocats de l’agriculture, et opportunistes, le carbone a de quoi faire tourner la tête.
Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens téléphoniques avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.
PS : Je donne toujours un prisme numérique à mes articles puisque je travaille dans le domaine des outils numériques appliqués à l’agriculture. Vous le retrouverez également ici, mais dans une moins grande mesure que sur d’autres articles que j’ai pu écrire par le passé.
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee
Repères juridiques – Lois et réglementations
Le dérèglement climatique à l’œuvre ne fait plus aucun doute. Les terribles épisodes de gel constatés en France au début du mois d’avril passé et la destruction de la quasi totalité du village de Lytton en Colombie Britannique par les flammes à la fin juin auront certainement convaincu les derniers sceptiques. Le GIEC (Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) et autres instances internationales ne cessent de le marteler à coups de rapports toujours plus alarmants. On ne compte plus les objectifs, protocoles, accords et stratégies mis en place au cours des dernières années pour orienter les trajectoires internationales et nationales vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qui sait d’ailleurs vraiment où l’on en est ? Il y en a eu tellement qu’il est difficile de s’y retrouver. Quelques repères ne pourront pas faire de mal. Cette partie n’est pas très sexy mais elle aura le mérite de reposer les politiques climatiques et d’introduire certains acronymes dont nous aurons besoin par la suite. Nous rediscuterons des mécanismes, quotas d’émission, et marchés carbone associés à tout ça un peu plus loin dans cet article. Promis, on va très bientôt parler d’agriculture.
A l’échelle internationale, c’est la convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) qui lance la donne en 1992 (elle sera adoptée en 1994). Signée au sommet de la Terre à Rio par près de 190 pays, la convention se fixe comme objectif principal de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (induite par l’homme) dangereuse du système climatique ». Même si l’ambition proposée était très louable, il faut avouer que le cadre restait encore assez flou. La convention a eu néanmoins le grand mérite de mettre en avant la responsabilité des pays industrialisés dans le dérèglement climatique, et de pousser ces pays à montrer la voie en faisant le maximum pour réduire les émissions sur leur territoire. Ce n’est que quelques années plus tard, en 1997, que le protocole de Kyoto finit de clarifier les obligations de limitation et de réduction d’émissions juridiquement contraignantes des pays industrialisés. Sur la première période d’application du protocole de Kyoto (2008-2012), les pays industrialisés signataires de ce protocole – pays dits de « l’Annexe I » – se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’en moyenne 5%. Les autres pays signataires, mais non industrialisés, dits pays « hors Annexe I », quant à eux, ne se sont engagés sur aucune réduction d’émissions de manière à pouvoir continuer à se développer. Le lecteur attentif aura noté le temps nécessaire entre la signature du protocole de Kyoto et sa première période d’application. Une deuxième période d’application du protocole (2013-2020), le protocole de Kyoto II, fixera comme objectif commun aux pays signataires un objectif de réduction de 20% de leurs émissions à horizon 2020 par rapport à l’année de référence 1990. Ce prolongement du protocole de Kyoto I sera conclu de justesse au sommet climatique de Doha en 2012, les précédentes COP et sommets climatiques, notamment le sommet de Copenhague de 2009, n’ayant pas réussi à aboutir à un consensus. A noter que certains pays signataires du premier protocole de Kyoto s’étaient désengagés entre temps du second… Le protocole de Kyoto s’est arrêté en 2020 ! Il a laissé sa place à l’Accord de Paris, signé en 2015 lors de la COP21, et qui a pris son application le 1er janvier 2021. Jugé historique, l’Accord de Paris est le résultat d’une entente commune entre ses signataires sur l’importance de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius, de préférence à 1.5, par rapport au niveau préindustriel. L’Accord de Paris reste néanmoins un accord, sans aucune contrainte. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et le début de la pandémie de Covid-19 ne devrait pas complètement nous rassurer… Concluons par un bon point pour le secteur agricole : le stockage de carbone dans le sol a été reconnu comme un moyen de lutte contre le déréglement climatique pendant la COP23 dans le cadre de la convention cadre sur les changements climatiques.
A l’échelle européenne, nous avons vu arriver en 2020 le Green Deal européen (le « pacte vert européen » en bon français) dont les initiatives ambitionnent de rendre l’Europe le premier continent neutre en carbone à horizon 2050, rien que ça… Des premiers objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés au sein de l’Union Européenne pour 2030, avec des niveaux d’émissions d’au moins 55 % inférieurs à ceux des années 1990. Ce Green Deal fait globalement suite au Paquet sur l’énergie et le Climat (appelé aussi le « paquet énergie-climat ») qui prévoyait notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % à horizon 2020 par rapport aux niveaux de 1990. Le Green Deal a donc revu ces ambitions à la hausse pour l’horizon 2030. En Agriculture, le Green Deal européen s’est notamment décliné dans la stratégie « Farm to Fork » (de la ferme à la fourchette) avec des volontés fortes de réduction d’utilisation de fertilisants, pesticides, et antimicrobiens. Côté carbone, la stratégie Farm to Fork a été l’occasion d’envisager des systèmes de marché carbone pour financer la compensation carbone du secteur agricole. Nous y reviendrons un peu plus loin dans l’article ! Le Green Deal et la stratégie Farm To Fork devraient également servir de cadre aux directives de la nouvelle PAC qui devrait voir le jour courant 2021-2022. Des dispositifs de crédits verts (éco-régimes ou éco-schèmes, éco-conditionnalité…) sont attendus. Chaque état membre devra définir son Plan Stratégique National pour la PAC (PSN PAC). Pour le PSN PAC de la France, deux niveaux de crédits (standard et supérieur) devraient être accessibles, et ce par trois voies d’accès : les pratiques [amélioration des pratiques existantes comme les couverts végétaux ou la diversité de l’assolement], la certification environnementale [utilisation de cadres de certification existants comme HVE ou le bio], et les infrastructures agroécologiques aussi appelées IAE [mise en place d’éléments favorables à la biodiversité]. Le niveau du montant de ces crédits verts n’est pas encore totalement acté.
A l’échelle nationale, Cocorico, la France a mis en place sa loi sur la transition énergétique sur la croissance verte (LTECV) en 2015. Loi qui vise une réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 et une réduction d’énergies fossiles de 30% par rapport à 2012. La LTECV a donné une orientation générale qui a ensuite été accompagnée plus récemment d’une feuille de route pour lutter contre le dérèglement climatique, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Dans ce cadre, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié, y compris dans le secteur de l’agriculture – et le stockage de carbone y est également largement considéré. La stratégie nationale bas carbone complète et s’articule avec le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) programmé à la suite du Grenelle de l’Environnement. Et c’est également dans le cadre de la SNBC qu’a été lancé le label bas carbone (nous y reviendrons plus tard également). En mai 2021, la France a entériné sa loi « Climat et Résilience », faisant suite aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (3C). On retrouvait dans ces propositions plusieurs articles sur l’agriculture et l’alimentation. La loi Climat et Résilience est actuellement pas mal critiquée, notamment par les citoyens de la convention citoyenne pour le climat, qui lui ont d’ailleurs attribué la jolie note de 3.3/10. Pas vraiment rassurant… Côté agriculture également, l’ancien ministre de l’agriculture Stéphane le Foll a lancé en France en 2015 l’initiative internationale 4/1000, ou dit autrement, l’augmentation annuelle du stock de carbone dans les sols mondiaux de 0.4%. Intrinsèquement liés à la SNBC, et par la même, à l’agriculture, on pourrait aussi rajouter la Stratégie Nationale Biodiversité (SNB) – biodiversité dont la diminution a été très largement pointée par l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), et la stratégie « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) des sols à horizon 2030. Suite à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement français a déployé son plan de relance (appelé France Relance) dont plusieurs mesures sont orientées en faveur de la transition énergétique et climatique. On y retrouve notamment les Bons Diagnostic carbone dont nous reparlerons plus tard dans l’article.
Pour aller un peu plus loin dans ce gloubi-boulga, et si vous n’en avez pas eu assez, je vous propose de jeter un coup d’œil au graphique suivant, tiré d’un rapport de l’ADEME. Vous y retrouverez l’articulation entre plusieurs des stratégies et objectifs présentés plus haut.
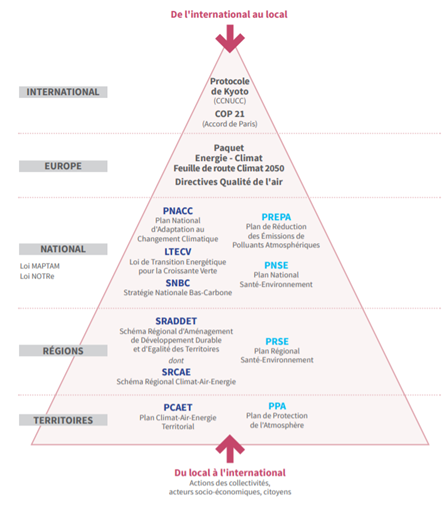
Figure 1. Politique internationale et nationale de lutte contre le dérèglement climatique.
Stocks et flux de carbone
Le sujet du carbone en agriculture est assez paradoxal. On ne cesse de nous expliquer qu’il y a trop de carbone dans l’atmosphère, alors que l’on cherche à augmenter la teneur de carbone organique dans les sols. Et pour cause, des décennies d’agriculture chimique et de techniques modernes intensives auront conduit à une perte de 50 à 70% des stocks de carbone dans notre plus grand compartiment de stockage, le sol. Les rapports du GIEC estiment qu’on y trouverait autour de 1500 Gigatonnes de carbone, soit environ trois fois plus que ce qu’on peut trouver dans l’atmosphère, ceci dit avec une grosse marge d’incertitude. Rajoutons à cela que les stocks de carbone sont souvent mesurés jusqu’à 1 mètre de profondeur alors qu’on pourrait en trouver encore plus en creusant un peu plus profond. Le déréglement climatique à l’œuvre et les hausses impressionnent de carbone dans l’atmosphère ont rendu le sujet du stockage de carbone particulièrement d’actualité, dans le sens où il pourrait aider à résoudre l’équation climatique. Il ne faut néanmoins pas y voir une solution miracle et se rappeler que le stockage ne viendra en aucun cas remplacer des réductions d’émissions à toutes les échelles possibles, et ce pour l’agriculture également.
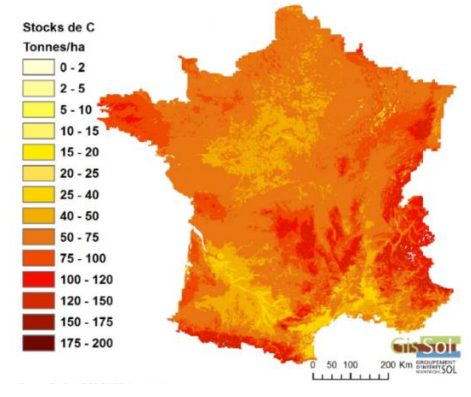
Figure 2. Carte des stocks de carbone organique des sols français (en tonne de carbone par hectare) sur les 30 premiers centimètres de sol (données GIS Sol). Tous les pays n’ont pas fait ce travail de recensement de stock de carbone
Le processus principal de stockage de carbone dans le sol reste la photosynthèse. C’est ce processus absolument incroyable qui permet de transformer le carbone de l’atmosphère (carbone atmosphérique) en carbone organique dans la plante ; carbone qui sera ensuite stocké dans le sol quand la biomasse végétale, chargée de carbone, s’y décomposera (résidus de couverts, racines, litières…). Ce carbone, contenu dans la matière organique du sol se retrouvera dans le sol sous plusieurs formes, plus ou moins dégradables ou minéralisables facilement. On retrouvera notamment des formes de matière organique labiles, minéralisables assez rapidement par les micro-organismes du sol pour assurer la fertilité du sol et une circulation du carbone dans tout le réseau trophique du sol (on parle de volant d’autofertilité), et des formes intermédiaires ou stables qui resteront dans le sol sur des temps longs.
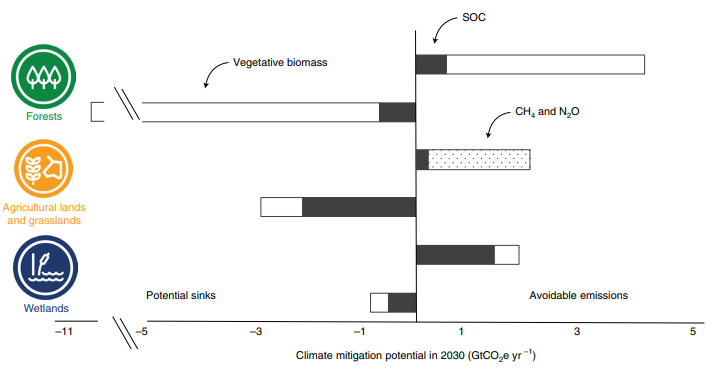
Figure 3. Potentiel maximal d’atténuation des effets du changement climatique par les sols en 2030 dans les voies d’accès aux biomes de la forêt, de l’agriculture et des prairies, et des zones humides, avec mesures de sauvegarde. A gauche de la barre verticale, on trouve les potentiels d’atténuation par stockage. A droite, les potentiels d’atténuation par réduction d’émissions. Les parties sombres des barres représentent le carbone organique des sols. Les parties blanches représentent la biomasse végétative et la partie en pointillé représente le CH4 et le N2O évités grâce à une meilleure gestion des nutriments et des animaux. Source : Bossio et al. (2020).
Il faut bien comprendre que le carbone dans le sol suit une dynamique, c’est un flux entrant et sortant continu. Le carbone se stocke dans le sol par l’apport de matières organiques (endogènes ou exogènes à l’exploitation) et se déstocke par minéralisation de la matière organique. Tout l’enjeu étant de faire en sorte que les stocks de carbone (notamment les formes intermédiaires et stables) augmentent le plus possible, et restent le plus longtemps possible dans le sol. On parle ici de l’effet de réversibilité ou de non-permanence du carbone en ce sens que tout ce qui a été stocké peut être déstocké si des pratiques dites « déstockantes » sont mises en place sur les exploitation. D’où la motivation première de faire en sorte de préserver au maximum le carbone là où il est abondant et notamment d’éviter la déforestation, le retournement de forêts, ou encore le drainage des sols organiques et zones humides.
Il faut garder en tête que les teneurs en carbone dans le sol finiront toujours par atteindre un état d’équilibre (sauf dans certains cas particuliers), c’est-à-dire que les niveaux de carbone entrants et sortant seront identiques. Au fur et à mesure du stockage, l’ajout de nouvelles quantités de carbone dans le sol en sera de plus en plus compliqué mais tout l’enjeu sera de réussir à en stocker le maximum. Comprenez néanmoins qu’il ne suffit pas qu’un sol soit riche en carbone pour être vivant et très fonctionnel. C’est bien l’autonomie de fertilité et la capacité du carbone à être bien intégré au réseau du sol qui devra être recherchée. Comme dirait l’autre, si vous voulez simplement rajouter du carbone dans les sols, vous pouvez y enterrer des pneus usés…
Et ces pratiques stockantes ou déstockantes commencent à être largement connues et documentées. En agriculture, bien que certaines soient encore sources de discussions assez musclées – notamment l’effet du non-labour – une bonne partie fait concensus : introduction de couverts, agroforesterie, gestion des prairies temporaires… (Figures 4 et 5). On peut alors différencier des pratiques qui sont plutôt de l’ordre de l’optimisation de pratiques déjà en place ou alors des pratiques dites plutôt transformantes où le système agricole subit vraiment une transformation profonde (introduction de couverts par exemple). Ces pratiques ont un intérêt plus ou moins marqué dans le stockage de carbone des sols, et sont surtout plus ou moins couteuses à mettre en œuvre (Figures 4 et 5).
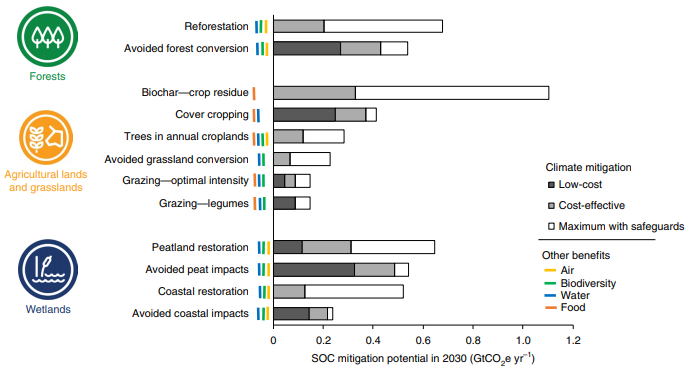
Figure 4. Potentiel de stockage supplémentaire de SOC pour 12 voies naturelles d’atténuation du climat. La partie gris foncé des barres indique les niveaux d’atténuation à faible coût (<10 dollars US (MgCO2e)-1. Les parties gris clair des barres représentent les niveaux d’atténuation rentables dans l’hypothèse d’une ambition mondiale visant à maintenir le réchauffement en dessous de 2 °C (< 100 dollars (MgCO2e)-1 par an). Les parties blanches représentent le stockage additionnel maximal en plus de ces deux précédentes barres.
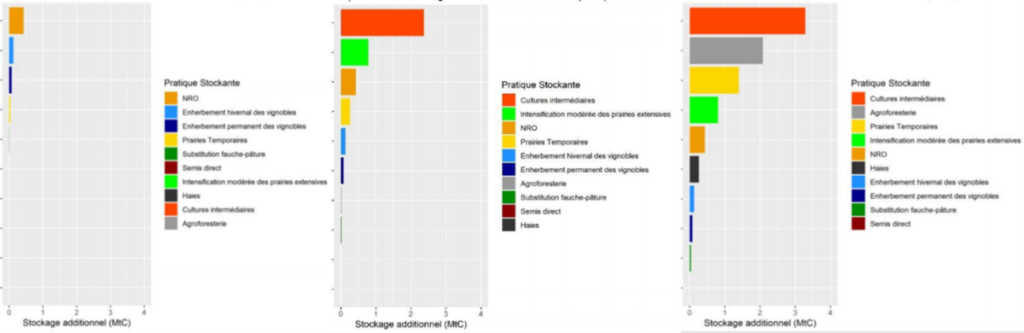
Figure 5. Contribution des pratiques au stockage additionnel obtenu pour un prix du carbone. A gauche pour 0 €/ tCO2e, au milieu pour 55€/tCO2e, à droite le stockage additionnel maximal. Source : INRAE (2019).
Quel est le potentiel de stockage des sols ? Il y aurait en réalité plusieurs manières de le considérer. On pourrait le voir comme un potentiel biophysique (celui qu’on pourrait trouver sous une forêt ou une prairie permanente) ou technique (ce qu’il est techniquement possible de faire), ce sont d’ailleurs les références qui sont le plus utilisées. Mais on pourrait aussi définir ce potentiel sous un prisme économique (les pratiques ont un coût à mettre en place) ou encore un prisme atteignable (faire en sorte que les pratiques soient adoptées, et mettre en place un environnement favorable au développement de projets bas carbone : formation, accompagnement, réseaux d’acteurs, outils à disposition, incitations financières…). Nous rediscuterons de tout ça plus loin.
Le stockage du carbone organique est un enjeu pour lutter contre le déréglement climatique, c’est certain mais il ne doit pas être considéré seulement sous ce prisme, bien au contraire. C’est le facteur numéro 1 de toutes les fonctions que le sol peut accomplir dans les premiers horizons : maintien de la fertilité, réduction de l’érosion des sols, structuration et portance du sol… L’enjeu du carbone est donc un co-bénéfice dont il faudra tirer parti, mais auquel le sol ne peut pas se résumer.
Différents types d’émissions et Scope 1 – Scope 2 – Scope 3
Jusqu’ici, nous avons pas mal parlé de stockage de carbone dans le sol. Pour revenir rapidement à la partie émissions en agriculture, elles sont pour la plupart connues et bien identifiées. Dans le secteur français, l’agriculture arrive en troisième position avec près de 20% des émissions françaises. Les principaux coupables sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), et le protoxyde d’azote (N2O). Et c’est bien le CO2 qui est émis en plus grande quantité. Le problème néanmoins, c’est que le méthane et le protoxyde d’azote ont des effets réchauffant très supérieurs à celui du dioxyde de carbone. C’est notamment un facteur 25 pour le méthane et un facteur 300 pour le protoxyde d’azote. Une unité de CH4 peut donc être convertie en 25 unités équivalent CO2, et une unité de N2O peut être convertie en 300 unités équivalent CO2, de manière à pouvoir comparer toutes les émissions de gaz à effet de serre sur la même base (on parlera donc bien de tonnes équivalent carbone ou en raccourci tCO2eq). Même émis en plus petites quantités, difficile donc de négliger le méthane et le protoxyde d’azote… Les principales émissions sont dues à la fermentation entérique des ruminants, à la fabrication et à l’utilisation des engrais minéraux azotés, à l’utilisation du diesel pour faire avancer les machines agricoles et au changement d’usage des sols. Ces émissions sont largement documentées dans la littérature.
Une façon de caractériser les émissions d’une exploitation agricole ou d’une entreprise est de raisonner en termes de « scope ». On en distingue 3 différents – Scope 1, Scope 2, Scope 3 – que l’Ademe définit comme suit :
- Scope 1 : Émissions directes provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses…
- Scope 2 : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.
- Scope 3 : Les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés par les activités de l’organisme …
Quand on parle d’émissions, on s’intéresse souvent seulement aux scope 1 et 2, soit parce que les émissions de ces scopes sont plus simples à calculer, soit parce qu’elles évitent de se poser trop de questions sur ce qui se passe en amont ou en aval de l’exploitation ou de l’entreprise. Les émissions du Scope 3 sont pourtant souvent loin d’être négligeables ! Et elles sont très différentes en fonction des secteurs que l’on étudie (Figure 6). Pour la production agricole, sans grande surprise, c’est bien le scope 1 qui reste prioritaire puisque la majorité des émissions a lieu sur l’exploitation. Mais pour l’industrie alimentaire, ce n’est déjà plus le cas…
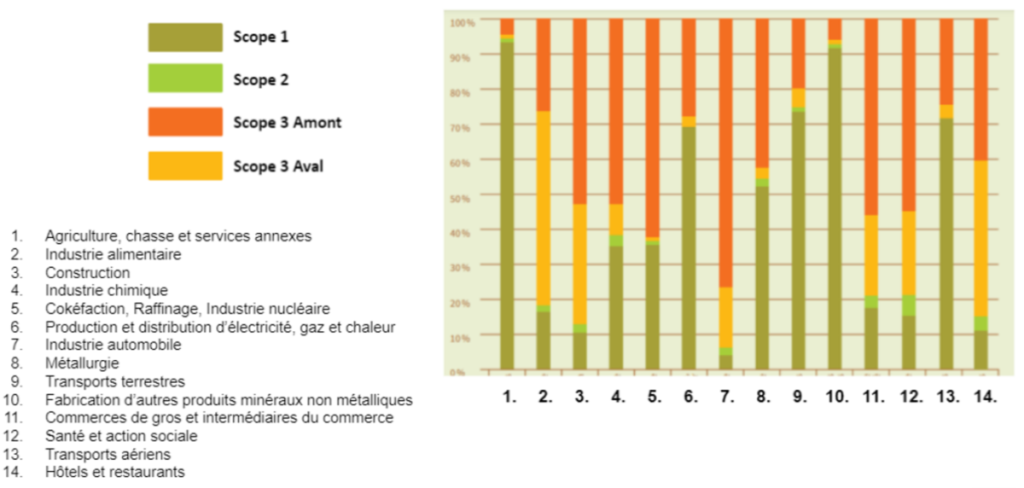
Figure 6. Les différents niveaux de Scope.
Ne pas prendre en compte le scope 3 peut conduire à des résultats complètement biaisés. De nombreuses entreprises ou territoires mettent en avant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur les dernières années, mais ce n’est en réalité parce qu’elles ne considèrent pas leur scope 3, qui inverserait alors complètement la tendance. L’oubli du scope 3 donne souvent l’impression artificielle que l’on est sur la bonne trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. On voit pourtant qu’un nombre important de choses que nous utilisons sur notre territoire n’y est pas produit, c’est donc bien qu’il y a eu quelque part des émissions à comptabiliser (on parle ici d’émissions importées, comme par exemple l’importation d’aliments pour l’élevage, qui engendre de la déforestation dans les pays producteurs d’aliments; cette déforestation est donc indirectement importée). On pourrait également définir le concept d’émission évitée, qui se comprend assez bien comme une émission qu’on pourrait empêcher en mettant en place un projet (par exemple en évitant des pratiques déstockantes ou en empêchant qu’une forêt soit déforestée). La lutte contre le déréglement climatique impose donc de s’intéresser aux réductions de l’ensemble de ces émissions directes et indirectes.
Le suivi des émissions et du stockage de carbone
Mesurer le carbone en agriculture
Pour améliorer un système, il faut le mesurer ; ça reste pour moi un leitmotiv assez pertinent. Dans le cas du carbone, ce qu’on aurait envie de mesurer pour faire bien les choses, ce sont d’un côté les émissions de carbone et de l’autre côté le stockage de carbone dans les sols. Les émissions en agriculture, ce n’est pas tant un problème. Entendons-nous bien, ce n’est pas qu’il n’y a pas d’émissions, bien au contraire – dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote entre autres – mais c’est que globalement, on les connait. Il y a énormément de littérature sur le sujet, de bases de données de facteurs d’émissions (combien émet tel ou tel produit ou pratique). Et ces bases sont sont d’ailleurs toujours en amélioration continue. En d’autres termes, on sait à peu près à quoi on a affaire. Le gros morceau du problème actuel, c’est pour suivre les stocks de carbone dans le sol. Mesurer le carbone dans un échantillon de sol à un moment donné, ça on sait faire. Assez classiquement, on analyse plutôt la teneur en matière organique de l’échantillon en laboratoire. On y mesure le carbone et on donne un généralement un résultat en matière organique (la proportion de carbone dans la matière organique est assez stable donc on s’en sort). On peut bien évidemment aller plus loin en analysant différentes formes de carbone organique mais le point d’attention n’est pas là (ou tout du moins pas pour le moment). Mais évaluer les stocks de carbone sur un territoire plus large (une parcelle, une exploitation…), et surtout suivre l’évolution de ces stocks de carbone au cours du temps, c’est une autre paire de manches. La mesure physique de ce carbone a un coût, ou plutôt plusieurs.
Il y a d’abord un coût à l’échantillonnage – que ce soit un coût en temps ou en main d’œuvre. Il faut un nombre suffisant de prélèvements dans une parcelle pour être exhaustif et représentatif des variabilités de teneur organique à un moment donné, échantillons qu’il faudrait par la suite envoyer (et payer) au laboratoire pour en récupérer les analyses. Et pour certains, cette variabilité spatiale, parfois au sein même d’une parcelle, est si grande que la quantité d’échantillons à prélever serait presque impossible à réaliser (plusieurs centaines d’échantillons à l’hectare). Ce n’est néanmoins pas la pensée de tout le monde, certains acteurs remettant en cause la qualité des prises d’échantillons actuelles. Pour ces derniers, il est nécessaire de réaliser des analyses de sol à masse apparente constante ou densité apparente constante, mais surtout pas à profondeur constante, pour ne pas biaiser les résultats – et l’échantillonnage de sols serait alors largement suffisant.
Dans l’optique d’un suivi des teneurs en matière organique dans le temps, il serait nécessaire de mettre en place des campagnes d’échantillonnage régulièrement. On pourrait en imaginer une tous les ans, en même temps que d’autres analyses de sol classiques, ou alors une à chaque étape clé d’un projet visant à introduire des pratiques stockantes de carbone – notamment au début et une fois le projet terminé. Un des principaux problèmes soulevés par ce suivi temporel est que les évolutions de teneur en matière organique des sols seraient trop faibles pour pouvoir être détectées correctement. En d’autres termes, sur des temps courts (de l’ordre de quelques années seulement), les variations de teneur organique dans les sols seraient plus faibles que l’incertitude de la mesure de carbone en laboratoire. En introduction de cette section, j’ai bien précisé qu’il n’y avait pas d’enjeu technique à la mesure du carbone en laboratoire – on sait mesurer une teneur – mais je n’ai pas dit que la mesure obtenue était extrêmement précise. Il faudrait en réalité attendre au moins 6-7 ans pour déceler des variations significatives de MO dans le sol et s’assurer de ne pas se trouver dans la barre d’incertitude des mesures en laboratoire.
Comment alors s’abstraire de ces deux problématiques principales, à savoir la quantité d’échantillons requis pour représenter correctement une parcelle ou une exploitation, et la variabilité temporelle faible du carbone dans les sols qui en empêcherait un suivi temporel. Une première réponse assez classique en sciences est la modélisation. A partir d’un stock initial connu de carbone dans le sol, on modélise, à partir de données d’expérimentation, comment les pratiques de l’agriculteur sur site influencerait le stockage ou le déstockage de carbone dans le sol. Le modèle donne ainsi une trajectoire moyenne du carbone, et cette trajectoire peut être donnée à l’échelle de la parcelle, du système de cultures ou de l’exploitation en fonction de la manière dont est réalisée la modélisation. On se trouve donc plutôt ici dans une logique de moyens (on regarde ce qui est fait, on regarde les moyens mis en oeuvre) et pas vraiment dans une logique de résultats (on observe ce qu’on obtient à la fin), même si rien n’empêche bien sûr d’aller revérifier à la fin que la modélisation n’a pas raconté n’importe quoi. On peut très bien imaginer des approches plutôt hybrides où une collecte de données un peu au fil de l’eau permet d’ajuster régulièrement la modélisation à ce qui est observé sur le terrain (on parle plutôt d’assimilation de données). Rajoutons également qu’une modélisation n’est pas nécessairement statique (les paramètres de modélisation sont fixés au départ); elle peut être aussi dynamique (un ou plusieurs paramètres de modélisation sont mesurés au cours du temps). Malgré tout, la modélisation ne peut pas se priver d’une mesure de stock de carbone initial pour que l’état de référence soit au moins connu avec la meilleure précision possible.
Comme la mesure de stock de carbone en absolu est déjà un peu incertaine, on aura d’ailleurs plutôt tendance à travailler sur des variations de stocks – une évolution de carbone en relatif dirons-nous – plutôt que sur des évolutions de stocks en absolu. C’est ce que préconise un des derniers rapports de l’INRA sur le sujet (Yogo et al. 2021). Dans le cadre du modèle AMG testé (nous reviendrons juste après sur tous ces modèles), on y voit notamment que le suivi d’une variation de stock plutôt que d’un stock en absolu permet de réduire assez considérablement les erreurs de modélisation. On préférera donc dire qu’en 5 ans, le sol a stocké 3 tonnes de carbone, plutôt que d’essayer d’estimer le stock en sortie avec précision. C’est donc bien une variation, un delta, ou encore un différentiel qu’il est peut-être plus pertinent de mesurer.
Pour pallier l’exhaustivité d’échantillonnage terrain pour le suivi du carbone dans les sols, plusieurs acteurs se sont positionnés sur des systèmes d’acquisition de données. Le principal intéressé étant le satellite dont les images prises régulièrement couvrent des territoires relativement étendus. Je ne m’attarderai pas à ici à expliquer l’ensemble des caractéristiques d’une image. Les curieux ou néophytes peuvent aller creuser autour des résolutions spatiale, temporelle, et spectrale des principales constellations de satellites utilisées en agriculture. Gardez à l’esprit que dans le cadre du carbone, l’image satellite pourrait servir à deux choses. Soit à mesurer directement un stock de carbone dans les sols en combinant les différentes informations spectrales de l’image, soit à suivre dans le temps un paramètre d’intérêt intégré à un modèle d’estimation de carbone dans le sol (de la biomasse notamment). A l’heure actuelle, le satellite semble apporter plus d’intérêt pour sa dynamique temporelle et son suivi de paramètres d’entrée de modèles agronomiques que pour une mesure de carbone en absolu en bonne et due forme, et ce pour plusieurs raisons. L’image donne déjà une vision superficielle du sol alors que le carbone organique est généralement étudié à des horizons de sols de 0-30 cm, voire bien plus profond. Le signal satellite ne traverse pas une bonne partie des couches du sol. Le passage d’un signal optique à un signal radar ne devrait pas beaucoup arranger les choses. Et le satellite lui aussi fait face aux évolutions assez faibles de teneurs en carbone du sol dans le temps. Si les variations sont difficilement détectables en laboratoire, il y a encore moins de chances qu’elles ne le soient par satellite. Certains travaux en France s’intéressent néanmoins aux outils satellites pour mesurer des niveaux de carbone organique en surface (Vaudour et al., 2021). Dans un futur plus ou moins proche, on pourrait néanmoins se demander si ces travaux seront toujours d’actualité pour les surfaces agricoles si tous les agriculteurs ont leurs sols couverts en permanence – le satellite ne pourra alors plus observer la couleur du sol nu pour mesurer le niveau de matière organique en surface. A côté de ça, une fois que l’on met du carbone dans le sol, le sol s’assombrit, et il a un albedo plus faible. Une fois que l’on stocke du carbone dans le sol, il faudrait donc couvrir le sol pour éviter que les bénéfices liés au stockage soient perdus par ces effets albedo. Les travaux par satellite se basent sur l’analyse de l’information spectrale de l’image, on parle de spectrométrie. Des approches similaires de spectrométrie, mais très proche du terrain sont également déployées. Des spectromètres embarqués – par exemple la technologie Verris utilisés en France par des acteurs comme PreciField – ou des spectromètres portables sont utilisés pour mesurer des taux de matière organique dans les sols. Une des limites ou des points d’attention principaux de ces systèmes étant l’étalonnage des capteurs et la dépendance du signal spectral aux conditions du sol (teneur en eau, structure…).
Si la capacité d’échantillonnage à grande échelle n’est pas techniquement ou économiquement réalisable, vaut-il mieux alors suivre assez peu d’échantillons mais toujours au même endroit et sur une longue période de temps ou alors modéliser l’évolution de la teneur en carbone dans les sols en utilisant des paramètres dynamiques de sol ou de végétation que l’on peut suivre par spectrométrie ? Le suivi de sol sur un point GPS très précis dans le temps est-il vraiment possible dans la mesure où le passage de machines (même sans travail du sol) et les agents climatiques peuvent déplacer un peu de sol ? On pourrait aussi rajouter que l’échantillonnage de sol est très concret, et que c’est quelque chose qui parle aux agriculteurs. Ca permet effectivement de poser un certain nombre de bases. Pour le déploiement d’une dynamique de réduction d’émissions et de stockage de carbone en agriculture, il y a besoin d’avoir des indicateurs terrain simples à mettre en place dans les fermes. La teneur en matière organique a le gros intérêt de faire réfléchir et avancer. Concernant la modélisation, une chose est sûre, les données sur site sont fondamentales, notamment pour initialiser les modèles. Et la modélisation sera d’autant plus précise qu’il sera possible d’articuler intelligemment mesures terrain (stock initial de carbone), données d’agriculteurs (pratiques, interventions…), et données satellitaires (suivi dynamique de paramètres d’intérêt).
Modèles, Outils et Méthodes du marché
Quelques éléments de terminologie
Commençons peut-être par clarifier quelques termes. On essaiera au maximum de s’y tenir dans le reste du document mais ça sera au moins l’occasion de donner un cadre pour ne pas trop se perdre.
- On va déjà englober dans le terme « données » tout ce qui va servir de près ou de loin à quantifier ou décrire des teneurs ou niveaux en carbone, et on en a déjà évoqué plusieurs dans la section précédente. Exemple : échantillons, mesures en laboratoire… et auquel on peut rajouter données agriculteurs, base de données de sol…
- Viennent ensuite les modèles qui, comme on l’a décrit, se basent sur un ensemble de données d’expérimentation, et dont l’objectif est d’estimer des teneurs ou des évolutions de teneur en carbone dans le temps. Il est important de vérifier les conditions d’applicabilité des modèles (en fonction des types de sol par exemple). Exemple : AMG, SAFY-CO2, RothC, STICS, CHN…
- Ces modèles peuvent être intégrés dans des outils, qui ne sont en fait ni plus ni point qu’une sorte d’interface un peu plus humaine du ou des modèles qui y sont intégrés. On pourra donc par exemple paramétrer un outil, le faire tester à un utilisateur, j’en passe et des meilleures. Gardez bien en tête qu’un outil ne fait pas nécessairement appel à un modèle. Il peut simplement utiliser des données issues de systèmes de mesure, ou bien des facteurs d’émissions carbone. Certains outils et/ou indirectement modèles s’intéressent aux émissions de carbone alors que d’autres s’intéresseront au stockage de carbone dans le sol. Certains s’intéressent seulement au carbone alors que d’autres envisageront une plus grande diversité de gaz à effet de serre, méthane et protoxyde d’azote notamment. Certains outils peuvent être certifiés (Ecocert, ISO, 2BSvs…), d’autres non. Certains outils peuvent avoir plusieurs modes de saisie de données (une interface de saisie très simple mais plus grossière, et une interface de saisie avancée pour des résultats plus fins). Exemple : Simeos-AMG, MyEasyCarbon, Carbon Track, Cool Farm Tool, CAP’2ER, Systerre…
- Les méthodes donnent un cadre d’application à des projets dont l’ambition est de réduire les émissions ou de mettre en place des pratiques de stockage de carbone. Certaines méthodes peuvent être certifiées, d’autres non. Dans le cadre du carbone, on peut d’ailleurs faire une distinction claire entre une certification environnementale (qui va plutôt cibler une exploitation – on dira qu’elle est dans une démarche de progrès) d’un affichage environnemental (qui va plutôt cibler un produit). Les méthodes peuvent être considérées comme des standards si tout le monde considère qu’elles font référence. Des méthodes peuvent ou non préconiser des outils de mesure. Les méthodes peuvent être conformes ou non à des recommandations ou rapports nationaux ou internationaux (GHG Protocol, GIEC). Exemple : Label Bas Carbone, Carbon Agri, Carbocage, ABC’Terre, Gold Standard, Verra VCS, Regen Network…
Pour comparer les différents outils entre eux, une façon de faire est d’utiliser la hiérarchie proposée par le GIEC sous la dénomination de « Tier ». Le Tier 1 correspond aux outils qui utilisent des facteurs d’émissions à partir de modèles très génériques, qui ne sont pas spécifiques à un pays ou une région. Par exemple, telle pratique agricole stocke ou déstocke tant de tonnes de CO2. Le Tier 2 va un peu plus loin, avec des facteurs d’émissions souvent un peu plus spécifiques au pays, région ou condition dans lequel les pratiques sont mises en place. Les outils de Tier 3 sont les plus aboutis et mettent à profit des modèles dynamiques de carbone (on suit des paramètres de sol et/ou de végétation dans le temps pour affiner les modèles). L’idée en général n’est pas de dire que tel ou tel outil est mieux que les autres – ça peut servir à ça aussi certes – mais plutôt de ne pas comparer des choux et des carottes. Si l’on peut par exemple se soustraire des facteurs d’émission, on peut trouver de l’intérêt à aller des des outils plutôt Tier 3. Dans le cadre d’une dynamique territoriale, il peut être pertinent d’utiliser ce que l’on sait faire avec du suivi satellitaire dynamique.
Pour pallier la qualité ou l’incertitude des données disponibles qui iront ou non alimenter des modèles et/ou outils, plusieurs méthodes ont mis en place un système de rabais. Ces rabais sont souvent des recommandations, comme dans le cadre de la méthode Label Bas Carbone grandes cultures, qui devrait être officiellement validée à la mi 2021 (Figure 7). Ces rabais viennent s’ajouter à des rabais obligatoires pour les risques de non-permanence du carbone dans les sols (nous y reviendrons plus loin). Chaque méthode décide, oriente ou propose la façon de considérer les rabais. Nous reparlerons de ces systèmes de rabais un peu plus loin.
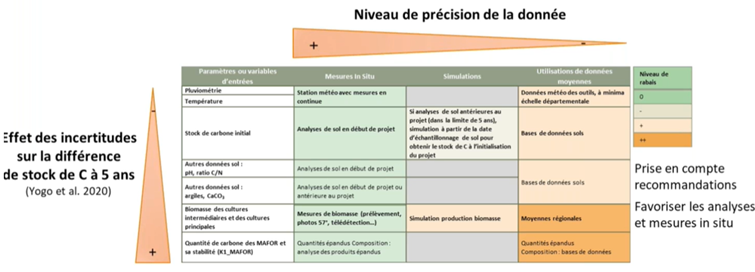
Figure 7. Exemple du calcul de rabais lié à l’incertitude des données d’entrée des modèles de stockages de carbone du sol pour la méthode du Label Bas Carbone grandes cultures. Source : Séminaire chaire AgroTIC et chaire Elsa-Pact.
Sans être exhaustifs, rentrons dans le détail de quelques méthodes et outils français et internationaux. Pour compléter ces détails, vous trouverez des tableaux de comparaison et des fiches d’outils et méthodes dans un récent rapport de l’INRAE (Yogo, 2021).
La méthode Label Bas Carbone : LBC
Portée par l’état et pilotée par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), la méthode Label Bas Carbone (LBC) est une stratégie au service de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). C’est une initiative du gouvernement sur le territoire pour pousser les agriculteurs français à engager une réduction d’émissions et mettre en place des pratiques de stockage carbone, et pour pousser les entreprises françaises et internationales à s’intéresser à des projets menés sur le territoire français. L’objectif est d’apporter des garanties sur le terrain et d’aller chercher de la rémunération pour ces réductions d’émissions. C’est une initiative incitative pour mettre en place des pratiques bas carbone.
En fonction des filières et contextes, la méthode LBC a soit été déployée, soit est en cours de déploiement, soit est en cours de développement. On en retrouve par exemple des déclinaisons en élevage (la méthode s’appelle Carbon Agri), en grandes cultures, en vigne, en vergers, pour les haies, ou encore pour les méthaniseurs. Ce n’est pas le ministère ni les agro-industries qui imposent de nouvelles méthodes mais bien les acteurs des filières qui proposent ces méthodes. Pour chacun de ces secteurs, les consortiums, professions agricoles, fédérations, ou encore instituts techniques mobilisés sont différents.
La méthode LBC est un cadre de certification carbone volontaire pour des projets privés. Chaque structure ou collectif d’agriculteurs (la méthode LBC ne cible pas vraiment les agriculteurs individuellement) désireux de faire certifier son projet de réduction d’émission ou de stockage peut monter son projet et se diriger vers le ministère de la transition écologique et solidaire. Le ministère ne cherche pas vraiment à cibler des projets individuels mais plutôt à agréger une masse critique d’agriculteurs pour aller chercher collectivement des financements. Seuls des projets sur le territoire français pourront être labellisés par le LBC. A la suite d’un projet labellisé par la méthode LBC, ce sont bien des réductions d’émissions qui seront certifiées et pas l’exploitation agricole en elle-même. Une exploitation qui se lance dans un projet certifié LBC ne sera pas labellisée exploitation bas carbone. Ce qui sera certifié, c’est le fait que par ses pratiques, l’agriculteur aura réduit ses émissions et/ou stocké du carbone dans le sol. Une fois reconnues et certifiées, les réductions d’émissions pourront être commercialisées, ce sont les fameux « crédits carbone », nous y reviendrons plus tard. Les unités de réduction carbone sont la propriété du porteur de projet (agriculteur ou forestier)
La méthode LBC est une obligation de moyens, il n’y a pas d’obligation de résultats. Un diagnostic initial est mené sur les fermes en collectant des mesures terrain et des données d’agriculteurs. Ces données servent ensuite à définir un scénario de référence. Ce scénario sera finalement projeté dans le futur après modélisation avec les pratiques actuelles de l’exploitation, et sera comparé à un ou plusieurs scénarios eux aussi théoriques mais utilisant des pratiques plus vertueuses sur l’exploitation. C’est la différence entre ces deux scénarios, tous les deux projetés, qui permettra d’évaluer les réductions d’émissions et/ou stocks de carbone sur l’exploitation. Soyez bien clairs sur le fait que le scénario avec pratiques vertueuses n’est pas comparé à l’état de référence au moment de l’acquisition des données, mais bien à l’état de référence projeté dans le temps en considérant que les pratiques sur l’exploitation ne changent pas. Pour la partie stockage de carbone dans le sol, l’absence d’obligation de résultats n’impose pas de retourner sur le terrain pour établir un nouvel état atteint. La modélisation se suffit à elle-même. La méthode LBC considère que si les leviers agronomiques sont appliqués, c’est que le projet va forcément dans la bonne direction.
Sur la partie émissions, les réductions sont évaluées à la fin du projet en étudiant les factures de l’exploitation (consommation d’engrais minéral azoté, carburant, fuel…).
La méthode LBC s’adresse à tout type de profils agricoles, que ce soit à quelqu’un qui n’ait mis en place aucun pratique vertueuse, ou au contraire avec quelqu’un déjà très engagé sur des pratiques de réduction ou de stockage et qui souhaiterait faire reconnaitre ce qui a déjà été mis en place. La différence se jouera sur le scénario de référence choisi. Prenons l’exemple du stockage de carbone. Dans le premier cas – quelqu’un qui n’aurait mis en place aucun pratique vertueuse – on peut faire l’hypothèse que la marge de progrès est importante (on parlera plutôt de stockage additionnel de carbone) : l’agriculteur pourra se comparer à lui-même avec ou sans pratiques. Cet agriculteur-là, passant peut-être de 50 à 52 tonnes de carbone dans son sol, aura stocké 2 tonnes. Dans le second cas – quelqu’un déjà très engagé sur des pratiques de réduction ou de stockage – la marge de progression est déjà plus limitée (on parlera plutôt de maintien de stocks) : l’agriculteur aura plutôt intérêt à choisir une référence générique – comme une moyenne sur des exploitations aux conditions pédo-climatiques similaires à la sienne. Un agriculteur qui a ainsi déjà un stock et qui le maintiendra dans le temps pourra donc le faire reconnaitre. L’objectif est bien de lui faire maintenir ses pratiques pour lui éviter de déstocker du carbone. Cet agriculteur-ci, ayant par exemple déjà un sol avec un stock de 52 tonnes de carbone évitera de retomber à 50 tonnes de carbone s’il arrête ses pratiques de stockage, il aura alors évité de déstocker 2 tonnes.
La méthode LBC s’intéresse à l’échelle de l’exploitation et/ou du système de cultures, mais elle ne considère pas chaque culture indépendamment.
Au stade actuel, la méthode LBC n’est pas reliée à la PAC.
L’outil CAP’2ER
L’outil CAP’2ER est l’outil de la méthode Carbon Agri, qui correspond en fait à la méthode LBC pour l’élevage. Mise en place par le CNIEL et l’IDELE, la méthode Carbon Agri a été soumise au ministère et certifiée en septembre 2019. L’outil CAP’2ER ne sort pas de nulle part. Depuis près de 10 ans, l’IDELE et ses partenaires travaillent sur la thématique des impacts agricoles sur l’effet de serre, la qualité de l’air et de la préservation de ressources énergétiques au travers du projet Ges’tim, qui sera d’ailleurs bientôt lui aussi remis à jour.
Le premier projet carbone déployé en 2019 – Carbon Diary – a permis de réaliser un diagnostic carbone sur 4000 fermes avec l’outil CAP’2ER. Aujourd’hui, à la mi-2021, ce sont 15000 fermes impliquées pour 22000 diagnostics (certaines fermes ont déjà réalisé deux diagnostics).
Dans la même veine du LBC, la méthode Carbon Agri est une démarche volontaire, dont l’objectif est d’y faire entrer le maximum de producteurs. L’outil CAP’2ER est un outil de Tier 1, basé principalement sur des facteurs d’émission et des données empiriques de la littérature. Même s’il s’intéresse aussi au stockage de carbone dans les sols au travers de l’utilisation des prairies, ses principales contributions sont sur les réductions d’émission de gaz à effet de serre: dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote.
Nous rediscuterons des crédits carbone plus tard, mais dans le cadre des réductions d’émissions générées par la méthode Carbon Agri et pour gérer les mécanismes de réduction carbone, les Jeunes Agriculteurs ont créé l’association France Carbon Agri dont l’IDELE est l’opérateur technique. Contrairement à l’élevage où le mandataire des projets – France Carbon Agri – est très bien identifié, le secteur des grandes cultures verra de nombreux mandataires différents (Coops, CETA, GIEE, CER, Bureaux d’études…) pour développer des projets collectifs pour agriculteurs. Le fonctionnement sera le même mais cet écosystème sera beaucoup plus éclaté et décentralisé qu’il ne l’est sur le secteur de l’élevage.
Une version européenne de CAP’2ER est en développement.
Le modèle SAFY-CO2
Développé par le CESBIO et le CNRS, le modèle SAFY-CO2 (ou SAFYE-CO2 quand une composante eau est intégrée au modèle) est un modèle agro-météorologique dont l’objectif est d’estimer le stockage de carbone par la plante, en faisant un lien direct entre ce stockage et la biomasse observée par satellite. L’utilisation des données satellitaires Sentinel 2 permet de donner à voir le bilan carbone de l’année (flux de CO2 et exports de carbone à la récolte) à une échelle parcellaire. Notez également que le modèle ne s’arrête pas à la biomasse mais s’intéresse aussi à l’estimation de rendement. Vous l’aurez surement compris, le modèle SAFY-CO2 est une approche de Tier 3.
SAFY-CO2 n’est paramétré pour l’instant que pour quatre cultures (blé, tournesol, maïs, colza) avec une paramétrisation assez générique, qui peut néanmoins évoluer en fonction du type de couverts présents. Pour les cultures d’hiver, deux paramétrisations sont disponibles, une pour les couverts courts (couverts obligatoires en rapport avec la directive nitrates) et une autre pour les couverts longs, ceux détruits à la fin mars ou début avril. Pour les cultures d’été, la tâche est un peu plus compliquée dans la mesure où la distinction entre couvert intermédiaire, repousse, et/ou adventices n’est pas évidente. La composition des couverts n’est pour l’instant pas prise en compte, faute d’information, mais pourra l’être dans les années à venir en fonction des données remontées par les agriculteurs.
Dans la version actuelle du modèle SAFY-CO2, les estimations d’évolution de la matière organique ne sont valables que sur des sols appauvris en matière organique, ce qui est le cas de la grande majorité des parcelles agricoles. Une thèse est en cours pour des contextes de sol plus riches en matière organique dans l’objectif d’avoir des paramètres pertinents à rentrer dans le modèle pour ces situations-là.
Plusieurs projets et initiatives sont en cours :
Une chaine de traitement plus lourde, AgriCarbon-EO, est en cours de déploiement. Cette chaine permettra de considérer à la fois des approches Tier 1, Tier 2, mais aussi Tier 3 en intégrant le modèle SAFY-CO2. Et la chaine de traitement devrait être en mesure de récupérer des sources de données de logiciel de gestion parcellaire, notamment du logiciel Mes Parcelles. Un couplage entre le modèle de dynamique de sol AMG (présenté dans la section suivante) et le modèle SAFY-CO2 pourra permettre améliorer l’estimation de la décomposition de matière organique dans le sol. SAFY-CO2 ne l’estime pour l’instant qu’avec une approche simple basé sur des niveaux de température. AMG, quant à lui, va beaucoup plus loin en intégrant les propriétés chimiques des sols. La combinaison des deux modèles permettra d’allier modèles de sol et de biomasse pour mieux estimer les évolutions de stock de carbone dans les sols. A noter également que pour l’instant, AgriCarbon-EO ne prend pas en compte l’azote apporté et son impact sur les gaz à effet de serre. A la différence du modèle SAFY-CO2, plutôt orienté au départ vers la recherche, les développeurs de la chaine de traitement AgriCarbon-EO ont fait un travail de propagation des incertitudes des données d’entrée sur les sorties des traitements. Aucune décote n’est actuellement demandée par la PAC ou autre mécanisme en fonction de la précision du modèle mais, dans un contexte plus large, on peut imaginer que ça devienne le cas. L’objectif de ce travail de propagation d’incertitudes est de quantifier l’incertitude sur chacune des variables simulées (flux de CO2, rendement, biomasse…) de manière à produire des cartes d’incertitude. La chaine de traitement AgriCarbon-EO a été imaginée pour être en cohérence avec la stratégie MRV (monitoring, reporting, verification) de la PAC, et est compatible avec une méthode label bas carbone.
La chaine AgriCarbon-EO reste encore un outil plus proche du domaine de la recherche. Pas encore opérationnel, se posera notamment la question de sa mise à l’échelle, ou en d’autres termes de savoir qui sera en charge de la gestion des données satellitaires, et de l’utilisation de la chaine AgriCarbon-EO. Est-ce que le ministère pourrait s’en charger ? Ou alors peut-être le programme européen Copernicus ? Il faudra quel quelqu’un se positionne pour assurer le service.
Dans la continuité de la COP21, le projet H2020 Circasa (https://www.circasa-project.eu/) a défini une méthodologie pour aborder les bilans carbone de manière spatialisée. Le projet s’est terminé il y a quelques mois mais une suite devrait être mise en place. Autre projet H2020, projet NIVA, lui pour le coup toujours en cours en 2021. NIVA ambitionne de développer une approche emboitée à trois niveaux de complexité – toujours en suivant les taxonomies Tier 1, Tier 2, et Tier 3 – sur les indicateurs de carbone, de lixiviation des nitrates et de biodiversité. Le niveau Tier 1 s’appuie seulement sur la donnée satellitaire et le registre parcellaire graphique (RPG). Pour les cartes de bilan carbone à la parcelle, un lien est fait entre durée de couverture du sol et quantité de CO2 absorbée (le lien a été établi sur une vingtaine de sites avec des mesures d’échanges de flux par Eddy Covariance). La relation est générique et peut être appliquée sur pas mal de cultures (sauf le riz). L’objectif est de produire des cartes, à la parcelle ou au pixel, des zones qui fixent ou non du CO2, et de suivre les parcelles proches de l’équilibre. Le niveau Tier 2 utilise toujours cette relation empirique entre durée de couverture du sol et quantité de CO2 absorbée, mais intègre aussi des données agriculteurs pour aller jusqu’au bilan carbone plus complet en calculant des quantités de carbone exporté à la récolte (dans le grain, les pailles, les fourrages…) ou apporté sous forme d’amendements. Le Tier 3 se base sur le modèle SAFY-CO2 que nous avons décrit plus haut.
Le projet Quantica s’intéresse quant à lui à l’apport spécifique de l’intercultures. L’objectif est de mesurer spécifiquement la biomasse des couverts avec comme finalité d’affiner le bilan carbone à la parcelle : à la fois prendre en compte ce qui se passe en cultures mais aussi intercultures sur une ou plusieurs années. On s’intéresse spécifiquement à l’intercultures et à la biomasse du couvert pour stocker du carbone dans le sol. La détection d’intercultures marche plutôt bien pour discriminer le sol nu d’un sol couvert. Des données radar peuvent même être utilisées en compléments pour pallier la présence de nuages. L’estimation de biomasse par radar est loin d’être simple, dans la mesure où ces signaux sont sensibles à l’humidité et la teneur en eau des sol (l’entreprise OneSoil proposerait déjà des cartes de biomasse interpolées avec des données radar). Le plus important reste d’avoir des images satellites à la fin de la croissance des couverts puisque c’est ça qui sera enterré dans le sol. La question du couvert n’est néanmoins pas évidente, d’autant plus que ce sont souvent des mélanges.
Le modèle AMG
Développé par AgroTransfert et ses partenaires, le modèle AMG est une modèle dynamique de sol – c’est donc un niveau Tier 3 – qui s’intéresse au stockage du carbone dans les sols et à la gestion des matières organiques. Le modèle considère un ensemble de données d’entrée simples pour décrire l’exploitation agricole (rendement, couverts intermédiaires, travail du sol, irrigation…) et estimer le carbone qui rentrera dans le sol par les résidus de culture et qui se transformera en humus. En y rajoutant le type de sols et des données climatiques, il est possible d’aller jusqu’à un bilan de carbone humifié du sol. Le modèle AMG donne en sortie l’évolution dans le temps des stocks de carbone et sa teneur dans les couches superficielles.
Le modèle AMG pourrait aussi être couplé avec des données de télédétection, comme ce dont on a discuté dans la section précédente au sujet de SAFY-CO2. Classiquement dans AMG ou dans d’autres modèles dynamiques de sol, la biomasse n’est pas mesurée mais estimée, souvent à partir du rendement et de fonctions allométriques. Cette source d’incertitude pourrait être réduite en mesurant un niveau de biomasse à partir d’imagerie satellitaire.
Le modèle AMG est intégré dans l’outil Simeos-AMG, qui est en fait grosso modo AMG avec une interface. Le logiciel est fait pour aider à voir ce qu’on pourrait attendre de nouvelles pratiques par rapport à une situation de référence et prendre une décision sur le long terme. Le logiciel est également utilisé aussi pour faire des simulations et se projeter (en se demandant par exemple s’il y aurait de l’intérêt exporter des pailles, et si oui à quel rythme…)
Le modèle AMG a été décliné sur la vigne en collaboration avec l’IFV et l’INRAE. Les fonctions de minéralisation utilisées sont les mêmes, seules les entrées du modèle changent. Des réflexions sont en cours pour mettre en place le modèle AMG sur les prairies.
Le modèle AMG fait également partie intégrante de la méthode ABC’Terre, dont l’objectif est de réaliser un bilan de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire, en y intégrant entre autres les effets du carbone dans les sols grâce au modèle AMG. Les entrées du modèles AMG sont déterminées grâce à des sources de données relativement larges, notamment le registre parcellaire graphique (RPG) pour reconstituer des rotations par type de sol et exploitation, mais aussi la base de données d’analyse de terre (BDAT) constituée par le Gis Sol. Comprenez-bien qu’ABC’Terre utilise les sorties du modèle AMG, mais n’y est pas exclusif. On y retrouve aussi des facteurs d’émissions issues de la base de données Agribalyse ou encore des facteurs d’émissions du GIEC.
L’outil Cool Farm Tool (CFT)
Développé au départ par l’université d’Aberdeen, Unilever, et le Sustainable Food Lab, Cool Farm Tool (CFT) est un outil pour calculer l’empreinte carbone des exploitations agricoles, en considérant les émissions et le stockage de carbone dans le sol. L’outil considère des approches Tier 1 et 2 pour le bétail (laitier et bovin) et les cultures, ainsi qu’un modèle « simple » de niveau Tier 3 en ce qui concerne les émissions de N2O et la séquestration du carbone dans le sol. L’outil est en partie aligné avec un certain nombre de normes et de protocoles (GIEC, protocole GHG..) mais ne cherche pas nécessairement à y être parfaitement conforme. Même si certaines approches sont encore assez simplistes – par exemple sur les couverts végétaux – l’outil continue à être amélioré régulièrement. Gardez en tête que l’on évoque principalement Cool Farm Tool pour ses aspects carbone, mais l’outil s’intéresse également à la ressource en eau, l’efficience de l’azote, et la biodiversité.
L’outil est relativement simple à utiliser, avec de nombreuses valeurs par défaut (il est d’ailleurs possible de définir des intervalles plutôt que des valeurs uniques), et la majorité des données d’entrée sont à remplir manuellement. L’outil fait le lien avec des bases de données externes, notamment pour récupérer des données climatiques et la disponibilité en eau. Contrairement à d’autres outils ou modèles que nous avons pu décrire, l’outil ne fait pas appel à des données satellitaires pour calculer des niveaux de biomasse ou de carbone dans le sol. Des API seraient néanmoins disponibles pour travailler avec un acteur du géospatial, GeoFootPrint.
L’outil Cool Farm Tool n’est pas encore très largement utilisé dans le cadre des marchés carbone – c’était au départ un outil plutôt à destination d’aide à la décision. Cool Farm Tool reste un outil de mesure. Ce n’est pas un outil de certification et il ne permet pas aujourd’hui de qualifier un crédit carbone. Toutefois, la Cool Farm Alliance s’efforce d’améliorer la structure et la méthodologie de l’outil afin qu’il devienne compatible avec les divers systèmes de crédit carbone existant dans le monde. Pour les marchés carbone néanmoins, l’outil Cool Farm est promu par des membres tels que la société danoise Commoditrader et l’entreprise belge Soil Capital, l’entreprise ayant considéré que l’outil jouissait d’un consensus scientifique et industriel (de nombreux industriels ont participé à son financement) suffisamment solide pour s’appuyer dessus. Soil Capital met en place des programmes de rémunération carbone pour les agriculteurs, certifiés au standard ISO 14064 (un standard ISO pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou des améliorations de l’élimination), et les certificats ISO générés sont vendus par son partenaire South Pole.
La méthode Verra VCS
L’entreprise Verra a développé son propre programme – VCS – décrivant un ensemble de procédures pour calculer les réductions d’émission de gaz à effet de serre. Des méthodologies spécifiques sont ensuite déclinées par activités et secteurs (processus industriels, construction, déchets, transports…). On retrouve plusieurs méthodologies spécifiques à l’agriculture, dont notamment la méthodologie SALM (VM0017), et plus récemment, une méthodologie plus intégrée et généraliste – IALM (VM0042). Les méthodologies proposées sont révisées par Verra, mais aussi par des tierces parties indépendants. Une consultation publique est également mise en place. Les projets labellisés VCS sont également audités par une structure indépendante de Verra. L’entreprise n’est pas du tout impliquée dans les transactions de crédits carbone (Verra ne vend pas de crédits directement), les contrats étant mis en place hors du programme VCS.
Pour l’instant, la majorité des projets standardisés VCS se font dans le contexte forestier. Encore peu de projets sont orientés vers l’agriculture. Les méthodologies standardisées VCS sont à l’heure actuelle très orientées sur l’échantillonnage de sol (des révisions sont en cours pour combiner des mesures de sol et des modèles dynamiques), et sont très rigoureuses sur les exigences de vérification et de suivi
Limites et faiblesses identifiées des outils en place
D’un point de vue purement agronomique, le sujet carbone fait encore pas mal débats entre les principaux intéressés. Sans rentrer dans les querelles de clocher – et cet article de blog n’est pas un article scientifique – revenons rapidement sur les principaux points d’attention soulevés par la communauté (les points ne sont pas exhaustifs). L’objectif n’est pas ici d’y apporter une réponse claire mais plutôt de soulever un certain nombre de questions :
- Des progrès semblent nécessaires pour mieux simuler l’évolution du stock de carbone dans les horizons profonds et notamment prendre en compte de nouveaux mécanismes comme le « priming effect rhizosphérique« . Les racines font en effet des milliers d’exsudats en fonction du contexte dans lequel se trouve la plante. Dans le sol collé aux racines – on parle de sol rhizosphérique – le carbone pourrait être minéralisé 2 à 3 fois plus vite. Dans les modèles actuels, la quantité de carbone restitué par les sols pourrait donc être sous-estimée. Ce priming effect pourrait amener également à revoir les coefficients de minéralisation dans les sols.
- Certains reprochent aux données d’expérimentation de long-terme utilisés dans les modèles d’estimation carbone de manquer d’exhaustivité, avec trop peu de types de sol et de textures de sol considérées. Les résultats en station expérimentale sont parfois critiqués pour être en contradiction avec les résultats au champ chez des agriculteurs pionniers (pas les mêmes agro-équipements [semoirs…], pas les mêmes façons de travailler…). Plus spécifiquement, les modèles français d’estimation carbone ne seraient pas étalonnés pour des couverts végétaux à forte biomasse (dont la quantité de carbone stockée serait alors largement sous-estimée). Certains outils proposés actuellement permettraient néanmoins de pallier ce problème en multipliant artificiellement la fréquence de retours de culture. D’autres reproches reviennent sur le fait que le semis direct sous couvert ne serait pas considéré (le semis direct seul l’est). Les couverts végétaux utilisés ne seraient également pas assez profonds pour stocker de la matière organique en profondeur (manque de gestion de la compaction des sols). Les profils de matière organique dans les prairies ne seraient pas profonds dans le sens où les prairies sont coupées tout le temps (ou broutées).
- L’effet du non-labour sur le stockage/déstockage de carbone dans les sols est un sujet encore très débattu. Le dernier rapport de l’INRAE et des méta-analyses récentes laisseraient à penser que le non-labour n’aurait pas d’effet sur la quantité totale de carbone stockée, le carbone se répartissant sur l’entièreté du profil vertical de sol. Les opposants reprochent aux données d’expérimentation d’avoir été étudiées en considérant chaque pratique agricole (arrêt du labour, introduction de couverts…) de façon indépendante alors que ces pratiques auraient des effets combinés importants. Ces derniers rajoutent que l’effet du non-labour serait d’autant plus important que les sols sont déjà très riches en matière organique.
- Certaines pratiques agricoles, notamment la fertilisation et l’irrigation, viendraient en opposition avec le stockage de carbone dans le sol. La fertilisation et l’irrigation augmenteraient la minéralisation du carbone. Il y aurait donc un équilibre à trouver entre apport de fertilisation et niveau de rendement pour ne pas favoriser le déstockage. Ce dilemme pourrait notamment toucher les fermes en conversion bio qui, si elles ne passent pas par des intercultures fortes, pourraient être amenées à déstocker du carbone en apportant des engrais azotés. L’apport d’engrais azoté semble de toute façon nécessaire au départ pour atteindre l’état de volant d’autofertilité dont nous avons parlé plus haut.
- Il semblerait également y avoir un compromis entre le stockage de carbone dans le sol et les émissions de protoxyde d’azote.
- L’un des principaux leviers de réduction des gaz à effet de serre pour les exploitations en élevage – la diminution du cheptel – ne serait pas prise en compte dans certaines méthodes de cadrage de réductions d’émissions de gaz à effet de serre.
Quelques informations complémentaires
- L’INRAE et Planet-A développent l’indicateur SOCCROP pour suivre l’évolution du stock de carbone dans les sols agricoles
- L’organisation PADV (pour une agriculture du vivant) travaille sur un indice de régénération des exploitations. Cet indice n’est pas spécifique au carbone.
- Le réseau d’agriculteurs en agriculture de conservation des sols (APAD) a lancé le label « Au Coeur des Sols ».
- Quelques acteurs à suivre sur le sujet du carbone : MyEasy Farm, Soil Capital, AgroTransfert, Carbone Farmers, Rize Ag, Indigo, Nori, Truterra, Climate Action Reserve, TerraCarbon…
- Quelques informations sur les standards carbone
La mise en place d’un marché du carbone
Les grands principes de la rémunération carbone
Les marchés carbone sont soumis à un certain nombre de grands principes qu’il faut avoir en tête pour s’assurer qu’un euro dépensé aille vraiment vers un projet qui ait de l’impact :
- L’additionnalité : Pour démontrer l’additionnalité d’un projet carbone, il faut être capable de prouver que ce projet carbone n’aurait pas pu avoir lieu sans les aides et/ou financements proposés. En d’autres termes, il faut montrer que ce projet va au-delà de la tendance classique, de ce qui aurait été fait naturellement, ou encore de ce que la réglementation aurait imposé de toute façon. Si l’agriculteur ou autre bénéficiaire du projet a ses propres financements, il n’y a pas de raison qu’il obtienne un financement carbone puisqu’en quelque sorte, il aurait pu mettre en place ce projet tout seul.
- Le double compte : Il faut s’assurer qu’une action de réduction d’émission de GES ou de stockage de carbone mise en place dans le cadre d’un projet carbone ne sera pas comptée ni payée deux fois pour le prix d’une. Ce principe de double compte va être de plus en plus important parce qu’il va y avoir de plus en plus de compensation et de dispositifs qui vont se mettre en place. Un exemple concret : Une coopérative agricole fait en sorte que ses adhérents développent une filière bas GES. A qui reviennent les crédits carbone ? Aux adhérents qui ont réduit leur empreinte ? A la coopérative ? Ou peut-être encore au distributeur en aval qui aura imposé d’avoir un produit bas GES ? Et si un adhérent a plusieurs filières bas GES, comment partager le comptage carbone des actions qu’il aura mises en place pour ces filières sachant que certaines actions globales sur son exploitation auront servi aux deux filières ? On pourrait déjà effectivement permettre à cet adhérent d’exclure les émissions de l’une de ces cultures mais on ne sera pas totalement sorti de l’auberge. Comment une agro-industrie échange avec une autre industrie si une des deux veut financer un projet bas carbone ? Doit-on séparer une réduction d’émissions d’un stockage carbone ? Est-ce que les crédits stockés sont la propriété des agro-industries ? Si une agro-industrie finance un agriculteur et que ce dernier désire faire encore plus d’effort, faut-il alors générer de nouveau crédits ? Bref, un casse-tête comptable qui est loin d’être complètement réglé. En agriculture, ce sujet est extrêmement compliqué parce que le secteur est multi-subventionné, et que les acteurs sont nombreux. Comme le secteur alimente plusieurs marchés qui vont tous vouloir (devoir) se répartir des allocations d’émissions, la mission sera loin d’être évidente. Rajoutons à cela que s’il n’y avait qu’une seule méthode de comptage, on pourrait s’en sortir assez simplement. Mais quand plusieurs méthodes se mettent en place – on peut prendre l’exemple du Label Bas Carbone pour l’élevage, les grandes cultures ou encore la méthanisation – là, ça devient beaucoup plus compliqué. A noter par exemple que la méthode Carbon Agri va bientôt être mise à jour pour intégrer la méthode LBC Grandes Cultures. Pour se rassurer un peu quand même, il y a quand même certaines méthodes de réduction/stockage qui ne se chevauchent pas trop non plus, et qui permettront dans certains cas de ne pas se faire trop de nœuds au cerveau (par exemple entre le projet Carbocage sur les haies et le Label Bas Carbone pour les grandes cultures).
- La permanence ou la non-réversibilité: c’est bien de mettre en place une action de réduction d’émission ou de stockage carbone, encore faut-il que cette action soit durable dans le temps ! Premier exemple avec un projet forestier assez simple où je plante un arbre. Quand cet arbre pousse, hormis le fait qu’on le coupe, qu’on le brule, ou qu’il soit malade (ça fait déjà pas mal vous me direz), le stockage du carbone est durable. En agriculture, c’est un peu plus compliqué que ça parce que la stockage vient du fait que l’agriculteur va mettre en place des pratiques. Mais si cinq ans après, soit parce qu’il en a marre, qu’il vend son exploitation, ou d’ailleurs pour un tout autre tas de bonnes raisons, il réémet le carbone qu’il a participé à stocker, la permanence du crédit n’est plus assurée… Certaines méthodes imposent des rabais obligatoires pour prendre en compte ces aspects de non permanence ou de non réversibilité ; nous y reviendrons un peu plus loin.
Tous ces grands principes entrainent, directement ou indirectement un besoin de traçabilité à la fois de l’action et du financement de l’action. De nombreuses méthodes imposent d’ailleurs des conditions strictes d’audit et de vérifiabilité des projets, et ce de manière totalement indépendante par des auditeurs tiers. L’information et l’investissement doivent être tracés. Notons également l’importance de travailler à l’échelle du système ou de l’exploitation. Travailler culture par culture semble certes plus alléchant par sa simplicité – il est relativement facile de trouver des indicateurs de suivi environnemental pertinent – mais l’approche reste assez peu robuste aux effets de bords et aux impacts croisés entre cultures.
Les marchés du carbone
Les marchés obligataires ou réglementés au cours du protocole de Kyoto
En 2005, suite au protocole de Kyoto, trois principaux marchés du carbone sont apparus :
- Un Système d’Echanges de Quotas d’Emissions (SEQE en français ou ETS en anglais pour Emissions Trading Scheme). Vous avez peut-être déjà vu l’acronyme EU-ETS qui n’est en fait rien d’autre que le marché carbone européen d’échanges de quotas d’émission (European Emissions Trading Scheme). Gardez en tête que de nombreux pays ou regroupement de pays ont mis en place des systèmes d’échanges de quotas d’émission (Europe, Chine, Corée, Suisse…) mais que ces différents systèmes de quotas sont hermétiques (pour le moment, il n’est pas possible d’échanger des quotas entre des systèmes différents). Le système d’échanges de quotas d’émissions de l’Europe a été découpé en plusieurs phases au cours du temps (la 3ème phase va de 2013 à 2020 et la 4ème phase de 2021 à 2030). Ce système a été mis en place dans l’objectif de pousser les entreprises les plus polluantes (industriels énergivores, producteurs d’électricité…) à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à limiter leur empreinte carbone. Un quota d’émissions (ce qu’elles ont le droit d’émettre au maximum), appelé UQA pour Unités de Quantité Attribuée, est alors fixé par secteur. Les entreprises peuvent revendre des quotas si elles ont émis moins que ce qui leur est alloué, ou en acheter si elles ont émis plus qu’autorisé. L’idée étant de réduire au fur et à mesure le plafond d’UQA distribué pour que les entreprises émettent de moins en moins de gaz à effet de serre. Sur le marché européen, l’objectif de réduction à horizon 2020 par rapport à 1990 était de 20%.
- Un mécanisme de mise en œuvre conjointe ou MOC (Joint implementation en anglais). Dans ce marché MOC, les pays industrialisés, c’est-à-dire les pays de l’Annexe I du protocole de Kyoto (voir la première section de l’article), ont le droit d’acheter des réductions d’émissions à d’autres pays industrialisés au travers de crédits URE (unités de réduction d’émissions) générés par les projets MOC mis en place.
- Un mécanisme de développement propre ou MDP (ou Clean Developement Mechanism en anglais). Le principe du marché MDP est le même que le marché MOC à la grande exception qu’un pays industrialisé achète des réductions d’émissions à des pays émergents ou en voie de développement (des pays qui ne sont pas dans l’annexe I du protocole de Kyoto), et pas à d’autres pays industrialisés. Les crédits générés dans le cadre des projets MDP s’appellent des crédits URCE (unités de réduction certifiées d’émission). L’objectif était de donner la possibilité aux pays industrialisés de venir financer des projets dans les pays du sud et y réduire sur place leur émissions. Avec l’idée derrière la tête que les contraintes et coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays du sud seraient plus faibles que si ces réductions d’émissions avaient été mises en place dans un pays industrialisé. Ce mécanisme de développement propre (MDP) est néanmoins assez largement critiqué pour les incertitudes sur l’additionnalité des projets, la répartition sectorielle et géographique des projets, ou encore la gouvernance et l’éthique des projets mise en place (Demaze, 2013).
Les échanges de crédits carbone entre acteurs (acheteurs et vendeurs) peuvent avoir lieu soit sur des places de marché, directement ou via un intermédiaire, ou de gré à gré. Ces trois marchés-là, SEQE, MOC et MDP, sont considérés comme des marchés carbone obligataire (ou réglementés) dans le sens où les états et entreprises sont soumis à des objectifs et des contraintes de réduction d’émission. Vous l’avez peut-être déjà compris mais ces trois marchés sont sensiblement différents outre le fait qu’il s’agit à chaque fois de comptabiliser des tonnes d’équivalent CO2. Au sein d’un système d’échanges de quotas d’émission (SEQE), les entreprises et pays échangent des quotas d’émission (ok, on est pas bien avancés…). Ces quotas d’émission (nous avons parlé des UQA : unités de quantité attribuée) sont en quelque sorte des droits à polluer. Mais il faut bien se rendre compte que ce sont des droits à polluer dans le futur. Au contraire, dans le cadre des marchés MOC et MDP, les pays et entreprises achètent des crédits de réductions d’émissions (URE ou URCE) qui sont en fait des compensations d’émissions qui ont déjà eu lieu. Ce ne sont donc pas des droits à polluer dans le futur mais bien de la compensation dans le passé.
Le système d’échanges de quotas (SEQE) ne s’applique qu’aux secteurs les plus polluants. Tous les secteurs n’y sont pas soumis et n’ont donc pas les mêmes objectifs et réglementations à respecter. A côté de ce système d’échanges de quotas, on trouve deux autres politiques climatiques pour l’Europe (qui ne sont pas des systèmes de quotas):
- La politique du partage de l’effort, désigné par l’acronyme ESD (Effort Sharing Decision) sur la période 2013-2020, puis ESR (Effort Sharing Regulation) pour la période 2021-2030. Les secteurs contraints par ce partage de l’effort (transport, bâtiment, agriculture, déchets) sont soumis à des plafonds annuels d’émissions, exprimés en pourcentage par rapport aux émissions de 2005. D’ici 2030, les émissions de ces secteurs-là devront être réduites de 30%.
- La politique de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF, parfois simplifié en UTCF) qui correspondent aux variations de stock du carbone des sols et de la forêt. Le secteur UTCF est actuellement le seul qui permet de réaliser des émissions négatives grâce aux puits de carbone naturels : la biomasse (forêts, haies, agroforesterie…) et les sols (sols agricoles…). On parle de LULUCF en anglais (Land use, Land use change and forestry).
Les objectifs européens sont ensuite déclinés dans chacun des pays, qui les déclinent ensuite par secteur. Chaque entreprise de son secteur (SEQE, ESR ou UTCATF) a donc des objectifs de réduction différents à atteindre. Il faut savoir néanmoins qu’un certain nombre de mécanisme de flexibilité, censés aider les pays et entreprises à atteindre leurs objectifs, ont été mis en place. Il est par exemple possible de reporter des crédits d’une période à une autre : les systèmes d’échanges de quotas d’émissions ont été défini sur plusieurs périodes différentes – il serait alors possible de reporter un crédit par exemple de la période 2013-2020 à 2021-2030. En reportant un crédit, on s’abstrait donc de l’obligation de rembourser sa dette carbone à un moment donné, et on part du principe qu’on le réduira plus tard. Il serait même possible dans certains cas de financer des crédits d’un secteur avec les crédits d’un autre secteur. On pourrait par exemple financer les crédits du secteur ESR avec ceux du secteur SEQE ou UTCATF. Sur le principe, on pourrait ne pas y voir d’inconvénient sauf que certains de ces secteurs sont ou ont été largement excédentaires en crédits (et pas forcément pour les bonnes raisons, nous en rediscuterons un tout petit peu plus loin) ce qui veut dire qu’il est assez facile de déplacer des crédits entre secteurs et ne pas engager une transition bas carbone. Chaque marché carbone gère la façon dont les crédits peuvent être utilisés. Des crédits URCE (projets MDP) ou URE (projets MOC) peuvent par exemple être utilisés pour respecter une partie des obligations que des pays peuvent avoir dans le cadre d’un système d’échanges de quotas (il faudra alors annuler une UQA pour générer un URE de façon à ne pas comptabiliser deux fois des réductions d’émissions). A côté de ça, il semblerait que la Commission européenne définisse des points de départ de réduction d’émissions théoriquement plus haut que ce qu’ils ne sont réellement, rendant d’autant plus facile l’atteinte des objectifs fixés (CCFD-Terre Solidaire, Réseau Action Climat 2020).
Le prix des quotas d’émission sur le marché d’échanges des quotas a connu des variations assez importantes de prix (voir Figure 8), et ce pour plusieurs raisons. La première est qu’un certain nombre de quotas d’émission sur le système d’échanges de quotas étaient alloués gratuitement. Vu comme ça, on pourrait hurler au scandale dans la mesure où si l’on vend gratuitement des droits à polluer, comment imaginer que les entreprises réduisent d’elles-mêmes leurs émissions. En Europe, l’explication était à trouver dans le fait que des crédits alloués gratuitement aux entreprises européennes pouvait éviter de pénaliser l’industrie européenne par rapport à ses concurrents, et éviter une fuite de carbone (ou Carbon Leakage en anglais). La deuxième raison importante était que d’une part les objectifs initiaux de réduction du protocole de Kyoto étaient assez faibles et donc facilement atteignables et que d’autre part la crise économique de 2008-2009 avait fait naturellement diminuer les émissions carbonées d’un certain nombre de pays. Résultat des courses, les entreprises avaient beaucoup de quotas à vendre et le prix des quotas s’est effondré, en suivant simplement le principe de l’offre et la demande. Le prix de ces quotas carbone a chuté jusqu’à quelques euros, et il est resté encore très bas jusque récemment (Figure 8). Pour faire remonter ce prix du carbone, deux mécanismes ont été mis en place il y a quelques années : un mécanisme d’achat des quotas aux enchères et un mécanisme de réserve (Market Stability Reserve). Le mécanisme de réserve permettant notamment de sortir des quotas en trop du marché (et baisser artificiellement l’offre de crédits donc remonter les prix), pour potentiellement les remettre sur le marché plus tard. Pourrait-on également imaginer un prix plancher du carbone pour éviter ces écueils ?

Figure 8. Variation des prix du carbone sur le système d’échanges de quotas d’émission européen. EUA signifie European Allowances (c’est à dire les quotas d’émission européens)
La gouvernance du système d’échanges de quotas que nous venons de présenter a été établie jusqu’en 2018. La quatrième phase du système d’échanges sur les quotas (2021-2030) est censée initier un certain nombre de changements. Le plafond d’émissions de quotas distribués continuera à diminuer, mais à un rythme plus important que précédemment (de 1.74% par an, il passera à 2.2%). Les quotas alloués jusqu’ici gratuitement le seront toujours sur cette nouvelle période de dix ans, principalement pour les secteurs les plus exposés au risque de délocalisation de leur production en dehors de l’Union Européenne. Les secteurs moins exposés, quant à eux, verront leur quantité de quotas gratuit diminuer, jusqu’à être supprimés définitivement en 2030, à la fin de la phase 4 du système d’échanges de quotas. Au vu de ces contraintes assez fortes de diminution d’allocations gratuites de quotas depuis l’Accord de Paris, la cinétique d’investissement est plus faible que cette régulation. La demande en quotas devient importante et comme l’offre est faible, le prix du carbone monte – toujours en suivant le paradigme classique de l’offre et de la demande. Sur le marché obligataire, la tonne de carbone tourne actuellement autour de 60€. Encore une fois, gardez en tête que le secteur de l’agriculture n’est pas intégrée dans le système d’échanges de quotas (elle fait partie du secteur ESR – Effort Sharing Regulation), l’objectif étant de forcer les entreprises sous quotas à réduire par eux même en investissant sur leur impact carbone.
Les projets MDP auraient dû voir leurs jours terminés au début de l’année 2021, c’est-à-dire à la fin de la deuxième période d’application du protocole de Kyoto. Je vous rappelle que l’Accord de Paris est censé avoir pris le relai du protocole de Kyoto depuis le 1er janvier 2021. Il avait été décidé au départ que les projets MDP se transforment en projet MDD – mécanismes de développement durable (en général, quand on commence à entendre parler de développement durable, ça sent pas très bon…). Se sont alors posées quelques questions : Mais qu’est-ce qu’on va faire des projets MDP déjà en cours ? Faut-il les maintenir ou les annuler ? Comment transférer les crédits de projets MDP vers des projets MDD ? Comment comptabiliser correctement les crédits pour être sûrs qu’ils ne soient pas comptés deux fois, à la fois pour le pays financeur du projet et le pays qui met en place le projet chez lui ? Il faut bien comprendre qu’avant l’Accord de Paris, dans le cadre du protocole de Kyoto, certains pays s’étaient engagés à réduire leurs émissions (pays de l’Annexe I) alors que d’autres pays, dits non industrialisés (pays hors Annexe I) ne l’avaient pas fait. Les projets MDP permettaient alors à des pays de l’annexe I d’aller financer des projets dans les pays hors annexe I. Avec l’Accord de Paris, comme tous les pays se sont engagés à une réduction d’émissions, le principe des projets MDP n’a plus vraiment de sens. Les dernières COP (les n°24 et 25) n’ont pas permis d’aboutir à un concensus clair et de décider réellement ce qui serait fait de ces projets MDP. La COP26 est attendue pour régler ce problème. Un consensus provisoire a néanmoins été établi : les demandes de projets MDP depuis le 1er janvier 2021 seront toujours enregistrées mais leur approbation sera provisoire. Ils seront définitivement acceptés seulement si, à l’issue de la COP-26, il est décidé que le mécanisme MDP est maintenu.
Les marchés volontaires au cours du protocole de Kyoto
Assez intuitivement, les marchés volontaires se distinguent des marchés obligataires dans le sens ou des pays ou entreprises engagent des réductions d’émissions sans y être contraint par un cadre réglementaire particulier. Ces marchés permettent donc à ceux qui ne sont pas soumis au système d’échanges de quotas de participer eux aussi à des échanges de crédits carbone. L’ensemble des crédits générés sur les marchés volontaires restent néanmoins largement plus faibles que ceux générés sur les marchés réglementés.
Un certain nombre de cadres de certification volontaires – comme par exemple le Label Bas Carbone – sont en train de se mettre en place. J’insiste ici sur le fait qu’il ne faut pas confondre les cadres de certification volontaire avec un système de taxation, ce sont bien deux choses différentes (nous en rediscuterons juste après). Dans le cadre de la certification volontaire, les crédits sont générés de gré à gré et une relation se construit entre un investisseur (celui qui achète des crédits carbone), un porteur de projets ou mandataire (celui qui organise, facilite et coordonne un projet bas carbone) et un réalisateur (celui qui met en place le projet, souvent un acteur de l’agriculture dans notre cas ici).
Deux exemples seront peut-être plus parlants :
- L’entreprise Soil Capital se positionne en tant que porteur de projets, entre agriculteurs et acheteurs de crédits carbone. Soil Capital démarche les agriculteurs, calcule les potentiels de crédits carbone à l’aide de l’outil Cool Farm Tool, certifie les crédits avec son partenaire South Pole (expert de la rémunération carbone), ce dernier vendant ensuite les crédits générés à des entreprises privées qui veulent acheter des crédits carbone. Soil Capital achète les crédits à 27€ (les agriculteurs sont donc rémunérés à 27€ la tonne de carbone) et les revend, via son partenaire South Pole à une quarantaine d’euros aux acheteurs de crédits.
- L’association France Carbon Agri a pour objectif de faciliter la mise en œuvre de la méthode Carbon Agri. L’association organise des appels à projets pour que des groupes de producteurs (associations de producteurs, coopératives…) accompagnent des projets de producteurs pendant la durée de la labellisation. France Carbon Agri forme et accompagne à l’utilisation de la méthode Carbon Agri et de l’outil Cap’2ER, et assure la certification des projets via le certificateur Bureau Véritas. France Carbon Agri s’occupe ensuite également de vendre les crédits carbone générés. Ces crédits sont vendus à l’heure actuelle à 38€ la tonne de carbone, dont 30€ vont dans les mains des agriculteurs.
Est-il alors possible de créer une fongibilité ou un lien fort entre les marchés obligataire et volontaire ? C’est visiblement en cours de réflexion. Le problème de double comptage est toujours prépondérant. Prenons l’exemple des amidonniers ou malteurs qui sont sous quotas par le fait même de leurs usines énergivores mais qui se fournissent aussi depuis le secteur de l’agriculture. Leur impact vient donc aussi de l’agriculture (et c’est notamment le cas de la majeure partie de leur Scope 3). On peut néanmoins se demander si l’ouverture des crédits du marché obligataire vers ceux du au marché volontaire ne va pas rajouter une complexité importante aux systèmes en place, et rendre encore plus difficile le montage de projets et/ou l’accès aux crédits carbone. Comme nous allons le voir juste après, il existe énormément de dispositifs de financement possibles dans le cadre du marché volontaire, et ces mécanismes se suffisent peut-être à eux-mêmes.
Comment les marchés carbone évoluent à la suite de la COP26 ?
La COP26 à Glasgow a eu lieu courant octobre 2021. Elle a été l’occasion de revenir largement sur l’article 6 des Accords de Paris, qui traite principalement de la manière dont vont être comptabilisées les réductions d’émissions (la mise en place des marchés et mécanismes d’échanges de crédits carbone)
Pour ne pas trop obstruer ce dossier de blog déjà assez long, j’en ai rédigé un spécial sur les retours de la COP 26. Je vous invite à lire ce cours complément d’informations
Les modes de financement annexes
Le cadre de certification volontaire est intéressant, c’est sûr, mais il faut garder à l’esprit que c’est un auditeur indépendant qui permettra de générer des crédits et ensuite de les vendre, et ce dans un délai relativement long, 5 ans voire plus. On peut donc imaginer plein d’autres mécanismes en place pour éviter de toute faire reposer sur l’agriculteur.
Taxe
Une des premières choses à laquelle on peut penser, c’est la taxe ! Il y en a tellement de différentes, pourquoi ne pas en mettre une pour le carbone ? Et on pourrait par exemple alors utiliser l’argent de cette taxe pour financer des projets à fort impact environnemental. Aujourd’hui, il existe une taxe sur les produits pétroliers et l’agriculture en est exempt. Il a été proposé très récemment de monter cette taxe sur les carburants, tout le monde connait la suite… Petit indice, c’est jaune. La taxe sur les carburants a été gelée par la suite à 44€. Il semblerait pour l’instant qu’on puisse oublier la solution sur la taxation
Aides – Interventions de l’état
L’état peut également directement intervenir. Ca a été récemment le cas avec la mise en place des « Bons Diagnostic Carbone » en 2020. La démarche était fléchée directement vers les agriculteurs récemment installés avec l’objectif de faire un bilan de gaz à effet de serre sur l’exploitation puis de définir un plan d’action pour orienter vers les leviers d’amélioration de la performance carbone de l’exploitation. Avec 10 millions d’euros sur la table, l’ambition est de réaliser environ 5000 diagnostics carbone d’exploitation – à hauteur de 2000€ par exploitation (soit sur 7% du total des fermes détenues par des agriculteurs récemment installés). La démarche est ici encadrée et accompagnée sur le terrain – les agriculteurs ne sont pas laissés complètement à l’abandon face à ce diagnostic. Ces bons diagnostic carbone ne s’inscrivent pas dans une logique de vente mais bien d’accompagnement de la transition. A voir par la suite comment cette dynamique peut être canalisée d’une part (et poursuivie dans le temps) et comment ces schémas peuvent être ouverts au plus grand nombre. Le diagnostic n’est pas vu comme une fin en soi mais bien comme le début de quelque chose de plus grand, d’une transition profonde. On pourrait néanmoins questionner l’ambition de l’état. Dix millions d’euros, c’est déjà une somme certes, mais le public touché reste quand même assez faible.
Faut-il inciter ou rendre obligatoire la décarbonation de l’agriculture ? La question reste ouverte. On pourrait arguer que l’état devrait être là pour créer des incitants et ainsi encourager les agriculteurs à intégrer des programmes de réduction de GES. Une bonne manière de le faire est effectivement de financer des diagnostics, de la même manière que cela pourrait être le cas chez les particuliers. L’état pourrait également défiscaliser un certain nombre de choses sur les transactions carbone (pas de TVA, transactions déductibles des revenus taxables pour les agriculteurs et éventuellement déductibles des impôts pour des acheteurs). Tout cela pouvant avoir un effet catalytique important.
Primes filières
Le principe d’une prime filière est lui aussi assez séduisant dans la mesure où les acteurs de l’aval ont tout intérêt à financer la décarbonation de l’agriculteur, et les filières cherchent bien évidemment elles-aussi à réduire leur empreinte carbone. On observe déjà des primes filières pour un certain nombre de cultures, comme pour le colza ou le tournesol. Certaines primes sont aussi redistribuées pour faire du biocarburant (il existe aussi des contraintes d’incorporation en volume dans le carburant fossile) par exemple dans la mesure où plusieurs directives européennes poussent à l’introduction de colza, d’oléagineux ou de tournesol pour faire du biodiesel. La façon de proposer la prime est elle aussi à réfléchir. On pourrait par exemple mettre en place une prime aux couverts végétaux ou alors mettre une prime au carbone en considérant que le carbone stocké est proportionnel au couvert introduit. On passe alors d’une prime de pratiques à une prime bas carbone, ce qui peut être totalement différent pour des actions de communication, et également pour la rémunération associée surtout si le prix du carbone augmente. La nuance est fine certes, mais le diable se cache toujours dans les détails. Deux exemples :
- L’entreprise Nataïs a remplacé une prime filière sur les couverts végétaux par une prime carbone. Les crédits générés ne sont pas encore vendus sur le marché volontaire parce qu’ils ne sont pas certifiés.
- L’entreprise Saipol organise son sourcing des graines de colza et tournesol avec des propriétés de réduction de gaz à effet de serre, graines qui sont ensuite valorisées sous forme de biocarburants. Saipol achète la graine à un intermédiaire (coopératives, négoces) en majorité (80-90%) ou à un agriculteur pour la triturer. L’entreprise a mis en place son offre Oleoze. Un bonus pour les gaz à effet de serre est rétribué à l’agriculteur en fonction des résultats d’un calculateur interne à Saipol s’inspirant d’une approche d’analyse en cycle de vie. Oleoze rémunère les producteurs jusqu’à 24€ par tonne de carbone. La rémunération suit un gradient (de 0 à 24€) en fonction des pratiques mis en œuvre et des calculs de réduction effectués. Les crédits sont certifiés 2BSvs, et vendus à des client pétroliers (les utilisateurs finaux du crédit).
A noter que ce système de graduation (celui utilisé par Saipol par exemple) est également intéressant pour les entreprises qui n’auraient pas de fonds propre suffisamment importants pour financer des projets conséquents. Ces entreprises pourraient mettre sur la table un montant en fonction de ce qu’elles sont prêtes à donner, et le porteur de projet ou l’agriculteur en face pourrait décider de mettre en place un certain nombre d’actions pour le prix proposé. Nous en avons déjà parlé mais un problème récurrent avec les primes filières est à nouveau celui du double comptage – le fait de savoir à qui profite la réduction de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la LBC, la méthodologie pour les biocarburants n’est pas encore sortie mais le LBC accepte pour l’instant le cumul des rémunérations au niveau de l’agriculteur.
Primes produit
Contrairement à la prime filière qui rémunère les agriculteurs pour une culture/produit encadrée dans une filière spécifique, la prime produit rémunérerait l’agriculteur pour le simple fait de mettre en place cette culture/produit. On n’en parle encore pas trop. Déconnecter la rémunération du produit permet en effet peut-être aussi d’avoir une vision plus globale de l’exploitation et d’accompagner des changements de pratiques. Mettre en place des actions pour qu’un produit voit ses émissions diminuer est une bonne chose en soi, tout dépend ce qui en est fait par la suite. Si l’on baisse les émissions d’un produit pour en faire encore plus, est ce que ça a vraiment du sens ?
Paiements environnementaux
Quand on pense au terme carbone, on pense à l’environnement et on se dit qu’il existe déjà des paiements à ce sujet : HVE (Haute valeur environnementale), MAEC (Mesures agroenvironnementales et Climatiques), Paiements vers de la PAC, Aide à l’agriculture biologique…. Pourrait-on alors imaginer jouer sur la complémentarité de ces aides pour les cumuler et/ou les fusionner ? La question qui se pose est de savoir si ces aides considèrent déjà ou non le carbone, au risque de rentrer en contradiction avec le principe d’additionnalité du marché carbone dont on a discuté. Si des MAEC sont par exemple ciblées sur des pratiques déjà traitées dans le cadre du LBC, il faut montrer que ces aides ne sont pas suffisantes pour déclencher ces pratiques et/ou que la MAEC permettra d’aller plus loin que le LBC pris isolément. On trouve par exemple en Bretagne des MAEC sol où les agriculteurs mettent en place des pratiques assez proches de l’agriculture de conservation des sols, et sont rémunérés pour suivre ce cahier des charges. Une certaine perméabilité est en train de se mettre en place. Néanmoins, peut-on accorder autant de valeur à un label donné à un produit ou à une exploitation qu’à un cadre de certification volontaire sur le carbone ? Tout dépend en réalité de la confiance que les acheteurs de crédit mettront dans ces labels. Nous en avons discuté mais de grands débats sont en cours autour de la nouvelle PAC pour savoir comment vont se structurer les futurs éco-régimes. Mais peut-on réellement attribuer des crédits carbone à une exploitation certifiée HVE ou bio ? L’encadrement des pratiques y est totalement différent. Privilégiera-t-on un accès facilité à des aides carbone pour l’agriculture, indépendamment de la capacité à réduire les émissions ou à stocker du carbone dans les sols ?
Cofinancement
Au vu du prix actuel du carbone sur le marché volontaire en France (autour de 40-50€ la tonne à la mi 2021), on peut vraisemblablement se demander si les entreprises privées seront prêtes à en payer le prix. On peut émettre de sérieux doutes et alors s’inquiéter que le marché volontaire ne puisse pas absorber les crédits carbone émis (avec le risque que le prix du carbone s’effondre si l’offre est supérieure à la demande). Il y aurait donc peut-être besoin pour l’instant de co-financement, à la fois entre différents mécanismes (ceux que l’on a vus plus haut) mais aussi différents financeurs. La diversification des sources de financements permettrait effectivement de faire monter en puissance une orientation bas carbone de l’agriculture. Il faudra veiller à éviter une situation où concrètement, sur le terrain, les agriculteurs auront à choisir entre des financements privés ou des financements publics. Il faut envisager des financements territoriaux (paiements de la région, prise en charge de diagnostics carbone, prise en charge des coûts de transaction…) – qui ne seraient pas d’ailleurs fléchés que sur le carbone – un engagement local avec des entreprises ou associations qui veulent faire changer les choses, ou encore des primes filières si les industriels de l’agroalimentaire valorisent mieux les produits bas carbone ou s’ils arrivent à mieux communiquer avec leur politique RSE. Avec le temps, certains projets pourraient être cofinancés par d’autres entreprises parce que le financeur initial ne pourrait pas assumer tout seul le projet (ex : augmentation du nombre de producteurs). Si un projet est mis en place sur un co-produit qui n’est pas assez structurant pour l’entreprise, la recherche de co-financement pourrait être très pertinente pour éviter que l’entreprise ne se désengage.
Quelques éléments complémentaires
On commence à voir de nombreux acteurs émerger sur le secteur du carbone. On peut en premier lieu se rassurer parce que ça confirme déjà qu’il y a un marché et que ça commence à intéresser pas mal de monde. Le défi sera de trouver un équilibre entre ce qui est solide et crédible pour les marchés et ce qui est pratique pour les agriculteurs. Et bien évidemment ce qui fait vraiment la différence sur les gaz à effet de serre réduits ou évités…. Le risque qui ne pourra être testé que sur le terrain, c’est celui de savoir si le programme mis en place sera suffisamment acceptable par le reste des parties prenantes (pas trop de charges administratives et prohibitives…) pour être reconnu dans la durée comme un quelque chose qui fonctionne qui fonctionne.
Pour pouvoir se mettre sur le marché du carbone volontaire, pas de choix, il faut avoir des standards et que les crédits soient certifiés. Enfin, n’importe qui pourrait émettre des crédits non certifiés, mais il y a relativement peu de chances que quelqu’un les achète. Le marché est plutôt une bonne manière d’avoir des financements de projets sur le long terme parce qu’il renforce la mise en œuvre et le contrôle du projet (ou tout du moins il en donne l’impression…). Tout ce qui tourne autour des standards a tendance à rassurer et à donner confiance : vérifiabilité des crédits, auditeurs tiers indépendant, transparence des crédits, crédibilité des labels… Il faut envisager le carbone comme un levier de financement. Dans le cadre de projets d’aide au développement, certains diront même que ce levier permettrait de changer la logique actuelle d’être à l’affut des bailleurs de fonds et de toujours devoir répondre pour s’assurer un revenu, par quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir de devenir producteur d’une marchandise non palpable. En devenant producteur de cette nouvelle marchandise, on peut alors vendre ce carbone sur du marché de long terme (si le marché ne se casse pas la gueule, bien évidemment), permettant alors de s’indépendantiser des bailleurs et d’autres sources de financement comme l’aide au développement.
Est-ce que les entreprises voudront néanmoins financer des projets carbone en amont ? Est-ce qu’elles ne préféreront pas attendre de pouvoir acheter des actifs carbone une fois certifiés ? Le débat reste ouvert… Certains acteurs territoriaux pourraient prendre le risque en propre en préfinançant des projets ou en pré-achetant des crédits, et les revendre une fois les crédits certifiés. Un acteur territorial ou une entreprise pourrait dire à un agriculteur : « tu t’engages à introduire tel ou tel levier, et on considère que tu vas générer X crédits carbone. Je t’en préfinance Y et tu auras le reste à la fin si tu as mis en place tout ce sur quoi on s’est engagé ».
Tentons de prendre un peu de recul
Le sujet du carbone en agriculture est clairement d’actualité, et les agriculteurs y sont donc très directement ou indirectement impliqués. Mais leur a-t-on vraiment demandé leur avis ? Ressentent-ils le besoin de s’investir sur cette problématique ? On pourrait déjà commencer par répondre que les agriculteurs ont un besoin fort de reconnaissance des pratiques qu’ils mettent en œuvre. La rémunération est bien sûr importante mais la reconnaissance de leur travail sur le terrain, et ce jusqu’au citoyen est fondamentale. L’agribashing des dernières années doit évoluer vers une considération des agriculteurs et une communication positive. Et le carbone pourrait être un des leviers vers cette reconnaissance puisque des pratiques de stockage de carbone dans les sols pourraient montrer aux yeux de tous l’implication des agriculteurs dans la lutte contre le déréglement climatique : « Regardez, avec mes pratiques agricoles, j’ai réussi à stocker 50 tonnes de carbone dans le sol. Et vous, qu’est ce que vous avez fait de votre côté ? »
D’un autre côté, de plus en plus d’agriculteurs se retrouvent dans des impasses agronomiques, et le carbone, par l’ensemble des co-bénéfices qu’il apporte au sol, est une voie d’entrée particulièrement pertinente. Il faudra néanmoins garder son attention principale sur la qualité des sols et pas seulement sur le carbone. Si l’on veut juste mettre du carbone dans les sols, autant ne pas s’embêter et y mettre des pneus usés – tout le monde sera néanmoins d’accord pour dire que ça n’arrangera pas beaucoup l’état du sol sur la planète. Il faut garder avant tout une logique globale de qualité des sols et pas une logique purement économique comme cela pourrait arriver avec le carbone. Les marchés et les crédits carbone sont un plus, certes non négligeable, mais ils ne feront jamais tout tout seul. Il faut les voir en réalité comme une contribution à un projet de transformation d’exploitation agricole visant d’autres objectifs. Ces mécanismes carbone devraient être mis à côté de la qualité des sols parce que cela permettrait d’avoir des incitations sur la qualité des sols, et il y aura sans aucun doute un effet indirect sur le carbone. Tout cela n’empêchera pas d’avoir de rémunération carbone. Dire seulement à un agriculteur qu’il faut financer sa transition carbone, c’est une manière cachée de le faire s’endetter encore plus ou de lui faire rajouter du capital, et dans le meilleur des cas de le subventionner, mais ce n’est pas un moyen de lui donner son autonomie économique. Il faut favoriser la création d’un chiffre d’affaires issu du revenu du carbone, mais il faut également admettre qu’après un certain temps, l’agriculteur continuera les pratiques qu’il aura mis en place, et ce même sans revenu du carbone (dans la mesure où on finira peut- être tout le temps par être en contradiction avec le principe d’additionnalité des aides). Le revenu du carbone est simplement une cerise sur le gâteau.
L’entrée par le volet environnemental permettra alors d’appuyer sur des volets agronomiques forts et sur des volets économiques importants. La transition bas carbone est néanmoins très technique et va demander beaucoup d’accompagnement humain des agriculteurs. Les structures qui ont acquis de nombreuses connaissances sur le sujet vont devoir redoubler d’effort sur le terrain. Et il pourrait d’ailleurs être complètement légitime que le financement de cet accompagnement soit mis en place par la collectivité dans le sens où elle va en bénéficier indirectement. Mais comment faire en sorte que les agriculteurs se sentent vraiment impliqués dans des projets de réduction d’émissions ou de stockage de carbone ? Et comment faire en sorte que les agriculteurs bouleversent ou transforment en quelques sortes leur pratiques, et ne se contentent pas d’optimiser certaines de leurs façons de faire, qui ne sont pas forcément les plus pertinentes pour engager les leviers bas carbone ? Le débat est assez ouvert entre des mécanismes favorisant une obligation de moyens (on juge les pratiques en place) ou une obligation de résultats (on regarde ce qui a été fait à la fin). Les partisans de l’obligation de résultats auraient tendance à dire que ce mécanisme pousse à la pratique innovante, aux initiatives, et à la créativité. Les agriculteurs inventent et ont besoin de partager. L’agriculteur deviendrait réellement acteur de son système et, après mûre réflexion, pourrait appréhender et imaginer de nouvelles pratiques à mettre en place. Cela permettrait également d’éviter le risque d’effet d’aubaine, de garantir l’efficacité du financement et d’éviter de faire face à des réglementations pas toujours bien pensées (par exemple, ne pas planter un couvert avant ou pendant une pluie juste pour respecter une réglementation). Pour les partisans de l’obligation de résultats, il n’existe de toute façon pas de cahier des charges de moyens qui permette d’arriver au résultat parce que toutes les exploitations sont différentes. Les partisans de l’obligation de moyens auront plutôt tendance à dire que le suivi de pratiques préconisées est beaucoup plus simple que du suivi de résultat, et que ce mécanisme permet de diffuser le plus largement possible les pratiques jugées les plus pertinentes. Un rapport récent de l’I4CE semble néanmoins montrer que l’obligation de résultats ne serait pas nécessairement plus coûteuse à instruire et à contrôler qu’une obligation de moyens (la répartition des coûts est par contre assez différente entre les coûts de conception, de fonctionnement administratif, de suivi et de de vérification). Selon ce même rapport, ce ne serait pas tant le débat entre obligations de moyens et de résultats auquel il faudrait s’intéresser, mais bien à l’ambition des mesures proposées.
La rigueur des outils et des méthodes de suivi carbone est fondamentale, c’est certain. Mais il faut s’accorder sur le fait qu’aucun projet ne verra le jour si les dispositifs à mettre en place sont d’une lourdeur administrative insupportable et si les outils proposés ne sont pas un minimum ergonomiques. Qu’en est-il réellement de la complexité ou de la lourdeur de monter un dossier pour faire labelliser son projet ? Qu’en est-il du temps à passer sur le diagnostic initial du projet ? Ce ne doit pas et ne peut pas être une usine à gaz. Comment simplifier alors les programmes proposés ? Peut-être en proposant certains cadres déjà pré-organisés. Pourrait-on imaginer un modèle un peu dirigiste où le porteur de projet proposerait par exemple 3 pratiques à mettre en œuvre, que l’agriculteur signerait ou ne signerait pas ? Ou encore proposer 2-3 projets différents (date de paiements, prix, financeurs, propriété des données…) aux agriculteurs en leur demandant de choisir leur préféré ? Ou encore, devrions-nous pousser sur un modèle plus ouvert ou tous les leviers bas carbone sont présentés sur la ferme et chaque agri fait un peu son choix à la carte ? Ou alors, peut-être faut-il se tourner vers le système des primes (ex des primes filières) qui sont plus souples à mettre en œuvre ?
Les coûts et risques d’un projet carbone
Est-ce qu’un projet carbone coûte cher à mettre en place ? C’est une question à laquelle il n’est pas évident de répondre. Le point de blocage actuel peut-être le plus important est que le modèle économique associé aux marchés carbone n’est pas encore stabilisé. La majorité du marché actuel se concentre autour du marché carbone obligataire. Sur le marché volontaire, les gammes de prix, en fonction des pays et des projets sont assez larges. En France, sur le marché volontaire, il y a certes des projets de proximité à financer avec des valeurs de crédits pouvant aller autour de 40-50€ la tonne de carbone mais cela reste peut-être encore un marché de niches. Quelle est la profondeur réelle de ce marché ? Y a-t-il vraiment la possibilité de déployer de grands projets sur de grandes surfaces ? Si l’on croit à la transition carbone qui se met en place et que l’on croit également à une compensation volontaire, les prix vont augmenter. Et il sera alors très important d’organiser, d’administrer, et de mettre en place un marché carbone avec une utilité. Les agriculteurs voudront peut-être néanmoins attendre un peu que les prix augmentent, ou qu’un plus grand nombre d’entreprises commencent à s’engager sur le dossier carbone. Mais à attendre trop, n’y a-t-il pas un risque que les pratiques en place ne soient plus considérées comme additionnelles et ainsi venir en contradiction avec les 3 grandes principes de rémunération carbone dont on a parlés plus haut ?
En attendant, pour l’agriculteur, l’engagement dans une transition décarbonée complète coûte assez cher. On peut réfléchir la chose en termes de coût économique à la tonne de carbone stockée (voir tableau 1, et revoir les figures 4 et 5). Toutes les techniques qui peuvent être mises en place sont des prises de risques, et, ces risques, les agriculteurs n’ont pas envie de les prendre tout seuls, surtout que certains cadres de certification génèrent des crédits au bout de 5 ans de projet. Et c’est d’autant plus le cas des agriculteurs dans une situation économique assez peu évidente, devant enclencher une transition, et qui ne peuvent pas prendre nécessairement ce niveau de risque financier. Certaines pratiques très vertueuses vont coûter très chères – on peut par exemple penser à l’implantation de prairies intermédiaires pendant laquelle il n’y aurait pas de biomasse de céréales, ou à l’essai d’un nouveau couvert. De manière générale, les pratiques vertueuses sont connues – sauf certaines un peu innovantes – mais ces pratiques ne sont pas toujours mises en oeuvre soit parce que le coût d’investissement est trop élevé, soit parce que les agriculteurs ressentent un risque important associé à ce changement de pratiques. Ce qui est important est d’organiser et de hiérarchiser les leviers pour accélérer l’augmentation de la matière organique dans les sols. Les agriculteurs doivent également avoir le choix d’aller à leur rythme en fonction de leur niveau de risque.
Ces agriculteurs devront bénéficier d’un soutien économique et l’ensemble des mécanismes de financement présenté plus haut devra être articulé de façon intelligente et leur mise en place devra rester flexible. L’exemple du plan de relance proposé par le gouvernement est intéressant mais les Bons diagnostic carbone ne s’adressent qu’aux jeunes agriculteurs, et le montant total alloué aux projets reste quand même assez faible au vu de la proportion d’agriculteurs français. La question fondamentale à poser est de savoir si, au final, le jeu de se faire labelliser par un mécanisme existant et/ou de monter des projets carbone permettra de compenser les surcouts de mises en place d’actions bas carbone pour l’agriculteur.
Tableau 1 : Récapitulatif des coûts par pratique, en moyenne au niveau national, selon que l’horizon de stockage considéré est 0-30 cm ou l’ensemble du profil. Source : INRAE, 2019
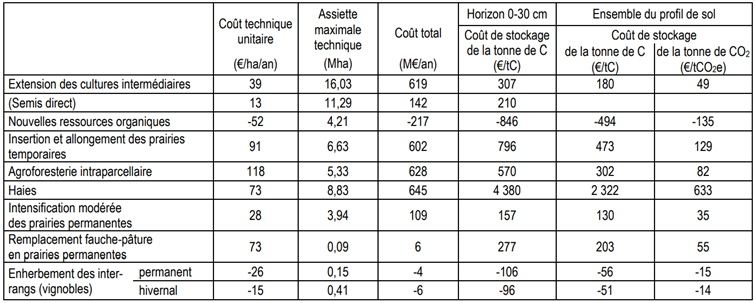
Et ce risque peut se matérialiser de différentes formes. Si les prix de la tonne de carbone augmentent, est ce que les prix seront répercutés à l’agriculteur ? Si le porteur de projet ne peut honorer sa partie du contrat en raison d’événements indépendants de sa volonté (exemples: incendies, pertes de cultures impliquant d’importer de l’alimentation animale, pertes de haies, etc. ), les conséquences dépendront des termes du contrat qu’il aura signé. Imaginons également qu’un agriculteur ait signé un certificat et se soit engagé sur un marché carbone. Si demain, des règles plus sérieuses ou contraignantes sont mises en place, est ce que l’agriculteur pourra revendre son carbone ailleurs alors qu’il l’a déjà vendu ? Les sources d’incertitude financière pour les agriculteurs sont à la fois dans le montant des revenus qu’obtiendront les agriculteurs – revenus dépendant du prix de la tonne de carbone- mais aussi dans le fait que leur versement effectif est incertain (un acheteur pourrait très bien faire faux bon). Avec un marché carbone qui semble aussi alléchant, on devrait voir arriver rapidement de nouveaux acteurs – et c’est déjà pas mal le cas – certains plus opportunistes que d’autres. Les projets afflueront avec des contrats potentiellement très différents, les arnaques ne seront jamais très loin. Les agriculteurs devront être prudents et conscients de leurs conditions de rémunération. Ils devront s’assurer que les acteurs qui se rapprochent d’eux en mettant en avant des outils de calcul ou de rémunération carbone les maitrisent bien.
Tous les agriculteurs ne partent pas avec les mêmes chances pour stocker de la matière organique. Pourrait-on aller jusqu’à dire que c’est un peu injuste ? Les résultats sont assez variables entre fermes. En 10 ans, certains pourront arriver à prendre plusieurs points de matière organique dans certaines conditions particulières mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et la comparaison de ces conditions n’est pas complètement évidente non plus. L’initiative 4/1000 lancée en France par Stéphane le Foll visait un objectif de stockage annuel mondial, objectif qu’il est difficile d’individualiser pour chaque sol – certains sols stockeront plus, d’autres moins. Vendre une tonne de carbone quand on a un sol très pauvre grâce à du stockage additionnel, ça n’est définitivement pas la même chose que quand on a déjà un sol très riche en carbone (nous avions évoqué ce point un peu plus haut dans le cadre du label bas carbone). La tonne est également plus chère en pays tempéré parce que les capacité de stockage sont moindres. Les conditions actuelles font qu’il est plus logique financièrement de mettre en place des projets carbone dans des zones tropicales (par exemple dans le cadre de projets forestiers) tout simplement parce que la croissance est plus rapide et que le carbone sera ainsi stocké plus rapidement. De plus en plus d’entreprises françaises trouvent néanmoins de l’intérêt à valoriser du carbone en France parce qu’elles ont envie de s’engager sur leur territoire et de donner plus de sens à leur engagement. Peut-être est-ce une réaction à la Covid-19 qui ont fait ressentir à certaines entreprises l’intérêt de favoriser des projets plus locaux, qui sait ; on ne va pas s’en priver. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, des agriculteurs français participent à nourrir les français… C’est bien évidemment aussi un moyen pour ces entreprises de donner un petit coup de boost à leur communication, en donnant à voir leur implication sur leur territoire. Peut-être sera-t-il possible de différencier la rémunération carbone en fonction de la difficulté des leviers à mettre en place dans certains contextes pédoclimatiques…
Le risque est présent que la majorité de la valeur ajoutée n’aille pas à l’agriculteur. Quand on voit la répartition de la valeur sur les chaines de distribution alimentaire actuelles, on peut effectivement avoir de quoi s’inquiéter. Pour le carbone, les coûts sont multiples : entre le diagnostic, la vérification, l’audit, ou encore les intermédiaires ; qui tirera vraiment profit des marchés carbone ? Bien négocier les prix et répartir la valeur de la tonne de carbone sera extrêmement important. Certains intermédiaires peuvent néanmoins être profitables aux agriculteurs parce que tous les porteurs de projets n’ont pas la capacité et/ou le temps de vendre des crédits carbone sur le marché. Des acheteurs ou revendeurs de crédits carbone – qu’ils soient agrégateurs ou intermédiaires – peuvent faciliter l’accès aux crédits carbone pour les agriculteurs en regroupant des projets. Des places de marché (« market place ») proposent des vérifications additionnelles sur les projets en cours et peuvent apporter plus de transparence aux clients, plus de facilité dans la compréhension des projets, et permettre de fluidifier le marché. Ce qui est par contre plus problématique, c’est quand se met en place de la multi achat/revente de crédits carbone (on parle de « brokers » qui seraient là pour faire du trading carbone à haute fréquence par exemple). Dans ce cas-là, on peut être sûrs que les coûts d’intermédiation viendront gonfler artificiellement les prix des projets carbone et que peu d’argent arrivera in fine aux agriculteurs. Au niveau national, il y aura également un travail à faire pour aligner le travail des intermédiaires, notamment pour que les prix proposés ne varient pas du simple au double entre les intermédiaires. Le choix d’un ou de plusieurs intermédiaires pour l’agriculteur (ou groupement d’agriculteurs) devra rester libre.
Nous avons parlé jusque-là des agriculteurs mais le prix de la tonne de carbone peut être aussi réfractaire pour les entreprises financeuses de crédits. Il y a d’abord le coût initial du diagnostic initial du projet, qui pourrait être à la charge de l’entreprise, mais aussi les audits réalisés. Sur la certification en elle-même, les budgets peuvent être conséquents pour des labels internationaux dans la mesure où un audit doit être réalisé tous les 5 ans. Sur des projets très structurants pour une entreprise en interne – au sein de sa chaine de distribution – on peut comprendre que l’entreprise soit prête à assumer ce coût. Par contre, sur des projets carbone de petite taille et pour des plus petites entreprises, le coût de la certification peut être plus difficile à avaler. Certains acteurs préfèreront alors se tourner vers des labels moins lourds en budget et qui ne génèrent pas forcément de crédits (ex : Value Chain Initiative). Rajoutons à cela que l’entreprise qui n’a pas envie de vendre son crédit carbone sur le marché n’a de toute façon pas réellement besoin de générer des crédits carbone.
Parler d’argent associé au carbone peut être rassurant pour les agriculteurs mais le raisonnement purement économique est toujours assez limité parce que les services associés ne sont pas monétarisés. La mise en place de pratiques vertueuses a bien entendu un intérêt pour les réductions d’émissions et/ou le stockage de carbone dans le sol mais c’est bien loin d’être le seul. Régénération des sols, diminution de l’érosion, amélioration de la portance et de la structure du sol, diminution du lessivage, stimulation intellectuelle par des réflexions agronomiques poussées, tout ça est directement ou indirectement lié à la mise en place de ces pratiques et ne peut se résumer dans une simple valeur économique.
A combien fixer alors le prix d’une tonne de carbone ? 20, 50, 100, 200, 1000 ? Les paris sont ouverts… Et comme nous l’avons déjà dit, ces coûts devraient refléter également le coût des pratiques de l’agriculteur. Attention néanmoins à ne pas confondre le prix du carbone avec la valeur de l’action pour le climat (ou valeur tutélaire du carbone), qui est censée aider à choisir les meilleures actions et projets pour lutter contre le déréglement climatique. Dans ce cadre-là, tous les projets dont le coût des émissions serait en dessous de la valeur de l’action devraient être réalisés si l’on veut rester dans les clous de l’Accord de Paris. Les autres projets devraient être laissés de côté. Cette valeur, actuellement autour de 100€ la tonne de carbone, devrait grimper autour de 800€ en 2050.
De la compensation à la contribution carbone
A écouter les médias et la propagande de certaines grandes entreprises, on devrait être rassurés, tout le monde s’engage vers la neutralité carbone, et ce surtout à grands coups de compensation carbone. Projets de reforestation, de réhabilitation d’espaces, projets bas carbone, on en verserait presque une petite larme. Le problème du déréglement climatique n’a visiblement pas été bien compris. Dire que l’on compense et que l’on est neutre en carbone quand on n’est pas un état, ça n’a pas vraiment de sens. La compensation est un non-sujet et le terme en lui-même n’est pas approprié. Et l’imaginaire de la compensation peut conduire à des effets pervers et des aberrations comme l’arrêt de pratiques vertueuses et le relargage de carbone dans l’atmosphère pour pouvoir ensuite restocker ce carbone par la suite. Les exemples autour des projets de reforestations sont aussi très parlants. Ces projets ne permettent de stocker du carbone que sur du long-terme ; le temps que les arbres poussent ; alors que les émissions de gaz à effet de serre quant à elles sont très souvent immédiates. La stockage de carbone n’a donc pas lieu à la date d’achat du crédit. Pour maximiser l’investissement sur les crédits carbone forestiers, certains porteurs de projets pourraient vouloir accélérer les cycles de production, avec des essences à croissance rapide, favoriser la monoculture forestière, et potentiellement exploiter les forêts plantées à des fins commerciales. Se rajoute à cela le fait que le déréglement climatique est une menace en lui-même pour le développement des projets forestiers. Incendies, sécheresse, maladies, parasites – autant de menaces qui viendront peser sur la production forestière, et qui, dans le cas où elles se présentent, empêcheront de compenser ce qui aura été émis en amont. Le bilan comptable carbone sera alors entièrement biaisé.
On devrait préférer à la compensation le terme beaucoup plus juste de contribution. Une entreprise ne fait que contribuer à la transition bas carbone, elle ne peut pas se dire neutre. Une crainte néanmoins, c’est que les entreprises du marché n’en soient pas vraiment encore au courant. Comment vont alors réagir ces entreprises qui financent des projets carbone quand on va leur expliquer qu’elles ne peuvent pas se dire neutres en carbone ? Continueront-elles à investir les mêmes volumes financiers ? Les entreprises sont encore dans une approche très comptable de la transition et l’objectif pour elles est de mettre le moins d’argent possible par projet. Néanmoins, peut-être qu’en leur disant qu’elles ne seront jamais neutres, certaines entreprises françaises alloueront leurs budgets sur des projets carbone français pour s’intéresser à leur territoire. Le levier de la contribution carbone devrait plus généralement être réservé en priorité aux secteurs importants pour le bien commun (l’alimentation par exemple) et pour lesquels certaines émissions sont incompressibles.
De façon assez surprenante, un projet dont les émissions augmentent chaque année pourrait obtenir un cadre de certification bas carbone si les émissions augmentent moins que ce qu’elles auraient augmenté dans un scénario de référence. En d’autres termes, si un projet carbone est moins pire que ce qui aurait fait sans rien changer, c’est déjà mieux que rien. Et tout dépend également de la façon dont sont effectués les calculs d’émissions carbone. Réduire les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait produit est en soi une bonne chose, mais cela perd tout son sens si la quantité totale de lait produit augmente significativement et/ou si une exploitation s’agrandit fortement. Ne favoriserait-on pas alors les fermes productives et les plus intensives ? C’est le paradoxe classique de Jevons, plus communément appelé « effet rebond », théorisé par l’économiste et logicien anglais William Stanley Jevons au sujet de la consommation en forte croissance du charbon malgré l’efficacité énergétique croissante des machines à vapeur (NB : dans le contexte des grandes cultures en France, rappelons que le diviseur commun choisi a été celui de l’hectare). Dans certains cadres de certification, pour le stockage de carbone dans les sols, une ligne de base – calculée à partir d’un scénario de référence – modélise l’évolution du stock de carbone dans les sols si les pratiques actuelles ne sont pas changées. Un agriculteur qui déstockerait mais avec un déstockage plus faible que celui obtenu dans le cadre du scénario de référence pourrait aussi pouvoir récupérer des des crédits carbone. Cet argument est défendu par le fait que les approches de stockages doivent se considérer sur un temps long. Certaines situations de déstockage de carbone sont liées à des changements d’occupation du sol d’il y a plusieurs décennies et qui ne sont pas toujours du fait de l’agriculteur. Dans ce cadre-là, le fait de limiter le déstockage serait déjà un résultat très positif.
Dans le même ordre d’idée, nous avons évoqué dans cet article le concept d’émissions évitées. Un travail reste vraisemblablement à faire pour en définir clairement les contours. Les incertitudes quant au carbone réellement séquestré ou évité subsistent. L’objectif étant de s’assurer que l’on n’indemnisera pas des émissions évitées qui n’auraient en réalité jamais eu lieu. Dans le cadre de projets forestiers, on peut imaginer un premier cas simple de plantation où l’on calcule un nombre d’arbres, un diamètre attendu, et où l’on estime un stockage de carbone en sachant que l’on plante sur des zones qui n’auraient pas été plantées. Deuxième cas de figure : les défenseurs d’un projet forestier annoncent que si leur projet ne se fait pas, la forêt considérée sera déforestée. Dans ce cas-là, les émissions évitées sont la différence entre une courbe de déforestation théorique qui aurait eu lieu sans ce projet, et le niveau de déforestation que l’on attendrait si ce projet était mis en place. On vend donc ici une différence entre deux courbes de déforestation, en partant du principe que le projet conduit à moins de déforestation que la situation de référence. Le problème réside dans la considération de la situation de référence, souvent à partir de données historiques. Peut-on vraiment être sûrs que le rythme de déforestation restera identique et que le projet aura vraiment servi à quelque chose ? En d’autres termes, il est toujours possible d’orienter le scénario de référence en partant du principe que la forêt est plus menacée qu’elle ne l’est réellement. On finance alors des émissions évitées pour rien. Autre exemple, certains projets en Inde et en Chine proposent de remplacer des sources d’énergie fossiles (notamment du charbon) par des énergies renouvelables. Les émissions évitées pourraient alors être revendues. Problème, dans plusieurs cas, des organisations se sont rendues compte qu’une loi locale contraignait déjà cette conversion ou que des projets existants avaient déjà pour objectif de remplacer du charbon par des énergies renouvelables. Si les émissions évitées sont vendues, on rentre alors complètement en conflit avec le principe d’additionnalité. D’où l’importance de clarifier le plus finement possible le concept d’émissions évitées. Dernière exemple en agriculture. Nous en avons déjà parlé mais un agriculteur qui maintient son stock de carbone en conservant des pratiques stockantes peut se faire rémunérer pour ça, et c’est une bonne chose. Mais est ce normal qu’une entreprise puisse racheter ces crédits-là, ou en d’autres termes fasse de la compensation, sachant que le carbone est déjà dans le sol ? N’y a-t-il pas une forme de schizophrénie ?
La contribution des entreprises à la transition via les marchés carbone en place peut certes être vue comme une pratique intéressante, mais elle ne doit pas et ne pourra de toute façon pas se substituer à une réduction de ses émissions. Nous n’en avons tout simplement pas le temps. La mise en place de projets carbone, quoi qu’on en dise, est chronophage. Il faut monter des dossiers, les faire valider, mettre en place le projet, trouver des acheteurs… Le déréglement climatique tape à notre porte, et nous impose de travailler en priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises doivent construire une stratégie de baisse de leurs émissions polluantes. La contribution ne peut pas se suffire à elle-même et doit s’accompagner d’une vraie dynamique. Calculer des émissions que l’on soustrait à des contributions est quand même assez limité, il ne suffit pas d’aller planter des arbres. Certains diront néanmoins que tant qu’il y aura des moyens de compenser leur empreinte, les entreprises continueront à le faire avant de réduire leurs émissions. Le système de contribution existe et alors autant s’en servir pour canaliser les flux d’argent et les orienter vers des projets qui serviront le carbone et bien plus que ça ; des projets avec des impacts socio, éthiques, de développement humain, ou encore sur la biodiversité. L’enjeu va être de réussir à amener les entreprises à financer des projets carbone les plus proches possibles de leurs activités. On parle en anglais du sujet d’ « insetting » , ou le fait d’intégrer un projet carbone dans la filière, d’en faire un projet proche des questions de l’entreprise. Une entreprise agro-alimentaire qui monte un projet dans sa propre chaine de distribution a de moins en moins d’intérêt à faire du green-washing mais plutôt à mieux considérer ses producteurs (meilleure traçabilité, dimension environnementale importante…). Le déréglement climatique va créer de vrais risques filières et d’approvisionnement dans certaines entreprises agro-alimentaires et ces entreprises devront se saisir du problème à bras le corps. Et une entreprise qui contribuerait à la transition décarbonée en achetant des crédits carbone n’a certainement aucune envie que des ONG ou autres organismes remettent en question les certificats carbone que cette entreprise aurait pu acheter. Ces entreprises veulent être inattaquables.
Le prix des crédits carbone peut aussi jouer fortement dans la balance de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le prix monte pour refléter le prix réel de l’externalité, pour rémunérer l’agriculteur et leur donner un vrai incitant à changer. Pour un acheteur de crédits carbone, plus le prix est élevé et plus l’achat ressemble à une amende. Pour des entreprises assez fortement émettrices dans certains secteurs de notre économie (industrie, transport..), ça peut commencer à faire très cher. Le prix élevé des crédits sera alors un incitant à baisser leurs émissions. Pour prendre l’exemple de la France, une majorité des entreprises les plus puissantes a déjà pris des engagements de réduction de ses émissions carbone et a certainement déjà provisionné la dette carbone dont elle va devoir s’acquitter. Tout le monde est conscient que ces entreprises vont être amenées à décarboner. Si elles sont à l’avant du train, elles auront le bénéfice d’une meilleure communication (après, c’est sûr que si le Scope 3 des émissions n’est pas considéré, ça n’est quand même pas terrible…) et le bâton ne sera pas trop pénible tant que les crédits ne seront pas trop chers à acheter. Est-ce que toutes les entreprises prendront cette direction volontairement ? Certainement pas mais la notion de pollueur-payeur reste quand même très présente. L’Union Européenne est en train de créer une taxonomie des investissements considérés comme durables ou non durables. Si l’Union Européenne les définit de manière légale, ces taxonomies pourront tenir un rôle d’incitant fort voire de punition. De nombreuses agences de notation proposent maintenant des critères d’investissement social responsable (ISR) incluant des critères climat. Même si l’on pourra toujours critiquer la taxonomie de l’Union Européenne ou les critères d’agences de notation, le sujet carbone est clairement en train d’évoluer.
Les porteurs de projets pourront également rentrer dans la balance dans la mesure où ils pourront choisir à qui vendre les crédits carbone qu’ils auront participé à générer. Les porteurs de projets carbone – agriculteurs ou collectifs – seront alors dans une position de force et pourront orienter les crédits vers des acheteurs qu’ils considèrent responsables et de bonne intention. Ce pourra être l’occasion pour eux de s’assurer que les acheteurs mettent eux aussi en place des actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et qu’ils participent à une amélioration générale du secteur de l’agriculture. Les agriculteurs doivent s’emparer de cette position de force et de cette liberté de vendre des crédits carbone, et profiter de ce positionnement pour résister aux sirènes de très grosses structures (organisations, coopératives…) qui pourraient les apâter avec une rémunération carbone ou une filière qui leur ferait perdre la part de plus-value qui leur revient de droit.
Il faudra s’assurer que les projets mis en place se fassent sur du temps long, qu’ils soient pérennes dans le temps. Ou en tout cas que la durée de comptabilisation des réductions d’émission soit supérieure à la validité du projet, ce qui n’est pas vraiment le cas à l’heure actuelle. Si le carbone est déstocké très rapidement après, l’achat d’un crédit ne se fera vraiment que pour se donner bonne conscience…
Le carbone aux échelles nationales et internationales
En parallèle du dumping social que l’on peut observer en Europe – à la fois en agriculture mais pas que – pourrait-on voit apparaitre un dumping climatique de la part de certains pays qui, volontairement, ou involontairement, évolueraient plus lentement que d’autres vers une agriculture moins carbonée et plus stockeuse de carbone dans son sol. C’est en tout cas ce dont s’inquiètent certains acteurs dont la Copa-Cogeca. Nous l’avons vu, certaines pratiques vertueuses sont chères et parfois risquées sous plusieurs points de vue pour l’agriculteur qui voudrait les mettre en place sur son exploitation. On pourrait s’opposer à cet argument en considérant que si ces pratiques sont effectivement risquées et chronopages, elles ont le grand mérite de réfléchir au problème sur un temps long et de sortir d’une logique court-termiste dans laquelle nous sommes tous englués. Cela étant dit, la Copa-Cogeca et d’autres organisations en appellent à un mécanisme d’ajustement du carbone aux frontières (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). L’objectif avancé de ce mécanisme serait de faire en sorte que le coût des produits importés sur le marché européen reflète l’ampleur de leurs émissions carbonées. L’argument avancé semble pertinent, encore faudrait-il que déjà en Europe, l’ensemble des pays aillent dans la même direction.
A l’heure actuelle, le prix des crédits carbone du marché volontaire sont beaucoup plus faibles à l’international qu’en France. D’un point de vue purement économique, comment lutter quand le prix d’un crédit carbone à l’internationale oscille entre quelques euros alors qu’il en faudra débourser plusieurs dizaines (et ce n’est pas encore suffisant) sur le territoire français ? C’est d’ailleurs pourquoi la très grande majorité des projets carbone se font dans les pays du sud. Sur le marché volontaire, rien n’empêche une entreprise d’avoir plusieurs labels pour différents crédits, et une entreprise internationale peut tout à fait utiliser le cadre du label bas carbone pour un projet carbone sur le territoire français. Les crédits carbone, qu’ils soient estampillés Label Bas Carbone, Gold Standard ou encore Verra VCS ont tous la même valeur, c’est à dire la crédibilité qu’un acheteur aura dans tel ou tel crédit. Nous en avons déjà un peu parlé mais pour les entreprises françaises, l’enjeu sera de faire en sorte que ces entreprises n’achètent pas trop de crédit à l’international. Il faudra leur montrer l’avantage qu’elles ont à financer des projets locaux, que ce soient pour des raisons de chaine de distribution, de communication, de valeur, ou encore d’engagement. Il faut susciter de l’intérêt et de la volonté pour la territorialité. Est-ce que, par ailleurs, ce qui ne définit pas les agriculteurs c’est d’être attaché localement ?
Arrivera-t-on à fixer un prix du carbone unique pour tout le monde ? L’immense avantage d’un prix unique du carbone serait d’être neutre technologiquement et politiquement, ce qui pourrait notamment permettre d’éviter le gaspillage de fonds publics pour subventionner une filière en particulier. On peut néanmoins en douter quand on voit que l’on n’est pas capable d’avoir des indices financiers et d’imposition commune à l’échelle de l’Europe. Ceci dit, le G7 a récemment mis en place un tarif commun d’imposition pour les grandes multinationales… On peut se prêter à rêver.
Quid de la diversité des outils et méthodes de suivi carbone
Les outils de calcul carbone, que ce soient pour des réductions d’émission ou du stockage, les méthodes et les cadres de certification commencent à être nombreux, nous en avons passé certains en revue dans le cours de cet article de blog. Et ils continuent à se développer. Dans le cadre du label bas carbone par exemple, plusieurs méthodes sont en cours de construction : viticulture, méthanisation, plantes à parfum… Que penser du foisonnement de ces méthodes ? Les avis divergent.
Au vu de l’hétérogénéité des contextes pédo-climatiques et des productions nationales et internationales, on pourrait commencer par penser qu’il est de toute façon compliqué d’avoir des méthodologies très strictes et gravées dans le marbre. Les productions sont différentes et les problématiques associées ne sont pas du tout les mêmes. Il faudrait plutôt au contraire ne pas se concentrer sur une seule méthode, et rester ouvert et flexible. Avoir un maximum de méthodologies et d’outils permettrait de traiter des sujets spécifiques. Et pour être précis dans les calculs et modélisation carbone réalisées, il faudrait être capable de choisir à chaque fois l’outil le plus adapté à son sujet. On pourrait très bien imaginer un outil pour les réductions d’émissions, un outil pour le stockage de carbone, et même peut-être utiliser un outil différent entre des questions ayant attrait au compost et d’autres aux couverts végétaux. Rester ouvert sur les méthodes et outils existants permettrait également de s’adapter à des logiques variées d’obligations de moyens ou de résultats. Si des systèmes de mesures se développent – ou sont proposés en substitution de mesures existantes – et permettent de mesurer plus finement des niveaux de carbone dans les sols, pourquoi ne pas s’en emparer ? Et dans ce cadre-là, une logique de résultats sera alors peut-être plus appropriée qu’une logique de moyens.
Comment jongler alors entre ces différents outils et méthodes, et surtout comment les comparer lorsque les résultats sont sensiblement différents (certains résultats peuvent être 2 à 3 fois supérieurs à d’autres en fonction des outils utilisés – qui alors a raison ou tort, c’est d’ailleurs peut être les deux) ? Est-ce qu’on pourrait être capable de faire du rétro-pédalage ou de la rétro-rémunération si on se rend compte qu’un outil n’est finalement plus si adapté que ça ? Et comment alors gérer les crédits associés ? Faudra-il revoir complètement le modèle économique initial ? Dans le cadre du label bas carbone, nous avions évoqué le sujet des rabais associés à l’incertitude des données d’entrée. Aux niveaux national et international, les standards ont différents moyens d’appliquer les rabais ; et cette liberté est assez critiquée. D’autant plus lorsqu’on est dans des logiques assez différentes d’obligations de moyens ou d’obligations de résultats. Le but d’un label est de faire évoluer les méthodes de mesure. Mais la manière de mesurer et l’exactitude de la mesure peut influer fortement sur le prix du carbone. Chaque méthode précise la façon dont elle va évoluer et suivre les choses. On en revient alors aux taxonomies Tier 1, Tier 2, et Tier 3 (voir plus haut) – certaines étant basées sur des approches assez simples de facteurs d’émission, d’autres allant chercher des mécanismes plus complexes avec des modèles dynamiques. La simplicité des méthodes n’est pas une mauvaise chose en soit mais la validité des résultats d’une méthode simple ne peut pas être mise au même niveau que des méthode plus robustes. Pour pouvoir comparer des méthodes, il sera nécessaire de pouvoir comparer des hypothèses (qui doivent être très claires) et des résultats concrets. Par exemple, dans le cadre du label bas carbone, un rabais automatique de 10% est fixé pour prendre en compte le risque de non permanence du carbone – parce qu’il peut y avoir un incendie, ou un risque climatique. Mais ce rabais peut être différent en fonction du pays. Il est par exemple de 20% en Australie et varie entre 7.5 et 15% au Canada. Comme le marché carbone volontaire en agriculture est de gré à gré, le prix des crédits carbone peut être plus facilement négocié si l’acheteur a confiance en les crédits qu’il achète. Un des gros avantages du cadre de l’obligation de résultat, c’est qu’il faut aller remesurer le sol pour voir si du carbone est stocké. C’est une approche peut-être un peu plus couteuse mais qui pourrait inciter à d’avantage de précision. Si aucune obligation de résultats n’est requise, est ce que les porteurs de projets iront vraiment chercher à vérifier que leurs émissions et/ou stockages ont bien évolué ? Rien n’est moins sûr…
En France, par exemple, on peut se demander si Soil Capital se conformera au cadre du label bas carbone et reverra son approche sur le territoire. Si ce n’est pas le cas, il y aura alors des méthodes différentes et le porteur de projet pourra choisir sa méthodologie préférée. L’essentiel étant peut-être que les agriculteurs trouvent une rémunération qui leur convienne et que la méthodologie puisse rassurer les financeurs. On aimerait quand même qu’in fine, on mesure des évolutions d’émissions et de stocks proches de la réalité…
Malgré tout, difficile de ne pas voir derrière cette diversité un message de plus en plus brouillé. Un acheteur désireux d’acheter des crédits aura certainement du mal à s’y retrouver. Et cet acheteur aura peut-être tendance à choisir une méthode qui l’arrange ou une méthode plus avantageuse pour lui, et pas forcément une approche très scientifique ou avec un niveau de précision suffisant sur les quantifications de stocks de carbone. On pourrait également se dire qu’à force de vouloir développer toujours plus de méthodes spécifiques, on pourrait en perdre la vision globale de l’exploitation. Construire trop de méthodes sectorielles pourrait avoir des conséquences sur les exploitations ou même des transferts d’impact – on se retrouverait encore avec des problématiques importantes sur le principe de double comptage du carbone. Des méthodes sectorielles sont peut-être nécessaires mais il faut garder une cohérence au niveau de l’exploitation, et peut-être utiliser pour cela des méthodologie agrégatives. Les méthodes doivent être replacées dans un contexte plus global.
Un manque de transparence et d’ouverture ?
Dans le contexte français, toute personne souhaitant développer sa propre méthodologie de certification carbone peut prendre contact avec le gouvernement et demander à en faire labelliser sa méthode. Officiellement, le dossier carbone semble donc relativement ouvert. Officieusement, on pourrait quand même avoir quelques raisons de remettre en question cette si belle ouverture. Au vu du temps passé par les comités scientifiques actuels pour proposer et faire valider le cadre du label bas carbone, on peut se demander si le ministère accepterait réellement une nouvelle méthodologie. On pourrait effectivement arguer que développer une méthode sur une périmètre existant est lourd et redondant, et qu’il serait préférable, si l’on souhaite réellement produire une nouvelle méthode, qu’elle s’intéresse plutôt à un nouveau périmètre non encore validé. On pourrait néanmoins leur rétorquer que les comités scientifiques actuels ne représentent pas non plus tous les collectifs d’agriculteurs et que le fait d’avoir cadré une méthode par le ministère aurait tendance à plutôt verrouiller le processus en place.
Officiellement toujours, il n’est normalement pas possible de commencer à développer un outil tant que la méthode associée n’a pas été validée par le ministère. Ce n’est pourtant pas vraiment ce qui se passe à l’heure actuelle. Agrosolutions a participé à la rédaction de la méthode label bas carbone pour les grandes cultures, et a déjà développé son outil Carbon Track intégrant les équations et approches décrites dans la méthode label bas carbone. L’outil sera donc un des pionniers sur le marché, et certains autres acteurs auront peut-être un peu de retard. Délit d’initiés ? Enjeux politiques ? Mais est-ce grave au final ? Pas forcément si l’on veut que des outils soient disponibles rapidement. Et Carbon Track ne sera pas le seul outil disponible sur le marché. Néanmoins, une certaine transparence s’impose et de plus petits acteurs souhaitant développer leur propre outil auront certainement affaire à une rude concurrence. Pour les non-aficionados d’Invivo et de la FNSEA, il faudra avoir les reins solides. Notons que ce cas-là est déjà arrivé avec le passé, l’Idele avait développé à la fois la méthode Carbon Agri et l’outil CAP’2ER.
Toujours sur le sujet de la transparence, il va devenir important d’assurer la traçabilité des contributions aux réductions d’émissions et des crédits carbones. Et c’est surement l’état, via le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) qui devrait s’en charger. Certaines propositions sont en faveur d’un registre centralisé et public pour encadrer les termes de la contractualisation. Le suivi et la garantie de qualité des crédits semble fondamentale, et tout cela doit également être exigé par les agriculteurs eux-mêmes. Les crédits doivent avoir été générés dans des cadres sérieux et en suivant des protocoles reconnus.
L’estimation des niveaux de stocks et de l’évolution de ces stocks de carbone dans le sol est complexe. Cette complexité rend donc naturellement les estimations incertaines. Etrangement, ces incertitudes ne sont quasiment jamais affichées dans les résultats de modèles ou sur les outils mis à disposition sur le marché. Il devrait être pourtant normal pour un porteur de projets, un acheteur crédit, et surtout pour un agriculteur, d’évaluer les marges d’incertitudes qu’il aurait à mettre en place ses pratiques de réduction d’émissions ou de stockage de carbone.
Et le numérique dans tout ça ?
Les outils informatiques, et peut-être le numérique au sens large, pourraient-ils accompagner la transition carbone qui s’opère ? Certains acteurs auraient tendance à dire que oui. Pour mener à bien un diagnostic carbone et modéliser l’évolution du carbone sur une exploitation avec les moyens actuels, il faudrait collecter plusieurs milliers de données – à la fois sur l’exploitation elle-même, les pratiques culturales engagées, les interventions, ou encore sur les résultats de production. Ca n’est pas négligeable. On pourrait néanmoins se demander à quel point la totalité de ces données sont nécessaires pour évaluer l’état des stocks et des futurs sur l’exploitation, ou en d’autres termes, de trouver un compromis entre quantité de données récoltées et qualité de la modélisation. Personne n’a envie de passer sa vie à saisir ses données sur un outil de modélisation. C’est un peu déjà ce que propose le cadre du Label Bas Carbone avec les rabais octroyés, fonction de l’incertitude et de la qualité des données en entrée de la modélisation (voir plus haut). Ces outils doivent être ergonomiques et faciles à utiliser si l’on veut qu’ils puissent se déployer à grande échelle. Il faut rendre l’expérience de la rémunération carbone aussi facile et agréable que possible. Gardons à l’esprit que les données collectées pourraient de toute façon servir à d’autres choses (autres sources de rémunération, déclarations PAC…). Mais ces constats généraux ne sont après tout en rien propre au sujet carbone, mais bien à tous les projets informatiques au sens large.
Tout cela étant dit, la plus grande complexité réside dans la récupération des données. La saisie d’informations sera certainement plus sobre pour un agriculteur qui a mis en place une traçabilité informatisée depuis quelques temps dans la mesure où de nombreux acteurs développent des API (Application Programming Interface) pour qu’outils de calculs et de modélisation s’interfacent avec les logiciels de gestion parcellaire. C’est par exemple le cas de l’outil Simeos-AMG qui est en train de passer en API, mais qui gardera également son interface actuelle. En élevage, on peut également penser aux exploitations laitières, suivies par le contrôle laitier, et pour lesquelles un certain nombre de données sont standardisées et facilement récupérables. Ces enjeux d’intéropérabilité sont au cœur de nombreux débats dans le domaine de l’agriculture, nous en avons déjà parlé dans un précédent article de blog. La connexion entre des sources de données hétérogènes – qu’elles soient issues de l’agriculteur, de mesures terrain, de logiciels de gestion ou encore de données satellites – est la condition sine qua none pour que les outils numériques existants délivrent des indicateurs précis. Gardons également en tête qu’actuellement, assez peu d’agriculteurs sont munis de logiciels de gestion parcellaire. Une étude de 2017 de l’observatoire des usages numériques pour l’agriculture donne le chiffre de 25%. Et je rajouterais même que les données renseignées dans ces logiciels sont souvent à caractère réglementaire, et assez peu à valeur agronomique (densité de semis, rendement…). Deux constats importants à en tirer. Premièrement, assez peu de données dans ces logiciels pourraient vraiment nourrir des outils de modélisation carbone. Deuxièmement, et ça n’est pas complètement indépendant, il pourrait être difficile pour un agriculteur qui s’engage dans un projet carbone, de réaliser des simulations carbone sur des pratiques antérieures à son projet carbone, dans la mesure où les données ne seraient pas forcément disponibles. Malgré les efforts en cours sur le sujet, force est de constater que l’interfaçage entre les outils existants est loin d’être réglé. Pour l’agriculteur qui tient des registres au format papier, la saisie sera sûrement un peu plus laborieuse – mais pas impossible dans la mesure où ses registres sont organisés et préparés pour le diagnostic ou la modélisation. Pour les exploitations grandes cultures ou celles en bovins viande, certaines n’ont pas vu de conseillers depuis longtemps. Une grande partie des producteurs ne sont pas accompagnés techniquement et la collecte de donnée pourra alors prendre beaucoup plus de temps. Certains outils, comme Carbon Track d’AgroSolutions, proposeront des niveaux de saisie rapide où, en moins d’une heure, un agriculteur pourra déjà renseigner les caractéristiques principales de son exploitation pour y paramétrer un état initial de carbone.
Le carbone est le sujet du moment, à n’en pas douter ; les outils et méthodes de calcul se développent assez largement en France et à l’international. D’un point de vue logistique, ce foisonnement rend la part belle au numérique qui pourrait permettre de jongler assez facilement entre les outils de calculs en transférant des données de l’un à l’autre au gré des projets carbone en cours. Dans le futur, on peut s’attendre à ce que les méthodes ne cessent de se complexifier. Découverte ou actualisation de processus agronomiques, mises à jour de modèles d’estimation de biomasse, telles sont les évolutions qui peuvent nous pendre au nez. Mais les outils numériques, au contraire, pourraient être là pour tout simplifier. L’agriculteur pourra comprendre la complexité fonctionnelle et agronomique de la méthode, mais sa complexité technique sera dévoyée aux outils informatiques. Notons néanmoins qu’actuellement, les outils ne sont pas encore capables de prendre en compte certaines spécificités de techniques culturales ou certaines techniques innovantes (double culture, couverts permanents pluri-annuels, couverts très diversifiés). Ils sont certes le reflet de modèles qui, eux-mêmes peut-être ne les considèrent pas, mais la complexité de l’agronomie n’est pas encore complètement intégrée. On pourrait voir cette montée en complexité de points de vue assez diamétralement opposés. D’un côté, cette complexité n’est pas un problème en soi parce que le niveau de complexité représente l’hétérogénéité de la France. Chaque territoire, chaque agriculteur, chaque parcelle, chaque sol sont différents. Une méthodologie générale ne pourra jamais s’adapter complètement à un contexte local. D’un autre côté, cette complexité pourrait effrayer certains collectifs ou associations qui voudraient développer leur propre outil informatique pour rester indépendant des acteurs principaux du marché. Le déploiement des API devrait plutôt être vu ici comme rassurant puisqu’il permettra d’éviter les intermédiaires et de se brancher directement sur les outils de calculs bruts. On pourrait rajouter enfin qu’à force de monter en complexité, il sera de plus en plus compliqué de vérifier la qualité des indicateurs de suivi obtenus. Certains indicateurs peuvent être fonction des objectifs de production sur l’exploitation et certaines données d’entrée peuvent être soumises à interprétation. Si on rajoute à cela des potentiels problèmes ou d’erreurs dans le transfert ou la mise à jour de données, on pourrait alors se perdre dans les méandres des calculs et de la modélisation, et avoir du mal à sortir la tête de l’eau.
Les outils numériques sont également supposés servir une baisse importante des coûts des projets carbone. La nouvelle PAC devrait arriver avec des demandes fortes sur les dispositifs de suivi MRV (Monitoring, Reporting, Verification) pour s’assurer que les crédits octroyés – pour le carbone mais pas que – aillent au bon endroit. On peut citer ici l’exemple de la chaine SEN4CAP du Cesbio pour le suivi des pratiques agricoles et la vérification des déclarations PAC. Cette chaine de traitement propose déjà des cartes d’indices foliaires et de végétation (LAI, NDVI, FCover…) et des indicateurs de suivi de lixiviation nitrates, de biodiversité ou encore de l’albédo des surfaces agricoles. Cette demande de suivi nécessitera sans s’y méprendre des coûts de gestion de projets très importants. Coûts que les outils numériques pourraient aider à diminuer dans la mesure où l’on aurait affaire à un pilotage de la pratique agricole, à une obligation de moyens. Les données de pratiques doivent être tracées pour faire le lien entre pratiques et densité carbone. Les outils numériques faciliteraient l’acquisition de données, leur transfert, et fluidifieraient les process en cours. Passer plusieurs jours à mettre en place un diagnostic ou une modélisation carbone, entre la collection de données, la mise en forme ou encore la simulation de différents scénarios), peut plomber économiquement un projet carbone. Automatisation et simplification vont alors de pairs, en s’assurant néanmoins que les simplifications ne nuiront pas trop à la robustesse des méthodes en place.
Je ne m’étendrai pas sur le sujet mais les outils numériques soulèveront toujours des enjeux de propriété et d’utilisation de données, surtout sur un enjeu aussi brûlant que le carbone. Certaines chartes et labels sont mis en place – par exemple Data Agri – mais certains agriculteurs ne seront jamais complètement rassurés. Les obligations de moyens, la surveillance répétée sur les exploitations agricoles (avec notamment les nouveaux dispositifs de la PAC) ou encore les lacunes et manquements de pratiques agronomiques sur les déclarations (gestion des résidus de culture et engrais organiques, présence ou absence de cultures de couverture…) laissent pensifs. Une relation de confiance devra nécessairement s’établir.
Soulevons enfin le paradoxe lié aux outils numériques que j’avais déjà mis en avant dans un précédent article de blog. Développer des modèles et des outils numériques pour limiter l’empreinte carbone de l’agriculture a-t-il du sens au regard de l’impact carbone de ces outils en eux-mêmes ? Entre collecte des données, stockage, analyse, et développement d’outils informatiques, la balance est-elle du côté de l’agriculture ou du numérique ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? La réponse n’est pas évidente, il faut y réfléchir.
Quelques dernières remarques
Au vu de la capacité de stockage de carbone dans les sols, pourrait-on imaginer que le dossier carbone favorise une spéculation sur le foncier ? Une pression foncière pourrait faire augmenter le prix des terrains agricoles significativement et rendre l’accessibilité à la propriété encore plus complexe qu’elle ne l’est actuellement, notamment pour les nouveaux agriculteurs. Un point d’attention parait opportun ; certaines associations appelant d’ailleurs à une étude d’impact sur le sujet.
Si l’on considère que la photosynthèse est un des mécanismes les plus puissants pour le stockage carbone, se pose alors la question de l’utilisation qui sera faite de la biomasse. Comment arbitrer entre un retour au sol maximal de la biomasse et une utilisation dans une filière de valorisation comme la méthanisation ? Les deux approches sont-elles compatibles ? Cela dépend-il de l’échelle spatiale considérée ? On pourrait rajouter que la question de la distribution de la valeur ajoutée du carbone se posera à nouveau. Qui, du gestionnaire de méthaniseur ou du distributeur de biogaz, aura des crédits carbone ? Comment seront-ils répartis ? Et de garder à l’esprit qu’un agriculteur pourrait alimenter un méthaniseur tout aussi bien avec des pratiques vertueuses qu’avec des pratiques largement émettrices ou destockantes.
D’un point de vue agronomique, le carbone est encore principalement considéré en relation à la matière organique au sens large. De cette matière organique, il en existe plusieurs formes (stables, labiles…). Les technologies d’analyse sur les formes de matière organique commencent à arriver, mais celles-ci ne sont visiblement pas encore toute d’accord entre elles. L’affinage des formes de matière organique considéré aura-t-il de l’intérêt pour le suivi du dossier carbone en agriculture ?
Les enjeux actuels autour du carbone auront éloigné le débat d’un sujet assez sensible en agriculture, le glyphosate. Dans la mesure où les avocats de l’agriculture de conservation (ACS) en défendent son utilisation à des niveaux très faibles et où l’on connait les potentialités de l’ACS pour le stockage de carbone dans le sol, pourrait-on aller jusqu’à dire qu’il faut traiter pour stocker ? Restons tout de même vigilant, le glyphosate reste un problème et il faut continuer à travailler dessus. Mais ce problème est loin d’être le pire au vu de son utilisation dans le cadre des pionniers de l’ACS.
L’origine du carbone sur les exploitations est encore assez peu considéré. Il peut être produit sur l’exploitation (biomasse de couverts végétaux, élevage sur l’exploitation…), on parle alors de carbone endogène. Ou bien être importé sur l’exploitation (élevage hors de l’exploitation, engrais minéraux azotés…), on parlera alors de carbone exogène. Cette notion d’origine du carbone gagnerait à être prise en compte dans les calculs d’émissions et de stockage parce qu’elle est intrinsèquement reliée à un enjeu de résilience et d’autonomie de l’exploitation agricole.
La génération de crédits carbone coûte assez chère et nous en avons déjà un peu parlé (conception de projets, vérification, audit…). Lorsque le prix du carbone est tombé au plus bas, il n’était donc plus forcément intéressant pour certaines entreprises ou pays de comptabiliser les réductions d’émissions de projets qu’ils avaient mis en place, sinon ils auraient perdu de l’argent. On peut toutefois s’inquiéter du fait que, si le prix du carbone remonte beaucoup, ces entreprises et pays fassent venir des auditeurs pour attester des réductions d’émissions qui ont eu lieu dans le passé. En d’autres mots, le nombre de crédits disponibles aujourd’hui est bien plus bas que le nombre de crédits qui pourrait être disponible si les prix des crédits augmentaient. Sachant que ces émissions ont potentiellement déjà été évitées et que nous avons énormément de mal à réduire notre empreinte carbone, ne devrions-nous pas empêcher ces crédits passés d’être générés ? Si par exemple des crédits d’anciens projets MDP (avant 2020) sont transférés à la période 2021-2030, on pourrait se retrouver à partir de 2021 avec énormément de crédits excédentaires qui ne participeront à aucune réduction d’émissions après 2020….
En guise de conclusion
Une des grandes craintes des agriculteurs serait de devenir les dindons de ce marché du carbone. Et quand on voit la situation dans laquelle certains agriculteurs se trouvent actuellement, on peut comprendre pourquoi. Les agriculteurs doivent s’emparer de ce sujet carbone, le comprendre, l’intégrer et le maitriser pour s’assurer qu’ils pourront en tirer le maximum de billes. Le carbone est une thématique d’importance, ça ne fait aucun doute. C’est déja un levier extrêmement puissant d’un point de vue agronomique parce qu’il apporte des co-bénéfices sur l’ensemble de la qualité du sol. C’est également un levier fort de communication et de reconnaissance, faisant passer l’écologie punitive classique à une écologie positive. C’est enfin un moyen de rémunération non négligeable même s’il faut être clairs sur le fait que les crédits carbone financeront seulement une partie de la transition bas carbone, et qu’à mesure qu’on ira de l’avant, la part de la transition financée par les crédits carbone sera de moins en moins élevée.
Pour reprendre une expression qui n’est pas de moi, tout arbre n’est pas un business case. Comprenez que de nombreuses initiatives devront être financées indépendamment d’un projet bien proprement défini. Pour une entreprise, ça veut aussi dire moins d’indicateurs, moins de KPI (Key Performance Index), et plus de bien commun. Pour qu’on projet soit durable, il doit bien sûr avoir un impact quantifiable mais pour que le projet marche à long terme, il y a besoin de quelque chose de plus risqué pour l’entreprise mais qui apporte beaucoup à la communauté, une sorte de bien commun qui va bénéficier au projet dans son ensemble.
A l’heure actuelle, les débats autour du carbone sont assez musclés. Des querelles de clocher sont toujours bien visibles entre agriculteurs pionniers, centres de recherche, et instituts techniques. Ces communautés restent encore assez isolées et travaillent encore relativement peu ensemble. Il y a un temps pour se plaindre et se battre, et il y a un temps pour bouger et faire avancer les choses. Le climat n’attend pas.
Concluons en rappelant que bien que le carbone soit un sujet structurant pour la filière agricole, il ne faut pas oublier que la mission principale de l’agriculture reste avant tout de nourrir la population. Mais cette nourriture ne peut être produite que dans les limites que la planète nous offre. Notre empreinte environnementale, notre surconsommation boulimique et le déréglement climatique viennent effriter l’ensemble des services dont l’agriculture a besoin pour produire. En tant que secteur émetteur de gaz à effet de serre, l’agriculture a bien sûr aussi un rôle à jouer dans la lutte contre le déréglement climatique – et l’agriculture en a d’autant plus intérêt qu’elle est directement impactée par les conséquences du déréglement climatique. Mais l’agriculture ne pourra pas travailler sur le sujet toute seul. La responsabilité incombe à absolument tout le monde : politiques, entreprises, et consommateurs. Il serait temps de se réveiller…
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur TipeeeBibliographie complémentaire aux entretiens
Ademe (2016). PCAET. Comprendre, Construire et Mettre en œuvre. Plan Climat Air Energie territorial.
Bockstaller et al. (2021). Apports de la télédétection au calcul d’indicateurs agri-environnementaux au service de la PAC, des agriculteurs et porteurs d’enjeu. Innovations Agronomiques, 83, 43-59
Boivin, P. (2021). ACS et teneur en matière organique du sol. Quelques enseignements tirés de la région lémanique. TCS n°111
Bossio et al. (2020). The role of soil carbon in natural climate solutions. Nature Sustainability
Burton, R. J. F., & Schwarz, G. (2013). Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change. Land Use Policy, 30(1), 628-641
Carbon Market Watch (2020). Introduction aux marchés du carbone. Un guide des mécanismes mondiaux de compensation.
CCFD-Terre Solidaire, Réseau Action Climat (2020). Positionnement sur le label bas carbone et la méthode pour le secteur agricole
Demaze (2013). Au nom de la lutte contre le changement climatique : le mécanisme pour un développement propre et ses travers. Controverses environnementales : expertise et expertise de l’expertise. Vertigo, vol.13
I4CE (2020). L’obligation de résultats environnementaux verdira-t-elle la PAC ? Comparison des coûts et de l’efficacité de six instruments de transition vers une agriculture durable
INRAE (2019). Stocker du carbone dasn les sols français. Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Résumé de l’étude Juillet 2019
Terre-Net (2020). Livre Blanc – Stocker le carbone dans les sols
Yogo et al. (2021). Analyse des méthodologies d’évaluation et de suivi du bilan carbone des sols et recommandations pour l’écriture d’une méthode grande culture dans le cadre du label Bas-Carbone : https://hal.inrae.fr/hal-03212854
Vaudour et al. (2021). Temporal mosaicking approaches of Sentinel-2 images for extending topsoil organic carbon content mapping in croplands. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 96, p. 102277
Séminaire à voir – revoir
Agreenium : La captation du carbone dans les sols état des lieux et perspectives : https://www.youtube.com/watch?v=QHHoMogyGfg
APAD : De l’Or Au Cœur des Sols ? https://www.apad.asso.fr/activons-nous-3/206-webinaire-carbone-de-l-or-au-coeur-des-sols
Chaire AgroTIC et Chaire Elsa-Pact : Evaluation de l’empreinte carbone en agriculture : quel apport des outils numériques ? https://www.agrotic.org/seminaire-sur-levaluation-de-lempreinte-carbone-en-agriculture-quel-apport-des-outils-numeriques/
INRAE : Carbon labelling : lessons learned from the French label https://www.inrae.fr/en/events/eu-green-week-2021
Planet A : Carbone 2021 : https://www.planet-a-initiative.com/seminaire-carbone-2020-fr/?lang=fr
Personnes Interviewées
| Nom | Structure |
| Anne-Sophie ALIBERT | PUR Projet |
| Michaela ASCHBACHER | Cool Farm Tool |
| Pascal BOIVIN | HEPIA |
| Eric CESCHIA & Thierry CHAPUIS | Inrae/Cesbio & CNES |
| Gabriella CEVALLOS | Deloitte – Anciennement chez I4CE |
| Jean-Baptiste DOLLE | France Carbon Agri |
| Annie DUPARQUE | AgroTransfert |
| Emelie HALLE | Saipol |
| Sylvain HYPOLITE | Agrod’Oc |
| Stefan JIRKA | Verra |
| Edouard LANCKRIET | AgroSolutions |
| Etienne LAPIERRE | Terrasolis |
| Gaspard LESCURE | Kinomé |
| Chuck DE LIEDEKERKE | Soil Capital |
| Diane MASURE & Justine LEBAS | APAD |
| Camille POUTRIN | Greenflex |
| Jean Pierre RENNAUD | Planet A |
| Thibaut SAVOYE | Carbone Farmers |
| Baptiste SOENEN | Arvalis |
| Thierry TETU | Université Picardie Jules Verne |
| Frédéric THOMAS | TCS |
| Guillaume VIGNERON | Smag |
| Gécica YOGO | Inrae |

3 commentaires sur « La course au carbone en agriculture »