L’assurance, pour la plupart d’entre nous, c’est quand même pas un sujet très sexy au départ; ça en fait grincer des dents plus d’un ! Je ne connais pas grand monde qui prenne du plaisir à contacter son assureur – sauf quand il y a un truc qui ne va pas – ou à s’occuper de ses contrats d’assurance. Mais nous entretenons malgré tout une relation plus ou moins proche avec le secteur de l’assurance parce que nous souscrivons des contrats (responsabilité civile, logement, véhicule…) que ce soit par obligation, par anticipation d’un risque, ou pour tout un autre tas de bonnes ou mauvaises raisons.
Le secteur agricole connait lui aussi son lot de contrats d’assurance. On y retrouve par exemple les contrats classiques que l’on peut avoir en tant que particulier, mais aussi tout un tas d’assurances plus spécifiques comme celles sur les machines agricoles, les bâtiments, les semences, ou encore les pertes de récolte. Dans ce dossier de blog, nous nous concentrerons exclusivement sur l’assurance « récolte », aussi appelée un peu plus largement assurance « climatique », et ce pour deux principales raisons. La première, c’est qu’au cas où vous n’étiez pas au courant, un déréglement climatique majeur est à l’œuvre. Et l’espèce humaine en est responsable, c’est pas moi qui le dit, c’est le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) – sans aucune autre forme de procès – dans son rapport AR6 de 2021. Ce déréglement climatique, le secteur agricole commence déjà à se le prendre en pleine face. Deuxième raison, l’assurance climatique agricole en France est sur le point de se réformer. C’est en tout cas ce qu’il faut comprendre du rapport du député Frédéric Descrozailles, remis au ministère de l’agriculture à l’été 2021, et dont certains amendements ont été votés en ce début d’année 2022, pour une mise en application début 2023.
J’insiste ici sur le fait que certains éléments de ce dossier sont centrés sur la France – notamment tout ce qui tourne autour de la réforme de l’assurance agricole qui y a lieu en ce moment. Néanmoins, j’ose espérer que les lecteurs hors de notre beau pays trouveront de l’intérêt dans les éléments de contextes, clés de lecture, et discussions de cet article de blog.
Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.
Bonne lecture !

Figure 1. Lutte contre le gel sur des parcelles de vigne de Bourgogne en avril 2021. Les bourgeons étaient sortis très tôt en 2021 à la suite d’un hiver particulièrement doux. Le gel d’avril 2021 a complètement rebattu les cartes et mis les vignerons français dans une situation catastrophique.
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee
Déréglement climatique et coût de la sinistralité
La publication du premier volet du sixième rapport du GIEC sonne une fois de plus l’alerte. Il est incontestable que les activités humaines provoquent un réchauffement généralisé et rapide de la planète (Figure 2). L’ampleur du réchauffement que nous subirons dépendra bien évidemment de nos scénarios d’émissions cumulées de CO2 mais les experts s’accordent déjà pour dire que le seuil très largement médiatisé des +1.5°C de réchauffement à horizon 2100 par rapport à l’époque préindustrielle sera quasi certainement dépassé.
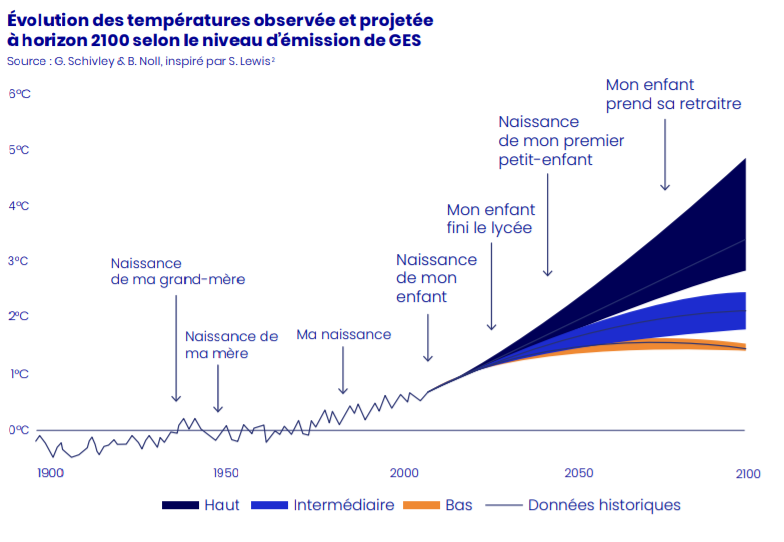
Figure 2. L’évolution des températures observées et projetées à horizon 2100 selon trois scénarios d’émissions GES. Source : Rapports sur la stratégie de résilience des territoires, Shift Project, 2021. Tome 1 – Comprendre.
Le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, sorti au début de l’année 2022, insiste quant à lui sur le fait qu’il ne nous reste qu’une fenêtre très courte – de l’ordre de quelques années, pour agir, avant de rentrer sur des trajectoires climatiques dont il ne sera plus du tout possible de nous échapper (Figure 3).
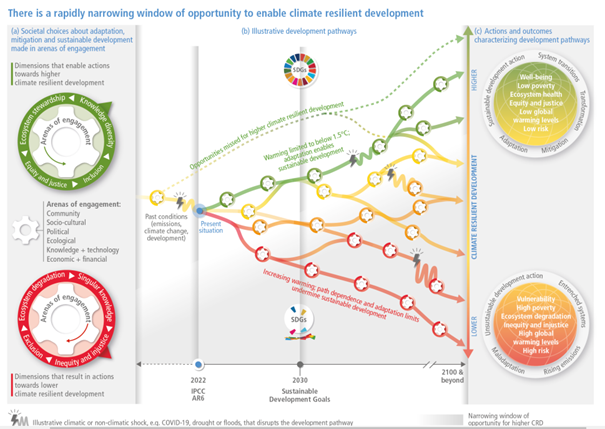
Figure 3. Choc climatique ou non climatique illustratif, par exemple COVID-19, sécheresse ou inondations, qui perturbe la voie du développement. Si nous n’agissons pas rapidement, nous pouvons voir que les trajectoires orange et rouge ne reviennent jamais aux trajectoires verte et/ou jaune. Source : GIEC, 2022.
Les dégâts du déréglement climatique en cours sont déjà très largement visibles, et ça commence à faire mal au porte-monnaie. Dans son rapport annuel de 2021, le courtier d’assurance Aon estime les dommages générés par les catastrophes naturelles autour de 343 milliards de dollars en 2021 dans le monde, après 2017 (519 milliards de dollars) et 2005 (351 milliards de dollars) [Aon, 2021]. France Assureurs – la fédération des assureurs et réassureurs opérant en France – a récemment mis en avant la tendance à l’augmentation du coût des indemnisations versées par les assureurs depuis les années 90 (Figure 4). On y observe d’ailleurs l’évolution forte des indemnisations pour les assurances climatiques en agriculture – les assurances « récolte » dont nous parlerons très largement dans la suite de ce dossier de blog.
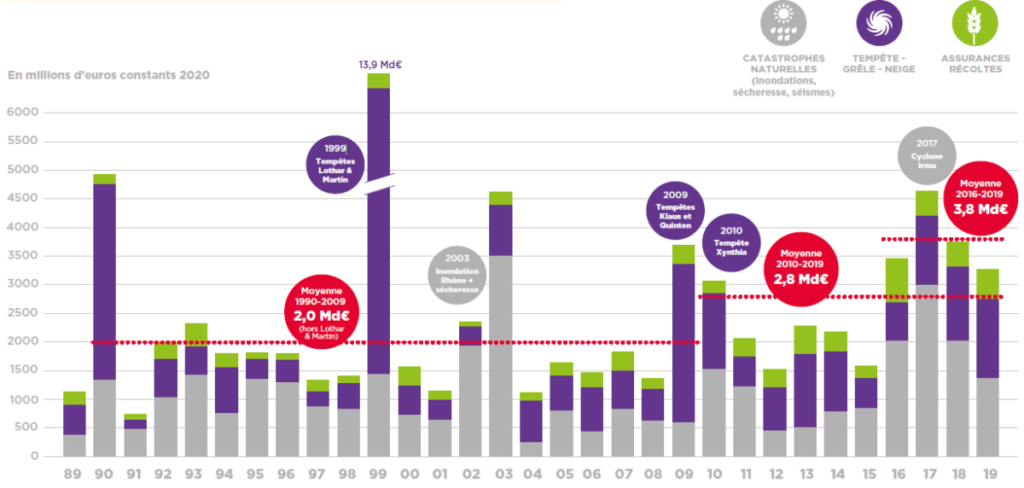
Figure 4. Historique des indemnisations versées par les assureurs à la suite d’aléas naturels en France. Source : France Assureurs, 2021
Et ces tendances ne sont pas prêtes de s’arrêter… Le dernier rapport AR6 du GIEC de 2021 est très clair sur la probabilité d’occurrence et sur l’intensité des évènements climatiques auxquels on pourra être confronté avec quelques degrés supplémentaires à l’échelle de la planète (Figure 5). On y observe par exemple qu’avec seulement 2°C de réchauffement en plus en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle, un évènement de température extrême se produira 5.6 fois plus souvent en 2100 que sur la période 1850-1900, cet évènement étant en moyenne plus chaud de 2.6°C. On souhaite bon courage à nos chers agriculteurs du monde entier. Et pour continuer sur le secteur agricole, ce même rapport nous prédit que sous un même scénario de 2°C de réchauffement, un évènement de sécheresse agricole et écologique se produira 2.4 fois souvent en 2100 que sur la période 1850-1900.
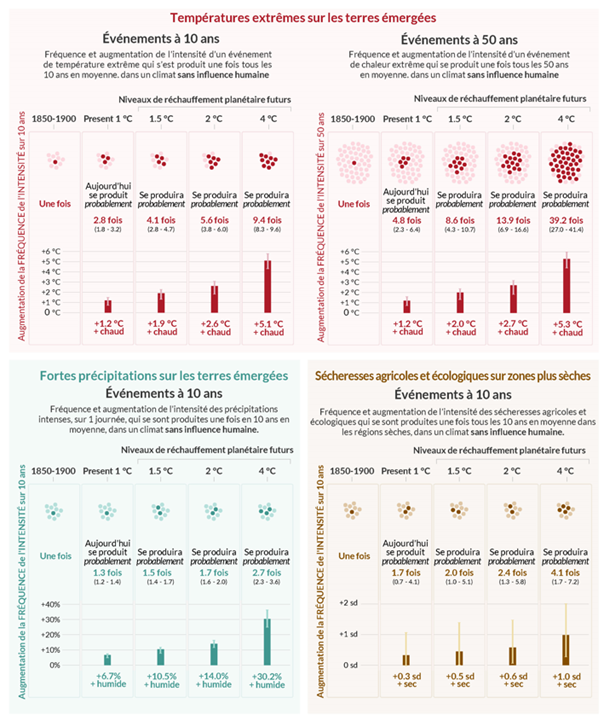
Figure 5. Changements prévus dans l’intensité et la fréquence des températures extrêmes sur terre, des précipitations extrêmes sur terre, et des sécheresses agricoles et écologiques dans les régions sèches. Source : GIEC, 2021
Et j’en profite pour rajouter également quelques clés de lecture sur les conséquences d’un tel réchauffement pour la biosphère pour sortir de notre prisme de pensée un peu trop humain-centré (Figure 6). Que ce soient en termes de perte d’espèces végétales, de perte d’espèces d’insectes (d’ailleurs très largement mis en avant par le dernier rapport de l’IPBES [Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques]), ou encore sur la poursuite du déclin des récifs coraliens, on peut voir que les dynamiques sont extrêmement variables et non linéaires avec un réchauffement de la température sur la planète.
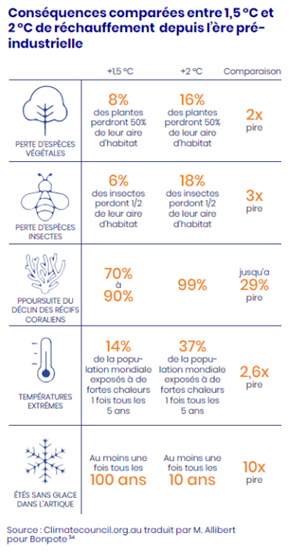
Figure 6. Conséquences comparées entre 1.5° et 2° de réchauffement climatique depuis l’ère pré-industrielle. Source : Climatecouncil.org.au, 2021
Tout ça bien sûr si nous limitons le réchauffement en 2100 à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Nous n’en prenons pas du tout la direction… Dans le scénario « business as usual » que nous empruntons, c’est-à-dire sans aucun changement de notre mode de vie, nous allons au moins vers des scénarios de réchauffement à +4°C.
Vous trouviez que les assurances avaient versé beaucoup d’argent sur les dernières années ? Mais vous n’avez encore rien vu les amis ! En association avec Météo France, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a produit une cartographie de l’évolution des dommages liés à des catastrophes naturelles entre 2018 et 2050 (Figure 7). Sans grande surprise, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne… Dans leur rapport de 2021, France Assureurs (toujours les mêmes que plus haut), estiment quant à eux que le coût des aléas naturels continuera de croitre au rythme d’un doublement tous les 30 ans [France Assureurs, 2021]. En 2050, nous pourrions ainsi nous attendre à ce qu’il faille sortir deux fois plus d’argent de nos poches que ce qu’il aura fallu sortir au cours des années actuelles.
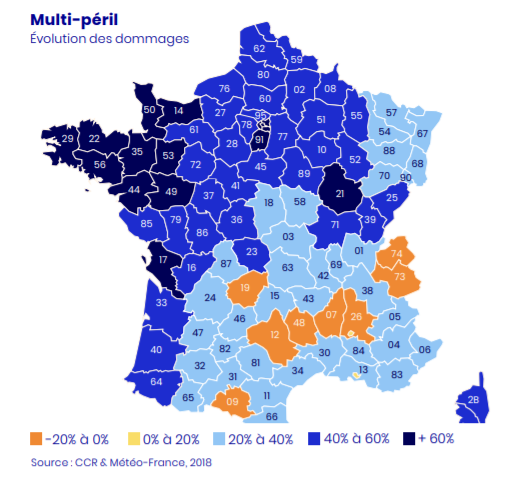
Figure 7. Répartition spatiale de l’évolution des dommages lié à des catastrophes naturelles entre 2018 et 2050. Source : Stratégie de Résilience des territoires, Shift Project, 2021. Reproduction du rapport de la CCR et de Météo France (2018).
Si le coût de l’action pour limiter ou s’adapter au déréglement climatique peut sembler élevé à l’heure actuelle, il est sans commune mesure avec le coût de l’inaction auxquels nous pourrions être confrontés dans les années à venir (et que nous voyions déjà actuellement). En 2006, l’ancien chef économiste et vice-président de la Banque Mondiale, Nicholas Stern, publiait son rapport éponyme dans lequel il mettait en avant que le coût de l’inaction était largement supérieur au coût de la prévention. Le rapport Stern estimait le coût de l’inaction, selon les scénarios, entre 5 % et 20 % du PIB mondial, contre 1 % pour celui de l’action. De la même manière, si l’assurance vous semble chère, la non-assurance l’est tout autant. A titre d’exemple, les agriculteurs français sinistrés par les crues exceptionnelles de 2016 ont dû emprunter près de 5 milliards d’euros auprès de leur banque pour passer le cap de la mauvaise année. Les capacités d’endettement des agriculteurs se sont retrouvées largement saturées par ces emprunts à court terme, non productifs, qui auraient pu par exemple être utilisés pour financer des transitions ou simplement pour investir. Et la société en supporte également les pertes indirectement par la perte de productivité et de compétitivité des filières agroalimentaires.
Lorsque l’on parle d’assurance agricole, il ne faut pas considérer que les risques liés aux événements climatiques extrêmes affectent uniquement les agriculteurs. C’est en considérant l’ensemble de la filière agricole – fournisseurs d’intrants (semences, engrais, machines…), coopératives, agriculteurs, négociants, transformateurs qu’il apparait clairement que tous les acteurs peuvent être affectés si la production agricole est touchée par un évènement climatique. Un problème pour l’agriculteur et c’est l’effet domino… Parce qu’un agriculteur non assuré, c’est aussi un fournisseur ou un client non solvable pour une coopérative ou un fournisseur d’intrants.
Les échanges mondiaux de produits agricoles permettent de satisfaire les consommateurs financièrement aisés car un déficit de production local dû à un événement climatique peut être compensé par une importation provenant d’un pays non affecté, quel que soit le coût du transport. Le risque agricole est alors caché aux consommateurs tant que le risque climatique ne devient pas systémique au niveau mondial. La crise actuelle en Ukraine est là pour nous le rappeler. Le risque de rendement lié aux aléas climatiques, quant à lui, affecte en permanence le revenu individuel de tous les agriculteurs, et ce en n’importe quel point de la planète.
Quelques bases de connaissances communes sur l’assurance
Aléas, risques et vulnérabilités
Beaucoup d’entre nous souscrivent des contrats d’assurance (responsabilité civile, logement, véhicule…) mais savons-nous réellement ce qu’est l’assurance ? L’assurance est un transfert de risques. Derrière cette phrase assez simpliste se cachent en réalité de nombreux concepts qu’il faut avoir en tête.
Le premier, et certainement le plus important, est que derrière une assurance, il y a un risque. S’il n’y a pas de risque, il n’y a pas d’assurance. L’assuré, qui porte un risque (un risque climatique pour un agriculteur par exemple), transfère son risque à l’assureur en souscrivant à un contrat d’assurance. L’assuré veut se débarrasser de son risque donc il le vend. Assez paradoxalement, on entend dire qu’un assureur « achète » un risque, alors qu’on est bien d’accord que le contrat d’assurance est bien payé par l’assuré. En réalité, il faut comprendre derrière cela que la transaction entre l’assureur et l’assuré finance le service consistant à transférer le risque d’un acteur (l’assuré) vers un autre (l’assureur). L’autorité de tutelle de l’assurance (ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) fait bien attention à ce que les contrats d’assurance comportent bien des transferts de risque, et pas autre chose, une façon d’être sûr que les gens ne fassent pas des transferts d’argent en tout genre sans risque (d’une filiale à une autre par exemple)
Profitons-en rapidement pour faire un petit aparté de vocabulaire et clarifier les différences entre un aléa, un risque, et une vulnérabilité. L’aléa est un phénomène (naturel ou technologique) plus ou moins probable sur un espace donné (Figure 8). Un risque, quant à lui, est la possibilité qu’un aléa se produise et touche une population vulnérable à cet aléa ; la vulnérabilité pouvant être de toute sorte sur les infrastructures, la santé… En d’autres termes, s’il n’y a pas de vulnérabilité, il n’y a pas de risque. Une tempête en plein milieu de l’océan n’est pas un risque pour la population. C’est un aléa climatique fort, certes, mais aucune population n’étant vulnérable à cet aléa, nous ne considérerons pas que c’est un risque. Cette notion de risque est néanmoins assez subjective parce tout le monde ne voit pas la vulnérabilité de la même manière. Dans la suite de ce document, nous utiliserons les termes d’aléas et de risques de façon assez similaire pour fluidifier la lecture, mais gardez en tête que les concepts sont néanmoins différents.
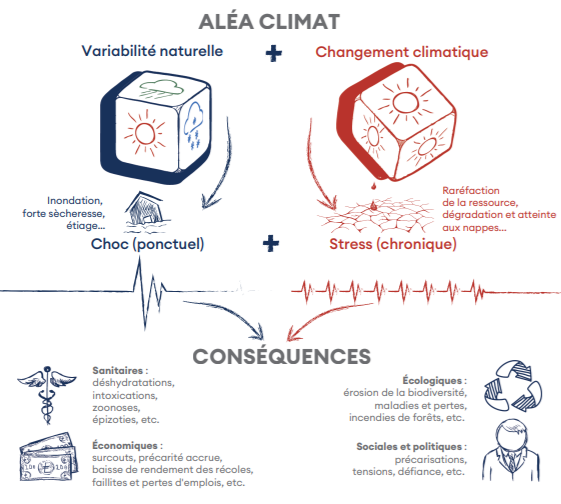
Figure 8. L’aléas climatique – la conjonction entre la variabilité naturelle et le changement climatique. Source : Haut Conseil pour le Climat, 2021
Assureurs et ré-assureurs
Tout le monde peut s’assurer : particuliers, entreprises, Etats (des états peuvent par exemple s’assurer contre les catastrophes naturelles pour mutualiser un risque de sécheresse, ou pour protéger leurs budgets pour indemniser les agriculteurs contre un aléa climatique à venir). Mais ce qui est peut-être le plus surprenant quand on ne connait pas le secteur, c’est que les assureurs, eux aussi, s’assurent. Ils font appel à des réassureurs (ex : Swiss Re, Munich Re, Partner Re ; « Re » se lit « Ré » et doit être compris comme « Réassurance ») auprès desquels ils transfèrent leurs risques. L’une des raisons d’être des réassureurs, c’est d’amortir les catastrophes naturelles qui touchent l’ensemble d’un portefeuille d’assurés. Le réassureur mutualise ses risques grâce à un portefeuille d’assurés le plus diversifié possible. Mais n’est-ce pas ce que font déjà les assureurs ? Si, mais pas à la même échelle. Lorsqu’un large territoire est sinistré (dans le cas d’une grêle par exemple), c’est bien l’ensemble du territoire qui est touché et ce sont des pertes énormes au niveau national. Un assureur qui n’aurait, dans son portefeuille d’assurés, que des assurés sur ce territoire, serait ruiné car il devrait payer une prime d’assurance à tous ses assurés en même temps. C’est un trop gros risque à gérer pour l’assureur tout seul, et il aura donc tendance à se réassurer. Les assureurs de premier rang portent le risque. Les réassureurs font le deuxième filet, ils sont là en cas de coup dur. Dans le cadre d’assurances climatiques, pour les réassureurs, la diversification des risques se fait en assurant plusieurs zones géographiques différentes, en espérant qu’il y ait une compensation entre les zones (en considérant qu’il y a peu de chances d’avoir une tempête en même temps au Chili, en France, et en Indonésie). Les réassureurs auront ainsi tendance à être plutôt des acteurs sur le plan international. Notez néanmoins que certains réassureurs sont aussi parfois assureurs à côté sur certaines branches. Notez également que des assureurs peuvent couper des contrats d’assurance en plusieurs parties (on parle d’assurance proportionnelle) et les partager avec un autre assureur ou un pool d’assureurs, on parlera alors de co-assurance (la même chose peut avoir lieu avec les réassureurs, on parlera dans ce cas-là de co-réassurance).
Assureurs et réassureurs ne sont pas des philanthropes. Leur travail n’est pas de faire gagner de l’argent aux assurés. Les assureurs sont là pour que le coût des sinistres soit moins élevé que les primes d’assurance (si l’assureur gagne de l’argent, l’assuré en perd). Et l’assuré, lorsqu’il s’assure, n’est pas censé considérer qu’il va gagner de l’argent. Le recours à un produit d’assurance n’est pas un moyen de dégager du revenu : il n’y aurait pas beaucoup de sens à calculer un « ROI » (retour sur investissement) d’un contrat d’assurance pour un assuré parce qu’il est normalement censé être négatif. Sur la longueur de son contrat d’assurance, l’assuré perd de l’argent mais, en échange, l’assuré limite la volatilité de son compte de résultat. L’assuré achète une certaine tranquillité d’esprit contre une espèce de rente versée à son assureur (sauf si l’assureur décide de perdre de l’argent sur son contrat d’assurance…). Il faut bien comprendre que les contrats d’assurance permettent de limiter les à-coups trop importants que chacun pourrait avoir sur son compte de résultat (ou compte en banque pour les particuliers). Par exemple, si ma maison brûle, c’est un risque de ruine pour moi parce que je ne peux pas assumer ce risque tout seul. De la même façon, si je tue quelqu’un en conduisant ma voiture, les montants à payer seront tellement gigantesques que je ne peux pas me permettre de ne pas m’assurer. Assurer son véhicule est d’ailleurs obligatoire pour cette raison et on peut d’ailleurs se dire que si cette assurance n’était pas obligatoire, peu de personne utiliseraient leur voiture par peur d’avoir un accident qu’ils ne pourraient pas rembourser. Par contre, si je me fais piquer mon portable dans le bus, je peux considérer que ce n’est pas un risque de ruine et je peux imaginer ne pas m’assurer pour ce type de risque là. Pour faire le parallèle avec l’agriculture, si, en tant qu’agriculteur, je peux supporter les à-coups financiers de plusieurs mauvaises productions successives, autant garder le risque pour moi et ne pas souscrire un contrat d’assurance. L’assurance climatique agricole protège contre les coups durs qui ne peuvent être absorbés par la seule épargne de l’exploitant. Il est ainsi donc possible de s’auto-assurer pour garder les bénéfices de l’assurance et pour ne pas dépendre de possibles variations de taux d’assurance dans les contrats souscrits auprès de mon assureur.
Il faut bien comprendre que les assureurs et réassureurs vont assurer des risques aléatoires. A partir du moment où le risque devient certain, il est entièrement prévisible et devient alors non assurable. Il y a donc une distinction très importante entre ce qui est du domaine de l’aléa (et qui peut être assuré) et ce qui est du domaine de la tendance (ce qui ne peut pas être assuré). L’assurance ne peut effectivement pas assurer une tendance (ex : une tendance au réchauffement climatique), mais au sein d’une tendance donnée, l’assurance peut assurer un aléa. Une autre façon de le dire est de distinguer, lors de l’aléa climatique, ce qui relève de la volatilité des risques et qui s’inscrit typiquement dans la logique assurantielle, de ce qui relève du niveau de garantie permettant d’indemniser une perte de production.
Comme le secteur bancaire, le secteur de l’assurance est lui-aussi très régulé. Les assureurs ont des fonds propre (c’est-à-dire des capitaux disponibles pour régler des sinistres dont le coût est élevé) – les réassureurs aussi d’ailleurs – et sont surveillés par des autorités de tutelle (l’ACPR par exemple en France). Il existe certes un fonds de garantie professionnelle mais l’Etat n’est pas censé intervenir. Le régulateur demande aux assureurs et ré-assureurs d’estimer en permanence leur solvabilité (ratios de solvabilité, mesures de risques, scénarios de risques et impacts sur la solvabilité…). La réglementation européenne « Solvabilité 2 » explicite que l’assureur a l’obligation de couvrir les sinistres à hauteur de 99.5% à horizon d’un an (en d’autres termes, cela veut dire également que l’assureur est supposé ne pas pouvoir payer ses sinistres une fois tous les 200 ans). L’assureur doit donc avoir suffisamment de fonds propres pour couvrir les sinistres. En tant qu’assuré, nous devons nous assurer que notre assureur (ou ré-assureur) aura les moyens de payer en cas de sinistre parce que si l’assureur fait faillite, l’assuré devra payer le coût de son sinistre, et l’effet domino commence à se lancer assez rapidement. Sur les marchés, les assurances sont notées (elles ont un « rating »). En souscrivant un contrat d’assurances, les assurés doivent ainsi s’intéresser au rating de leur assureur. Tous n’en ont pas (dans la pratique, seuls les assureurs cotés en bourse et/ou qui émettent des obligations sur les marchés financiers ont des ratings). Chaque assuré est en droit de demander le taux de solvabilité d’un assureur tel qu’il est défini par la réglementation, mais encore faut-il y connaitre quelque chose….
Comment les tarifs d’assurance sont-ils alors fixés ? Les assureurs ont besoin de développer des modèles de risque (ex : modèles climatiques, modèles de tremblement de terre…) pour calculer le risque que le sinistre leur tombe sur la figure. Les assureurs anticipent la fréquence et le coût de chaque sinistre pour tarifer leur contrat d’assurance et ainsi évaluer la prime d’assurance qu’ils vont demander de payer. Ce qui reste le plus difficile pour les assureurs est d’évaluer l’incertitude associée aux risques climatiques, notamment parce que ces incertitudes varient dans le temps. Les assureurs évaluent constamment ce que l’on appelle le rapport sinistre à prime (ou sinistre à cotisation), c’est-à-dire le ratio entre les primes d’assurances payées et par les assurés et les indemnisations versées par l’assureur. Si le rapport est supérieur à 1, l’assureur perd de l’argent parce qu’il verse plus d’argent qu’il n’en récupère via ses contrats. On parle même plutôt de ratio combiné en assurance qui s’exprime comme le rapport entre les décaissements (frais de gestion, commissions versées, provisions pour sinistres, et remboursement des sinistres), et les encaissements (primes et cotisations encaissées). Pour donner un ordre de grandeur, les frais de gestion du contrat d’assurance pour l’assureur, c’est-à-dire hors du montant estimé du coût des sinistres, représentent à peu près 20% du prix du contrat d’assurance total. On retrouve notamment dedans le coût de la réassurance, le coût du capital immobilisé, les frais de souscription des contrats (coût de commercialisation), les coûts de gestion des contrats, ou encore le temps de gestion d’expertise et les coûts de déplacement sur le terrain.
La tarification n’est pas évidente non plus parce qu’on ne connait pas toujours exactement ce qui s’est passé sur les années passées et ce qui se passera sur les années futures. Un exemple avec l’amiante. Lorsque l’amiante a été considérée comme cancérigène, les plaignants ont commencé à demander une indemnisation. Entre le moment où le problème est compris et où le procès a lieu, il peut se passer de nombreuses années. L’assureur se retrouve alors à tarifer dans un environnement assez obscur où il n’a pas toujours une bonne idée du risque encouru.
Les assurances fonctionnent par cycle et les contrats sont retarifés chaque année. La re-tarification chaque année n’est pas une obligation légale. Néanmoins, comme les modèles de solvabilité des assureurs sont à 1 an dans la réglementation, les contrats d’assurance ont tendance à l’être aussi. En théorie, les assureurs pourraient tout à fait être capable de faire tourner leurs modèles de risque sur 5 ou 10 ans. Et les assureurs auraient d’ailleurs intérêt à le faire sur plusieurs années pour mutualiser les risques, à la fois dans l’espace et dans le temps. Néanmoins, dans le cas de contrats d’assurance subventionnés (nous verrons le cas dans l’assurance agricole plus bas), l’assureur est tributaire de l’éligibilité à la subvention et cette éligibilité est fixée par décret tous les ans. Si l’Etat décidait de modifier le cahier des charges pour obtenir la subvention, l’assureur se retrouverait à ne plus pouvoir faire bénéficier l’assuré de sa subvention. Même si certains contrats d’assurance sont proposés sur de nombreuses années, il y aurait en réalité toujours une clause pour redéfinir les taux annuellement en cas de problème. Revenons à nos moutons. Si plusieurs années de suite, il y a une faible sinistralité, les prix baissent. Si au contraire, la sinistralité augmente, les prix des contrats d’assurance augmentent eux aussi. Quand les primes d’assurance versées par les assurés ne sont pas suffisantes par rapport à la sinistralité que les assureurs connaissent, les assureurs augmentent leur prix et se refont une santé dans la durée. Au moment de l’attentat du World Trade Center, les assurances sur la flotte aérienne ont augmenté énormément. Les quelques assureurs qui ont eu le courage de continuer à proposer des contrats d’assurances se sont faits beaucoup d’argent parce qu’il y a eu très peu de sinistre par la suite.
Assureurs et réassureurs font appel à des équipes en interne et consultants extérieurs (data scientists, climatologues…) qui offrent des services de modélisation et demandent des compétences et de l’expertise en mécanique des fluides, en prévisions météorologiques ou encore en analyse de données. L’agrométéorologie est ici importante pour trouver des formules de modélisation des dommages adaptées aux cultures qui sont couvertes. Mais tous les risques ne sont pas aussi facilement modélisables, les risques spécifiques sont les plus compliqués à considérer. Modéliser l’exposition d’un territoire à un risque reste une tâche difficile.
L’assurance face au déréglement climatique en agriculture
En France, dans le secteur agricole, on peut grossièrement découper les primes totales assurantielles en trois grands blocs de même taille. Le premier tiers pour les assurances des bâtiments et les animaux. Le deuxième tiers pour les machines agricoles. Et le troisième tiers pour les assurances climatiques. Avec le déréglement climatique que nous connaissons, la donne va changer demain parce que les cultures seront l’ensemble des actifs les plus exposés aux évènements climatiques. Les risques auxquels est exposée l’agriculture française vont effectivement en s’aggravant. On observe une tendance à une forme de tropicalisation du climat qui se conjugue avec un coup d’arrêt historique à l’augmentation ou la stabilité des potentiels de production. Les récentes concertations des Assises de l’eau et du Varennes de l’eau ont montré que le sujet était complètement d’actualité.
Force est de constater que les assureurs ont surtout une vision court terme, sauf peut-être sur la responsabilité civile. Si auparavant, c’était l’impact d’une activité directe d’une entreprise qui était indemnisée, on commence à voir des activités indirectes pointer le bout de leur nez. On a pu voir par exemple récemment que le port de Los Angeles a dû indemniser les habitants vivant proche du port à cause du CO2 et des particules fines dégagées par les camions alimentant le port. Avec la sensibilisation en cours sur le déréglement climatique, tous les impacts négatifs que certains types d’activité vont amplifier vont être sujettes à procès.
Nous avons vu plus haut que les évènements climatiques font de plus en plus mal au portefeuille (Figure 3). Ces évènements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus chers, notamment parce qu’en construisant toujours plus d’infrastructures, nous augmentons indéniablement notre vulnérabilité. Les assureurs n’ont pas assez de fonds propre pour gérer de grosses catastrophes climatiques et s’assurent ainsi « en excès » auprès de ré-assureurs (en tant qu’assureur, je considère par exemple qu’au-delà de 2 millions d’euros de perte, je ne peux plus seul faire face au règlement des sinistres). Les ré-assureurs ont les reins plus solides avec leur portefeuille d’assurés plus diversifié, ont plus de fonds propres et de capitaux, et peuvent ainsi prendre ce risque en excès.
Néanmoins, assureurs et réassureurs commencent à se poser de plus en plus de questions. Dans le domaine de la prévision du risque, ces acteurs se rendent compte que les modèles climatiques construits avec des données du passé pour prédire ce qui pourrait se passer dans le futur ne sont plus d’actualité. Il n’y a plus de stationnarité dans le climat. Les modèles se doivent de devenir déterministes, en incluant des paramètres physiques, économiques, sociologiques et plus seulement statistiques pour appréhender le risque. Croiser les enjeux et les aléas demande de développer des modèles beaucoup plus complexes, pour anticiper et mieux prédire, et tarifer les risques. Un des mes interviewés m’aura fait la blague suivante : « les statistiques qu’on utilise pour tarifer, c’est une lanterne pour éclairer l’avenir et on la porte derrière son dos ». Le fait est que le passé n’explique plus le futur en termes d’aléas, ce qui peut aussi expliquer pourquoi une bonne partie des résultats sont chroniquement déficitaires, avec la possibilité que les réassureurs et assureurs se désintéressent de certains types de risques.
Avec le déréglement climatique, ce sont également les réglementations qui évoluent. Les assureurs commencent à être notés (les notations ESG – Environnement, Social et Gouvernance). L’impact carbone des actifs des assureurs (notamment le type d’obligations achetées) doit être publié. Bref, on peut se laisser à rêver qu’avec le déréglement climatique, certains types d’activités polluantes ne seront plus assurées (même si on est d’accord que ça n’est pas vraiment la tendance qu’on observe pour l’instant…).
L’assurance, un des nombreux volets de la gestion des risques en agriculture
L’agriculture est à la fois un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi celui le plus sensible aux conséquences du déréglement climatique. Il est donc absolument nécessaire que le secteur agricole diminue son empreinte mais aussi, et surtout, soit en capacité de s’adapter aux risques encourus. Et ces risques sont très nombreux : gel, pluie violente, inondation, excès d’hygrométrie, tempête, poids ou excès de neige, grêle, excès de température, sécheresse, ou encore manque de rayonnement. On pourrait même en imaginer plein d’autres, non directement climatiques, comme par exemple : pas de germination, absence de nouaison…
Ce dossier est consacré à l’assurance en agriculture, et plus particulièrement à l’assurance climatique (nous reviendrons sur tout ça très rapidement). Il faut néanmoins bien comprendre que l’assurance agricole s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques et qu’il existe de nombreux leviers que l’on peut mobiliser pour s’adapter au déréglement climatique en cours. Ces leviers – multiformes – peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaison :
- Leviers agronomiques : Choix des variétés adaptées à l’environnement local et résistantes au déréglement climatique, mélange variétal, densité de semis, semis direct sous couvert, décalage des dates de semis, conservation d’une bonne valorisation des surfaces en herbe, diversification de cultures, changement de race animale, avancement de la mise en herbe, réduction du Cheptel
- Leviers techniques : Mise en place de systèmes d’irrigation et/ou de drainage, filets anti-grêle, panneaux photovoltaiques…
- Leviers économiques : Augmentation de sa capacité d’autofinancement, mise en place d’une épargne de précaution (DEP) pendant les années difficiles, souscription à un ou plusieurs contrats d’assurance,
- Leviers stratégiques : diversification des activités sur l’exploitation, réorientation des circuits de commercialisation, ré-orientation vers des systèmes de production labellisés, autonomisation de son système agricole, réalisation des activités de transformation sur la ferme pour augmenter la valeur ajoutée produite, réduction de la dépendance énergétique sur l’exploitation, anticipation et analyse des risques sur son exploitation en se formant
Une des premières actions, peut-être la plus importante consiste à agir en prévention à l’aléa climatique grâce à différentes techniques agricoles qui permettent d’être moins dépendant des conditions climatiques.
L’assurance agricole
L’assurance indemnitaire
Les assurances « climatiques » ou assurance « récolte » en agriculture sont de deux ordres :
- Les assurances dites « indemnitaires » sont les assurances qui indemnisent les agriculteurs sur la base d’une évaluation des dommages effectuée par un expert sur l’exploitation. Nous reviendrons notamment sur l’assurance grêle et l’assurance multi-risques climatiques (MRC)
- Les assurances dites « paramétriques » ou « indicielles » qui indemnisent les agriculteurs sur la base de la déviation d’un « indice » ou d’un « paramètre » par rapport à l’attendu
Notez que le terme d’ « assurance récolte » n’a pas la même signification dans la bouche de tout le monde. Je l’utiliserai ici dans une acception assez large (grêle, tempête, assurance indicielle, multirisques…). Certains n’y verront ou ne penseront qu’à l’assurance multi-risques climatiques, à tort.
Nous allons balayer ici leurs principales caractéristiques.
Le contrat Grêle
Les assureurs offrent à la filière agricole des contrats pour s’assurer contre le risque de grêle. En France, ce type de contrat représente à peu près la moitié du business de l’assurance climatique. C’est un contrat indemnitaire en ce sens que l’expertise est humaine et qu’elle est gérée à peu près de la même façon par tout le monde.
Le monde de l’assurance grêle est connu depuis de nombreuses années par les principaux assureurs du marché. La grêle un péril « nommé », c’est-à-dire que c’est un risque qui est énuméré explicitement. L’assurance grêle fonctionne sans subvention et c’est un contrat qui, globalement, est équilibré pour les assureurs (le rapport sinistre à prime est de l’ordre de 70 à 80%). Il faut donc y comprendre que les cotisations des assurés sont suffisantes pour payer les sinistres de l’année et faire des provisions pour faire face à des sinistres où le rapport sinistre à prime est plutôt de l’ordre de 200%, 300 % voire plus (en gros quand ça commence à grêler sévère…).
Les contrats d’assurance grêle sont différenciés par zone grellifère. Les assureurs disposent de zoniers (cartographie de zones grellifères) parce que les couloirs grellifères sont bien connus. Il est par exemple clairement su que, sur la commune de La Chapelle-en-Vercors, la grêle tombe une année sur deux. Les abricotiers qu’on y trouve coûtent donc très cher à assurer. Même sans subvention pour ce contrat d’assurance, les agriculteurs souscrivent parce qu’ils ont conscience du risque encouru et des dégâts potentiellement générés sur leur production. C’est un risque très concret, qui fait peur, et les agriculteurs s’assurent d’autant plus qu’en cas de problème, ils savent que l’Etat n’interviendra pas.
Le contrat Multi Risque Climatique (MRC)
L’assurance multirisques climatiques (MRC) a été lancée en France en 2005 suite aux sécheresses et canicules de l’année 2003 dont la plupart d’entre nous se rappellent encore (rapport du député Christian Ménard). Avant 2005, l’Etat couvrait seul ce risque climatique grâce au régime des Calamités Agricoles (ce régime a été mis en place en 1964). Ce régime des calamités – parfois appelé par raccourci fonds des calamités agricoles – est financé par le Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) ; ce fonds de solidarité étant alimenté par des taxes payées par les agriculteurs et complémenté par du budget national de l’Etat (c’est d’ailleurs pour ça qu’il n’y a pas de TVA en agriculture puisqu’il existe déjà des taxes pour alimenter ce régime des calamités agricoles). Suite à la sécheresse de 2003, le budget du régime des calamités agricoles a littéralement explosé – avec une multiplication d’un facteur 4. L’Etat a alors organisé le déploiement d’une industrie privée de l’assurance dédiée à ce secteur, aux côtés de l’Etat ; l’assurance MRC était née.
Contrairement au contrat d’assurance grêle, l’assurance MRC est subventionnée, actuellement à 65%. Beaucoup de pays choisissent de subventionner l’assurance récolte parce que l’agriculture est un secteur stratégique d’un point de vue de gouvernement. Comme nous l’avons discuté plus haut, l’assurance est une voix parmi d’autres dans la stratégie de gestion des risques. Au niveau européen, il a été fait le choix d’évoluer d’un mode de subvention direct à l’agriculture (les aides directes de la PAC) à un mode indirect en favorisant l’investissement dans du matériel de protection ou en subventionnant l’assurance récolte. L’idée derrière la subvention étant de faire en sorte que les contrats d’assurance se diffusent au sein des exploitations pour que, une fois rentrés dans les mœurs, cette subvention soit petit à petit réduite et que le système assurantiel tourne tout seul.
Pour revenir à la MRC, pour un contrat d’assurance MRC au prix de 100€, l’agriculteur n’en paye aujourd’hui actuellement que 35 (le contrat est subventionné à 65%). Pour un contrat mis en place pour la récolte 2022, l’agriculteur paye sa prime d’assurance en octobre 2022 et la subvention lui est versée autour de mars 2023. Dans la décision de subventionner un contrat d’assurances, il a été décidé par le gouvernement qu’un contrat subventionnable était un contrat qui ne s’intéressait pas qu’à un seul risque mais à plusieurs (le contrat MRC doit contenir 17 aléas climatiques pour être éligible à la subvention). L’idée derrière étant qu’il ne sert à rien de subventionner un contrat qui ne tient compte que d’un seul aléa si l’objectif final est de sécuriser les exploitations. L’aléa grêle est inclus dans l’assurance MRC mais certains assureurs ont une formule de base subventionnée et une formule supplémentaire pour la grêle (un contrat d’assurance grêle spécifique comme on l’a vu dans la section précédente) avec une franchise spécifique pour chaque parcelle indépendamment (la formule de base de la MRC couvre la grêle avec une franchise à l’appellation ou à la culture, ce qui n’est pas forcément avantageux…). Nous reviendrons sur le concept de franchise un peu plus loin.
L’assurance MRC permet ainsi aux exploitants agricoles de bénéficier d’une couverture des risques étendue à l’ensemble des risques climatiques et adaptée à leurs besoins individuels. Jusqu’à 2022, les souscriptions au contrat d’assurance MRC étaient soumises à quelques contraintes. Il s’agissait notamment pour une exploitation viticole d’avoir l’ensemble de ses surfaces couvertes, et pour les grandes cultures d’en avoir au moins 70%. En plus de l’objectif premier de sécuriser les exploitations agricoles, le contrat MRC avait plusieurs intérêts associés. Pour l’agriculteur, c’est déjà au départ un gain en visibilité et en gestion, dans le sens où il est plus simple d’assurer toute son exploitation d’un coup qu’un petit bout par ici et un petit bout par là. Pour l’assureur, ce contrat est une manière de diversifier son portefeuille de clients ; il vend plus d’assurances que s’il ne vendait qu’une assurance grêle. Pour l’administration, mais aussi pour l’assureur, c’est aussi une dimension de simplicité qu’il faut entrevoir. Les Directions Départementales des Territoires (DDT) vont être en effet responsables de collecter et vérifier que les contrats sont bien éligibles, de vérifier les prix unitaires des contrats, que les surfaces correspondent aux surfaces PAC déclarées, ou encore que la totalité des surfaces en vigne d’une exploitation sont couverte si elle souscrit un contrat d’assurance MRC.
Parallèlement au lancement de l’assurance récolte, l’accompagnement législatif n’est pas beaucoup intervenu pour faire évoluer le fonds des calamités agricoles et pour faire coexister calamités et assurance. Le dispositif de l’assurance récolte a été pensé au départ comme un nouveau dispositif se rajoutant au dispositif des calamités agricoles, les deux régimes coexistant et s’articulant tant bien que mal, avec des pratiques variant par département. Initialement, la volonté de l’Etat était de laisser se développer l’assurance privée jusqu’à ce que la diffusion de l’assurance soit suffisante, pour ensuite faire sortir les cultures concernées par l’assurance du régime des calamités agricoles. L’idée étant qu’à terme, seule l’assurance privée resterait en place et que le régime des calamités agricoles sortirait peu à peu de la scène. C’est ainsi qu’en 2009, les grandes cultures sont sorties du régime des calamités agricoles. La viticulture a suivi en 2011. Le champ d’intervention du régime des calamités agricoles a donc été réduit, les secteurs de la viticulture et des grandes cultures étant alors réputés souffrir de risques assurables. Le positionnement du régime des calamités ou, plus rigoureusement, le champ d’intervention de la partie du FNGRA qui indemnise les « calamités » agricoles, est centré sur ce qui est réputé non assurable. Les autres cultures (prairies, arboriculture, maraichage) sont quant à elles restées éligibles.
Depuis 2005, environ 30% des grandes cultures et des vignes sont assurées sur le contrat de récolte. On tombe en dessous de 5% sur les autres cultures. La situation n’aurait pas évolué depuis 2011. Le niveau d’assurance est loin d’être le même partout sur la planète. Dans le monde, les Etats-Unis, la Chine, et l’Inde concentrent trois quarts des primes d’assurance agricole payées par la filière agricole (CICA, 2020). Même si la population de ces pays reste très nombreuse, on se rend quand même compte que l’ensemble de la population mondiale agricole n’est pas assuré de la même manière. Dans un rapport de 2020, la Confédération Internationale du Crédit Agricole précisait d’ailleurs que la valeur des primes d’assurance agricole en 2016 serait autour de 7% de la valeur de la production agricole (CICA, 2020). Dans le monde, certains de mes interviewés m’auront donné le chiffre de 20% des cultures assurées, et à peine 2% de la production herbagère.
Actuellement, pour avoir accès aux assurances, les exploitations doivent avoir un numéro de pacage (en ayant donc déjà réalisé une déclaration PAC) – la demande d’assurance se faisant pendant la déclaration de son dossier PAC.
Pourquoi les agriculteurs ne sont-ils pas plus assurés en MRC ?
Bien malin celui qui sera capable d’expliquer complètement pourquoi seuls 30% de viticulteurs et de producteurs de grandes cultures sont actuellement assurés avec un contrat MRC (et encore moins en arboriculture, maraichage, et prairies). Les explications sont extrêmement larges et multi-dimensionnelles. Une première explication est peut-être plutôt de l’ordre psychologique. Une sorte de déni dans lequel l’agriculteur se convainc que le risque n’arrivera jamais chez lui ou sur ses cultures. Dans la Beauce, certains agriculteurs se sentaient hors périmètre jusqu’aux inondations catastrophiques de 2016. Il est vrai que la culture du risque chez les agriculteurs n’est pas extrêmement développée, les formations proposées sont quasi inexistantes (nous en parlerons dans la dernière partie de ce dossier de blog). Mais il est vrai également que les agriculteurs sont aussi des parieurs devant l’éternel. C’est un côté que l’on peut comprendre aussi dans le sens où ils évoluent dans un environnement particulièrement instable et risqué.
Il y a déjà un premier risque lié à la production même ou au rendement sur l’exploitation, chaque culture étant soumise à sa manière à un très grand nombre d’évènements qui influent sur le niveau de production. Lors de la contractualisation de la vente de leur production, les agriculteurs sont également soumis à des critères de qualité de récolte. Les risques sur les prix sont particulièrement nombreux. On y trouve par exemple une instabilité dite « importée », liée aux marchés financiers mondiaux et à la variabilité du cours des matières premières, une instabilité « naturelle » avec des aléas climatiques et naturels qui impactent la production en rendement et en qualité, et une instabilité « endogène » qui pousse les agriculteurs à anticiper le prix de vente d’une production et qui produit des fluctuations décorrélées du marché. Par exemple, l’explosion du prix de vente d’une céréale poussera de nombreux agriculteurs à cultiver cette céréale l’année suivante, ce qui engendrera une surproduction et par conséquent une chute brutale des prix des récoltes de l’année suivante. Une source d’incertitude réside également dans les coûts de production, c’est-à-dire l’ensemble des charges opérationnelles et des charges de structures nécessaire pour assumer une saison complète de production. On peut même très largement y rajouter les risques à des échelles un peu plus larges ; avec des risques opérationnels, liés à l’agriculteur lui-même (décès, maladie, invalidité) ou à son exploitation (incendies, vol, dégradations…), des risques financiers puisque l’agriculteur peut être soumis à des variations de taux sur ces différents contrats ou à des problématiques de liquidité de son compte d’exploitation, ou encore des risques institutionnels liés à des changements de politiques, de régulation et de normes (ex : une nouvelle réglementation sur un intrant, une régulation sur l’importation ou l’exportation de certaines denrées..)
Les agriculteurs ne sont également pas forcément très habitués à souscrire des contrats d’assurance de leurs cultures et préféreront alors s’auto-assurer. Les agriculteurs sont plutôt habitués à assurer leurs bâtiments et leur matériel.
Une autre raison invoquée serait plutôt liée au fait que les agriculteurs considèrent que l’Etat sera toujours présent pour intervenir s’il y a vraiment un problème. Nous avons vu plus haut que les grandes cultures et les vignes étaient sorties du régime des calamités agricoles, respectivement en 2009 et 2011. Pourtant, à la suite du gel de printemps de l’année 2021, nous avons vu l’Etat intervenir en remettant de l’argent sur la table. En 2011, les fonds des calamités agricoles avaient également été déclenchés en prévision d’une séchresse qui n’a finalement pas eu lieu. En intervenant ex-post, l’Etat envoie le message qu’il sera toujours présent, et les agriculteurs ne voient alors plus forcément l’intérêt de se protéger avec un contrat d’assurances privé.
Il y a peut-être très certainement une mauvaise compréhension du dispositif, avec une offre apparaissant souvent complexe, avec des règles de subventions difficilement appréhendables et une articulation des dispositifs loin d’être évidente. Certains contrats demandent un délai de souscription très précoce par rapport à la saison agricole (ex : une souscription à la fin décembre pour une saison qui commence en mars/avril), ce qui demande aux agriculteurs de se positionner en avance et d’anticiper les risques. Bien que ce dossier de blog soit d’une absolue limpidité (il faut savoir se jeter quelques fleurs), la compréhension des mécanismes assurantiels en place n’a pas été chose facile… La réforme en cours cherche justement à harmoniser et à simplifier les processus en place de l’assurance multi-risques climatique, mais il faut quand même se retrousser les manches et y passer un peu de temps pour vraiment comprendre ce qui se passe.
Certains agriculteurs auront aussi tendance à se plaindre que les primes d’assurances proposées sont trop élevées, et que les contrats sont mal tarifés par rapport à leur risque. Le concept de « référence olympique », qui correspond au niveau moyen de rendement qui est assurable sur l’exploitation est souvent remis sur la table. Avec plusieurs mauvaises années à la suite, la référence olympique diminue entrainant avec elle à la baisse le niveau de rendement assurable, et le contrat d’assurance devient alors nettement moins intéressant pour l’agriculteur.
Même si ce type de contrat est subventionné, les agriculteurs considèrent le prix trop élevé et ne souhaitent pas s’assurer. Encore une fois, il y a l’imaginaire que l’on est content de payer que si on est sûrs que ça va nous servir à quelque chose. Peut-on vraiment leur en vouloir ? L’argumentaire autour du coût de des contrats d’assurance est-il vraiment justifié ? Nous reviendrons également dessus plus loin.
Rajoutons également que dans certaines filières, les offres actuelles ne sont pas nombreuses ou considérées comme suffisamment pertinentes pour s’y intéresser.
Anti-sélection et Aléa moral : les principaux phénomènes de l’assurance indemnitaire
On peut distinguer quatre phénomènes ou types de risques associés à l’assurance indemnitaire.
Le risque idiosyncratique, ou « spécifique » est une composante propre à chaque agriculteur. C’est un risque indépendant qui ne touche pas toutes les personnes à risques en même temps. C’est en quelque sorte le marqueur spécifique d’un agriculteur. Par exemple, chaque agriculteur a un risque de voir un de ses bâtiments agricoles brûler. On peut s’accorder pour dire que ce risque est indépendant du risque que son voisin a de voir son bâtiment lui aussi brûler. Le risque idiosyncratique est indépendant entre chaque assuré et est donc un risque mutualisable.
Le risque systématique ou systémique est le risque qui ne touche pas un individu en particulier mais un ensemble d’agriculteur ayant une caractéristique commune, comme par exemple la zone géographique ou le type de culture. Les inondations, période de sécheresses et maladies (lorsqu’elles sont étendues) sont des exemples de risques systémiques. L’inconvénient de ce risque est qu’il est non diversifiable et ne peut donc être couvert par des mécanismes assurantiels classiques. La méthode de couverture couramment utilisée est de rajouter au prix du contrat de l’assurance une marge de risque plus ou moins élevée selon la probabilité d’occurrence du risque.
Les assurances indemnitaires sont sujettes à des problèmes d’asymétrie d’information, dans le sens où l’assureur et l’assuré n’ont pas le même niveau d’information quant au caractère risqué de la production agricole et des pratiques de production. On s’attend en effet à ce que les agriculteurs soient mieux informés sur les deux tout simplement parce qu’ils sont sur le terrain et que c’est eux qui gèrent leur exploitation. Cette asymétrie d’informations génère deux problèmes bien connus par les assureurs : l’anti-sélection et l’aléa moral.
L’anti-sélection représente le fait que les agriculteurs qui s’assurent sont ceux qui sont exposés à des risques supérieurs à la moyenne. A la signature d’un contrat d’assurance, l’assureur ne connait pas précisément le risque de l’assuré, et sera donc tenté d’augmenter le prix du contrat d’assurance pour se couvrir face aux individus présentant le plus de risques. L’assureur se retrouve alors dans une situation où seuls les agriculteurs avec de mauvais risques – en gros, les risques qui font mal et qui ont de grandes chances d’arriver – s’assurent car il n’y a que pour eux que le coût de la prime d’assurance est justifié. Un agriculteur qui sait que son terrain est soumis à relativement peu de risque n’aura pas forcément envie de s’assurer au prix d’une prime d’assurance trop élevée. Le portefeuille d’assurés d’un assureur aura donc tendance à ne pas être représentatif d’un risque moyen sur une zone. L’assureur a en quelque sorte plus de mauvais risques que de bons risques dans son portefeuille. Il faut dire qu’au sein même d’un territoire, quelle que soit sa taille, certaines zones sont soumises à des risques plus importants que d’autres, certaines parcelles sont par exemples plus gélives que d’autres tout simplement parce que la topographie y est très différente.
L’aléa moral, quant à lui, est le phénomène qui pousse les agriculteurs à adopter des pratiques de production plus risquées lorsqu’ils sont assurés. On peut distinguer deux types d’aléas moral : l’aléa ex-ante (au préalable) et l’aléa ex-post (après les faits). On parlera de risque ex-ante lorsque l’agriculteur modifie volontairement ses pratiques – par exemple en diminuant sa consommation d’intrants – pour réduire ou modifier la distribution des rendements sur ses parcelles et ainsi toucher une indemnisation via son contrat d’assurances. On parle ici de risque ex-ante pour l’assureur parce qu’aucun sinistre n’a eu lieu sur les parcelles. Le risque ex post concerne le risque de fraude, c’est-à-dire qu’un agriculteur peut être amené à négliger une parcelle ayant subi des dommages afin de récupérer ou d’augmenter une indemnisation.
Pour limiter les problèmes d’asymétrie d’information, une des façons de s’en sortir pour les assureurs est de mettre en place des franchises, et de faire déplacer des experts sur le terrain. Bien que l’assureur soit souvent vu comme un voleur dans le sens où l’assuré a de plus en plus tendance à attendre de regagner sa mise de départ (c’est l’idée que parce que l’on paye une assurance, il faudrait forcément toucher quelque chose derrière), force est de constater que s’il n’y avait pas d’expertise sur le terrain, l’assureur paierait surement beaucoup plus cher que ce qu’il devrait réellement payer.
Assurance marge et assurance chiffre d’affaires
Les principaux formats actuels d’assurance indemnitaire récolte se concentrent autour du risque de rendement ou de production, c’est-à-dire une perte de quantité de production. On rentre dans un domaine qui est plus de l’ordre de la banque que de l’assurance.
En termes de couverture, certaines assurances « chiffres d’affaires » commencent à se développer, l’objectif n’étant pas de couvrir un risque prix directement mais d’intégrer une dimension de prix dans la couverture. Le risque prix n’est pas directement couvert par les assureurs parce qu’il n’est pas mutualisable, même à l’échelle mondiale. Au niveau climatique, lorsqu’une sécheresse apparait à un endroit donné et pas à un autre endroit, les évènements sont indépendants (dans une certaine mesure pour les lecteurs les plus tatillons). Sur un risque prix, si le Nebraska et la Corn Belt ont un problème sur le maïs, le prix sur l’ensemble du globe va monter – les évènements ne sont donc plus indépendants. La solution actuelle, peu utilisée, est d’assurer le rendement via de l’assurance MRC et d’assurer le prix via des marchés à terme. La possibilité pour l’agriculteur de se couvrir existe déjà. Mais les assureurs et réassureurs n’assureront pas vraiment directement un risque prix. Aux Etats-Unis par exemple, l’assurance chiffres d’affaires ne fait pas l’unanimité. Certains contestent son principe au motif qu’elle induirait des dépenses publiques même lorsque les prix des cultures sont élevés. Mieux vaudrait, selon eux, restreindre l’aide de l’Etat à la fourniture d’un filet de sécurité contre les aléas climatiques, limité à la couverture des principaux coûts de production. D’autres, au contraire, dénoncent le fait que les subventions de primes et les indemnités versées sont proportionnelles à la production et favorisent ainsi les grandes exploitations et la concentration des terres agricoles au profit de quelques-uns. Ils réclament, en conséquence, une réduction des aides versées par le programme aux plus gros producteurs.
Certains assureurs travaillent également sur une assurance « marge » qui change la donne en termes de logiques, notamment sur les systèmes extensifs. Prenons l’exemple de deux agriculteurs céréaliers avec des situations un peu serrées et un risque de mauvais rendement. Imaginons que ces agriculteurs se demandent si, oui ou non, ils doivent appliquer un dernier apport d’azote sur leurs parcelles. Le fait de faire le dernier pas pour essayer d’avoir son rendement (ici, d’appliquer un dernier apport d’azote) peut être considéré comme une opération à risque pour l’agriculture. Il pourrait donc y avoir plein de cas où celui qui ne fait pas le dernier pas en sort gagnant s’il a le filet de l’assurance (nous avons parlé d’aléas ex-post, on est dans ce cas-là ici). Si, au contraire, un assureur avait sécurisé la production de ce céréalier avec une assurance marge, peut-être que cet apport d’azote aurait été réalisé. Tout le monde est gagnant donc ça change la logique du système d’assurance.
La réforme de l’assurance agricole en France
Comment fonctionnent les contrats MRC depuis leur création
En France, jusqu’à 2022, le contrat multi-risque climatique de gestion des risques s’articule autour de trois piliers principaux :
- Un premier niveau non subventionné, qui correspond en fait à une sorte de franchise que l’agriculteur devra de toute façon payer s’il a un sinistre (c’est le reste à charge de l’agriculteur). Cette franchise, c’est la manière avec laquelle l’assureur ou le courtier d’assurance peut jouer pour faire changer le coût de la prime d’assurance payé par l’agriculteur (en augmentant sa franchise, l’assuré réduit sa prime d’assurance et vice-versa). Certains assureurs proposent également des rachats de franchise, qui sont une garantie complémentaire où l’agriculteur paye plus cher le montant de la prime d’assurance mais qui, en échange, ne paye pas ou alors très peu les franchises appliquées en cas d’accident.
- Le deuxième niveau correspond directement à l’assurance privée. C’est bien ce deuxième niveau qui est subventionné. En France, il a été décidé de subventionner les primes d’assurance climatiques avec une part du budget européen de la PAC (Politique Agricole Commune), et plus particulièrement celui du deuxième pilier : le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Sur l’exemple présenté plus haut d’un contrat d’assurance MRC de 100€ subventionné à 65%, l’agriculteur ne paierait en réalité que 35€ pendant que la PAC, elle, serait utilisée pour payer les 65€ restants. L’agriculteur supporte ainsi une partie limitée du montant du contrat d’assurance qu’il souscrit.
- Le troisième niveau correspond à l’intervention publique de l’Etat avec le régime des calamités agricoles. Ce troisième niveau ne doit pas ici être considéré comme une subvention mais comme une aide, sous la forme d’un principe de solidarité nationale.
Trop facile, super clair, j’ai tout compris ! Trois niveaux différents avec une franchise, une assurance privée et une intervention publique de l’état. Minute papillon… on va rajouter un peu de complexité avec les niveaux de garanties et les différents types de contrats auxquels on peut faire face. Si vous avez bien tout suivi, vous aurez compris qu’une partie du coût d’un contrat d’assurance est lié directement à l’assurance privée avec une partie du coût de l’assurance prise en charge par la PAC (c’est le deuxième niveau dont on a parlé). J’ai donné l’exemple d’une subvention de 65% pour se rendre compte des mécanismes sous-jacents. Ces 65% correspondent en réalité à un premier niveau de garantie (niveau socle) et sont liés à tout un tas de critères (références nationales et barème pour plafonner le capital assuré, part de la surface de l’exploitation à assurer, indemnisation des pertes de quantité, seuil de déclenchement [correspond au niveau de perte de récolte à partir duquel la subvention a lieu – par exemple, il faut qu’il y ait au moins 30% de perte de rendement], Franchise minimum) dans lesquels nous n’allons pas rentrer pour ne pas trop nous perdre.
Il faut donc comprendre ici que la France mobilise le deuxième pilier de la PAC (FEADER) pour financer jusqu’à 65% du montant de la cotisation d’assurance correspondant au 1er niveau de garantie (niveau socle). Ce premier niveau de garantie vise à donner les moyens à l’agriculteur de relancer un cycle de production. La France est allée également plus loin pour la subvention de ce contrat d’assurance privée en ajoutant la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires optionnelles, subventionnée à taux moindre que le niveau socle (à 45% ici contre 65% pour le niveau socle) permettant à l’agriculteur de diminuer la franchise et d’adapter la couverture à ses risques propres. Un troisième niveau de garanties, dites optionnelles, existe également pour permettre à l’agriculteur d’adapter davantage encore le contrat souscrit en fonction de ses caractéristiques. Ce troisième niveau n’est pas subventionné par le FEADER. Notez que les contrats d’assurance récolte bénéficiant de ces subventions ne peuvent pas recevoir d’autres aides financées par des crédits de l’État, des collectivités territoriales ou de l’Union européenne
Rajoutons également un point sur le fait que deux grands types de contrats d’assurance récolte sont subventionnables :
- les contrats dits « par groupe de cultures » dont le principe est de verser une indemnisation spécifique à chaque type de culture dès que la perte de production constatée suite à un sinistre pour cette culture est supérieure au seuil de déclenchement. Ce n’est pas un contrat par parcelle mais bien par lot de parcelles sur lesquelles poussent la même culture. Notez que, pour ce type de contrats, une surface minimale par type de cultures doit être assurée. Par exemple, pour avoir un contrat MRC Grandes cultures sur son exploitation, il faut qu’au moins 70% de la surfaces en Grandes cultures de l’exploitation soit couverte par le contrat
- les contrats dits « à l’exploitation » dont le principe est de verser une indemnisation si le total des pertes sur les types de cultures assurées suite à un sinistre est supérieur au seuil de déclenchement. La différence principale avec le contrat dit par « groupes de cultures » est qu’ici, il y a une mutualisation entre les types de cultures assurées, les gains sur un type de culture pouvant compenser les pertes sur un autre type de culture. Pour souscrire ce contrat, il y a, comme pour le contrat précédent, des obligations de couverture. Il est demandé à ce qu’au moins 80% de la superficie sur les cultures vendues de l’exploitation soient assurées et qu’au moins deux types de cultures différentes soient assurées.
Pourquoi une réforme ?
Les principaux défenseurs de la réforme en cours mettent en avant que le système actuel d’indemnisation des pertes liées aux aléas climatiques serait à bout de souffle. Plusieurs raisons sont invoquées :
Les acteurs historiques de l’assurance agricole perdent de l’argent. A partir de 2016, le dispositif des principaux assureurs est parti en vrille (nous avons parlé plus haut des grosses inondations qui ont eu lieu). Les sinistres se sont multipliés et ont atteint des niveaux de sinistres à prime de près de 200% (les assureurs ont versé deux fois plus que ce qu’ils avaient touché avec les primes d’assurance). Jusqu’en 2021, les ratios ne sont pas redescendus en dessous de 100%. Les années comme 2016 ne sont plus exceptionnelles et les conséquences du changement climatique continuent à se développer (évènements en fréquence et en intensité). Pour les principaux assureurs, le système est devenu insoutenable. Les assureurs ont dû revoir leurs conditions tarifaires et leurs garanties sous la pression de leurs réassureurs et de l’autorité de tutelle (ACPR).
Le contrat multi-risques climatiques MRC a un taux de pénétration de seulement 30% auprès des agriculteurs. Il n’y aurait pas assez d’exploitations qui souscrivent pour pouvoir bien équilibrer le portefeuille de risques des assureurs. C’est le phénomène d’anti-sélection dont nous avons parlé, qui conditionne le fait que les bons risques vont sortir du portefeuille pour ne laisser que les mauvais risques en majorité. En assurance traditionnelle, les tarifs sont lissés par zone (commune, département…). Si le lissage ne se fait qu’avec des mauvais risques, une exploitation avec un risque faible aura un tarif très largement déséquilibré par rapport à celle soumise à un risque beaucoup plus important. Certains auront néanmoins tendance à dire que le fait de n’avoir « que » 30% de souscription aux contrats d’assurance récolte actuellement pour les grandes cultures et la vigne n’est pas forcément un signe de mauvais fonctionnement. C’est peut-être aussi le fait que certaines exploitations préfèrent s’auto-assurer et gérer le risque toutes seules parce qu’elles sont suffisamment solides.
La cohabitation assez maladroite entre les assurances privées et l’intervention publique de l’Etat via le régime des Calamités Agricoles serait à l’origine d’un effet d’éviction trop important des agriculteurs dans le sens où ces derniers se reposeraient trop sur un appui de l’Etat en cas de coup dur (nous avons parlé par exemple de l’intervention de l’Etat pour le gel de 2021 sur vignes alors que la viticulture était sortie du régime des calamités agricoles). L’articulation entre les directions départementales du territoire (DDT), qui ont en charge la gestion du régime des calamités agricoles sur le terrain, et les assurances privées n’est pas toujours très efficace, et en a parfois fait des systèmes plus concurrents qu’autre chose. Les taux de pertes mesurés dans les deux cas ne sont pas toujours les mêmes parce que les expertises locales et les critères de déclenchement peuvent être très différentes (les assureurs utilisaient des moyennes olympiques de rendement mais le régime des calamités agricoles ne les prenaient pas en compte). Les agriculteurs peuvent alors se retourner contre leur assureur ou contre l’Etat en traitant l’un ou l’autre de voleur.
La frontière entre ce qui est assurable (assurance privée) et ce qui ne l’est pas (intervention publique) est absolument décisive, notamment parce qu’elle n’est pas totalement claire et qu’elle est en plus évolutive dans le temps (certains risques ne sont – ou ne seront – plus assurables). A noter que l’intervention publique de l’Etat lors d’un aléa climatique n’est pas obligée de se manifester sous une forme économique. Plusieurs actions sont imaginables (et ont déjà eu lieu pour certaines). Les jachères déclarées d’intérêt écologique peuvent être utilisées en cas de sécheresse. Les néonicotinoïdes ont par exemple également été récemment autorisées sur certaines cultures. L’exercice du Varennes de l’eau a proposé de réguler l’approvisionnement des méthaniseurs lorsqu’il y avait des tensions sur les ressources fourragères pendant des aléas climatiques.
Toute la complexité actuelle réside dans le fait que l’ensemble de ces seuils (seuil de franchise, seuil de déclenchement…) et des critères de subvention et d’aides varient d’une culture à l’autre. Jusqu’à présent, c’est effectivement par filière qu’il a été décidé de faire évoluer la nature des indemnisations du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) et non par type de risques, même si, à rigoureusement parler, c’est un croisement aléas / filière, qui spécifie les risques classés comme assurables. Certaines cultures ont par exemple quitté le régime des calamités agricoles parce qu’il était considéré que le risque associé à ces cultures était assurable alors que, pour d’autres, le régime des calamités est toujours disponible. Et pourtant, comme nous l’avons discuté, bien que les vignes soient sorties du régime en 2011, l’Etat est intervenu pour les aléas climatiques de l’année 2021.
Les évolutions de la réforme
Le rapport du député Frédéric Descrozailles remis au ministère de l’agriculture à l’été 2021 fait le lit d’un certain nombre d’évolutions du système d’assurance agricole actuel. Ce rapport pointe déjà trois principes fondamentaux de la réforme à venir.
- C’est tout d’abord un principe de solidarité nationale ou, en d’autres termes, le fait qu’il est convenu que l’Etat réintervienne officiellement dans le système assurantiel actuel. Je rappelle ici encore une fois que certaines cultures étaient sorties du régime des calamités agricoles et n’étaient donc pas censées être couvertes par l’Etat en cas d’aléas climatique fort. Par ce principe de solidarité, il est considéré que les actifs agricoles ne peuvent pas financer les dispositifs assurantiels dont ils pourraient avoir besoin en prélevant une partie de la richesse qu’ils créent. On pourrait néanmoins revenir sur ce jeu de vocabulaire dans le sens où le régime des calamités agricoles est quand même financé en partie par des taxes sur les exploitants agricoles. Néanmoins, il est explicité que la majorité du budget de ce fonds sera financé par la solidarité nationale.
- Le deuxième principe fondateur du rapport est celui de la légitimité de l’Etat à intervenir dans l’assurance agricole en ce sens qu’il est important de bien différencier ce qui tient à l’aléa (et qui est assurable par l’assurance privé) de ce qui est de l’ordre de la tendance (non assurable par le privé et nécessitant une intervention publique). L’Etat est donc présent pour s’impliquer sur la gestion de risques exceptionnels ou systémiques, c’est-à-dire non assurables ou nécessitant une réassurance publique dans les cas de phénomènes d’ampleur exceptionnelle.
- Enfin, c’est à un principe d’universalité que la réforme s’attelle, dans la mesure où tout agriculteur souhaitant s’assurer pourra souscrire à un contrat d’assurance, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
On est d’accord que la réforme proposée cherche à harmoniser et simplifier un système initial relativement complexe, ça n’était vraiment pas évident de s’y retrouver. Néanmoins, de là à dire que le résultat escompté à la fin de la réforme est d’une simplicité biblique, j’aurais quand même tendance à ne pas trop me mouiller… La réforme peut se résumer à la Figure 8 !
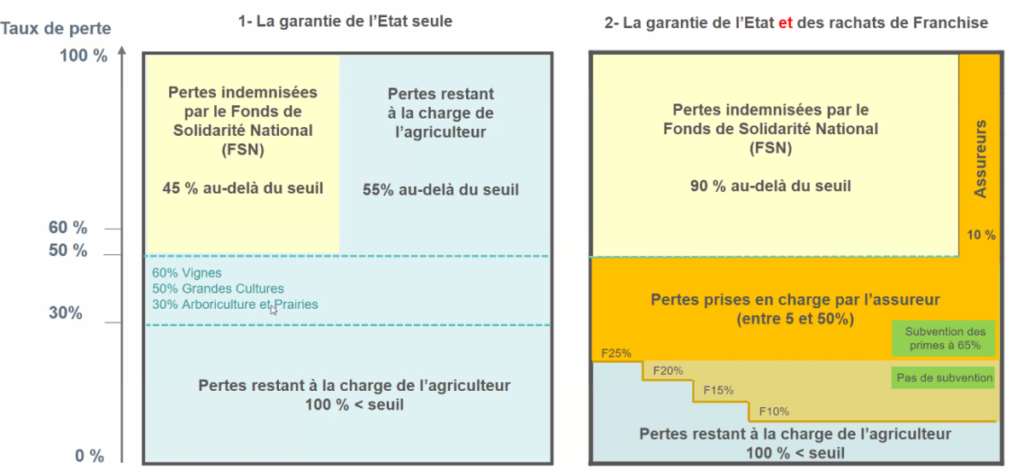
Figure 8. La réforme de l’assurance récolte. Source : Pacifica, interne.
Tadaaaa. Vous avez compris ? Bon ok, c’est parti… Le graphique de gauche, c’est pour l’agriculteur qui n’est pas assuré. Le graphique de droite, c’est pour l’agriculteur qui est assuré. Jusque-là tout va bien :
- Pour le non-assuré (graphique de gauche) : En dessous du seuil de déclenchement, c’est-à-dire le pourcentage de perte de récolte, l’agriculteur ne reçoit aucune aide et doit payer de sa poche. Les seuils de déclenchement sont fixés à 50% pour toutes les cultures mais il n’est pas impossible que ces seuils divergent comme ce qui est présenté sur la figure 8 (60% pour la vigne, 50% pour les grandes cultures et 30% pour l’arboriculture et les prairies). Il faut donc comprendre que, pour une parcelle de grandes cultures pour laquelle la perte de rendement est inférieure à 50%, un agriculteur non assuré devra tout payer lui-même. Si la perte de récolte est au-dessus du seuil de déclenchement, l’Etat, via le fonds de solidarité nationale, interviendra à hauteur de 45% mais seulement pour la perte au-dessus du seuil de déclenchement. Par exemple, dans le cas où une parcelle de grandes cultures subirait une perte de 70%, l’Etat paierait 45% du montant de la perte, mais seulement pour le montant entre les 50% et 70% de perte. Le reste est à la charge de l’agriculteur. Pour le non-assuré, c’est donc un contrat à deux étages (agriculteur et Etat).
- Pour l’assuré (graphique de droite) : En dessous du seuil de déclenchement, c’est-à-dire le pourcentage de perte de récolte, l’agriculteur ne reçoit aucune aide et doit payer de sa poche. Contrairement à l’agriculteur non assuré, l’agriculture assuré a souscrit à un contrat d’assurances ; il est donc indemnisé pour les pertes de récolte allant de 25% (seuil de franchise) à 50% de taux de perte. Cette indemnisation n’est néanmoins pas totale, l’assureur paye entre 5 et 50% des pertes – encore une fois seulement pour les pertes de récolte allant de 25% à 50% de taux de perte (ce sont bien des paliers, comme ce qu’il se passe pour nos impôts). Je rappelle ici que ce contrat d’assurance est subventionné à 65% avec un niveau de garantie socle. L’agriculteur, avec son assureur, a pu demander des franchises inférieures à 25% – soit en négociant avec son assureur, soit en se faisant racheter des franchises par son assureur en augmentant le prix total de son contrat d’assurances. Si la perte de récolte est au-dessus du seuil de déclenchement, l’Etat, via le fonds de solidarité nationale, interviendra à hauteur de 90% (c’est-à-dire deux fois plus que pour un agriculteur non assuré) mais seulement pour la perte au-dessus du seuil de déclenchement. Les 10 derniers pourcents sont à la charge de l’assureur. Pour l’assuré, c’est donc un contrat à trois étages (agriculteur, assureur et Etat)
Dans la figure 8, on voit ici que les contrats d’assurance vont dépendre des seuils de déclenchement. Certains préconisent des seuils de déclenchement identiques entre toutes les cultures (à 50%) mais il n’est pas impossible que ces seuils divergent comme ce qui est présenté sur la figure 8 (60% pour la vigne, 50% pour les grandes cultures et 30% pour l’arboriculture et les prairies). La part de prise en charge de l’Etat (présentée à 45% pour les non-assurés et 90% pour les assurés) peut encore varier.
Certains seuils et taux sont également susceptibles de changer suite à l’application du volet agricole du règlement européen Omnibus (il existe des volets de ce règlement pour d’autres secteurs que l’agriculture). S’il était entièrement suivi, ce règlement pourrait permettre également de faire bouger les niveaux de franchises et plus particulièrement de faire descendre le taux de franchise minimum de 25% à 20%. Le règlement Omnibus autorise également à subventionner les contrats d’assurance à hauteur de 70% (au lieu des 65% actuels). On voit que le règlement Omnibus permettrait de diminuer le prix du contrat de l’assurance pour l’agriculteur, et aussi de diminuer son reste à charge lors d’un sinistre. Il faut comprendre que, par construction, cette réforme et le potentiel recours au règlement Omnibus représentent une hausse substantielle de l’investissement public si le taux de pénétration de l’assurance récolte augmente chez les agriculteurs puisque l’Etat interviendrait plus qu’avant. Il n’a pas été considéré raisonnable de prélever en totalité ni même en majeure partie cette hausse sur le deuxième pilier de la PAC, quand bien même il serait décidé d’un transfert de fonds depuis le premier pilier vers le deuxième pilier de la PAC. Plusieurs solutions peuvent être envisagées à l’heure actuelle :
- Le retour à un taux de cotisation de 11% sur les contrats d’assurance agricoles (qui avait été abaissé à 5,5%),
- Une augmentation de deux points de la surprime sur les contrats d’assurance auto et habitation qui finance le régime des catastrophes naturelles (Cat Nat),
- Une augmentation de certaines contributions composant la taxe générale sur les activités polluantes, selon le principe d’une participation des activités qui ont un impact sur l’agriculture (pollution ou artificialisation des sols, par exemple, s’agissant des émissions d’azote et d’oxyde soufre ou des industries extractives) au financement de son adaptation au réchauffement climatique
A noter ici que les seuils du règlement Omnibus présentés ici (20% pour la franchise et 70% pour la subvention) ne pourront pas être étendus, à cause des règles de commerce de l’OMC. Ce sont donc des seuils non dépassables.
Les expertises entre les assureurs privés et l’Etat seront harmonisées. La référence historique de 5 ans de la moyenne olympique (le niveau moyen de rendement qui est assurable sur l’exploitation) sera utilisée pour les deux dispositifs privés et publics. Suite à la réforme, la moyenne olympique combinée à la franchise élevée devrait exclure la possible surindemnisation des agriculteurs.
Deux outils viendront également accompagner cette réforme :
- Un pool (ou regroupement) d’assureurs qui sera mis en place pour mutualiser les risques des assureurs par culture, mais aussi par territoire (à condition que les productions ne soient pas toutes sensibles aux mêmes aléas climatiques). Le pool mutualisera les risques et permettra de réaliser des calculs actuariels pour couvrir les risques des agriculteurs. Avec une mutualisation totale, il est considéré que le calcul des niveaux de prime d’assurance sera le plus juste possible. Cette mutualisation permettrait en effet aux assureurs, membres du pool, d’améliorer leur connaissance des risques climatiques agricoles, conduirait à une tarification plus adéquate et à une amélioration des mesures de prévention des sinistres. Les assureurs pourraient alors proposer des polices d’assurance plus adaptées aux situations diverses des agriculteurs assurés. Ce pool a également vocation à fédérer tous les assureurs qui vont diffuser des contrats d’assurance récolte.
- Un comité d’orientation et de développement de l’assurance récolte (CODAR), sorte de lieu de gouvernance où assureurs, réassureurs, agriculteurs, ou encore l’Etat vont rediscuter de ces primes. Le CODAR peut être vu comme un thermomètre qui permet de regarder l’évolution du ratio sinistre à prime du système assurantiel. Ce système a vocation à être totalement transparent pour que tous les acteurs puissent se rendre compte du niveau de finance du système assurantiel, et de mettre le doigt ensemble sur des risques qui ne seraient plus assurables. Ce CODAR est donc un véritable outil de questionnement des trajectoires agricoles par rapport à une sinistralité observée. Si les ratios de sinistre à prime dérivent trop, il faudra, conjointement, mettre en place des mesures d’adaptation sur les territoires : cesser une production, mettre en place des variétés tropicales, déplacer des bassins de production, introduire de la diversification culturale, ou encore délocaliser certaines productions. Il sera donc fondamental de prendre en compte les scénarios et données du GIEC, et idéalement d’étudier des scénarios de dérèglement climatique par bassin de production pour réfléchir à des adaptations et ajuster un pas de temps cohérent avec la réactivité commerciale des assureurs.
L’assurance agricole n’est pas rendue obligatoire mais de nombreuses incitations sont mises en place pour pousser les agriculteurs à s’assurer :
- Les assurés et les non-assurés ne seront plus logés à la même enseigne. Un assuré bénéficiera de subventions de la PAC pour son contrat d’assurance privée (deuxième étage de la Figure 8) et d’une intervention de l’Etat sur le principe de la solidarité nationale (troisième étage de la figure 8). Un non assuré ne touchera pas de subventions de la PAC pour son contrat d’assurance puisqu’il n’en aura pas souscrit, et ne touchera que la moitié du montant de la solidarité nationale qu’il aurait touché s’il avait été assuré (les fameux 45% et 90% de la figure 8)
- Une incitation fiscale est également mise en place au travers de la déduction pour l’épargne de précaution (DEP). Pour rappel, cette épargne permet de défiscaliser une partie de ses revenus à hauteur d’un certain montant – notamment pour ne pas payer trop d’impôt lors d’une mauvaise année. Cette épargne revient ensuite dans le compte d’exploitation lors d’une meilleure année. Un agriculteur contractant un contrat d’assurance MRC aurait ainsi accès à 100% de déduction pour épargne de précaution jusqu’à 50.000 € de bénéfice agricole (contre 27.000 € pour un non assuré), 30% du bénéfice au-delà de 50.000 € (contre 30% de bénéfice au-delà de 27.000 € pour un non assuré). Attention néanmoins au fait que cette aide fiscale pourrait devoir être additionnée à la subvention de la MRC pour être intégrée au total de l’aide d’État, plafonnée par la réglementation de l’Union.
Assurance & Numérique : L’assurance indicielle ou paramétrique
Principes et fonctionnement de l’assurance indicielle
L’assurance « paramétrique » ou « indicielle » est une assurance qui se déclenche, non pas à la suite du sinistre lui-même (comme dans le cas des contrats indemnitaires), mais à la suite de l’écart d’un indice ou d’un paramètre (indice météorologique, indice de végétation, indice de rendement régionalisé, indice de pression de maladies…) par rapport à l’attendu. En simplifiant un peu, on pourrait dire que l’assurance indemnitaire fait la corrélation entre l’estimation des pertes par un expert et les pertes réelles alors que l’assurance paramétrique fait la corrélation entre la déviation d’un indice par rapport à l’attendu et les pertes réelles. Par exemple, l’indemnisation de l’assuré peut être déclenchée par un niveau de précipitations mesuré à une station météorologique proche de l’exploitation agricole. Si cette station météorologique dispose d’un historique de données suffisamment long, les deux parties, l’agriculteur et l’assureur, disposent d’informations identiques sur la valeur assurée.
Puisque les contrats d’assurances paramétriques sont basés sur la définition d’un indice, on peut alors être très imaginatif – la gamme de solutions possibles étant extrêmement larges. On pourra assurer contre un manque de vent pour une éolienne, un manque de rayonnement pour des panneaux photovoltaiques, assurer contre une hausse du prix du gaz, un manque d’eau sur le Danube. Dans le contexte agricole, on pourra assurer contre un gel ou un excès de chaleur (plutôt à l’aide d’une station météo), une sécheresse ou un excès d’humidité (plutôt à l’aide de données satellitaire), un excès ou un manque de pluie (avec une station météo ou des données radar), une grêle avec des capteurs de grêle. On peut également penser à certaines garanties pour des acteurs autour de l’agriculteur, comme un semencier, avec par exemple des garanties directement intégrées dans des semences. Le semencier utilise alors l’assurance comme une garantie commerciale pour l’agriculteur contre un échec de levée de semis ou une sécheresse. Le montant d’assurance versé est souvent proportionnel au pourcentage de variation de la valeur réelle de l’indice par rapport à l’indicateur établi dans la fourchette de valeurs, ou du montant total de la somme assurée. Si l’indice utilisé est bon en ce sens qu’il est bien corrélé à ce qu’il se passe sur la parcelle, alors l’assurance paramétrique fonctionne bien. Si, au contraire la relation n’est pas bonne, l’assurance paramétrique a tout de suite moins d’intérêt… Avoir un examen annuel et un suivi régulier de l’indice parait pertinent pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive.
Pour les défenseurs de l’assurance paramétrique, ce format a de très nombreux avantages. On évite déjà les tensions et moments délicats entre l’assuré et l’assureur lorsque l’assuré n’est pas en accord avec les résultats d’évaluation de sinistre de l’assureur. La gestion du sinistre peut souvent être source de conflits (c’est d’ailleurs pourquoi les assureurs font parfois appel à des médiateurs de l’assurance). Ici l’indice est mesurable et objectif, il ne dépend ni de l’assureur, ni de l’assuré. Le sinistre devient objectivable. Rajoutons à cela que l’expert n’est pas forcément toujours pédagogue dans son rapport d’expertise.
Le temps de traitement du dossier est largement diminué en ce sens que l’expert n’a pas besoin de passer sur le terrain et que le déclenchement du paiement peut être réalisé directement suite à la réalisation ou non-réalisation d’un niveau d’indice. L’agriculteur, de son côté, peut donc toucher son indemnisation plus rapidement parce qu’il n’a pas besoin d’attendre la fin de la campagne et/ou le passage d’un expert. D’un point de vue logistique, c’est également plus simple pour l’assureur qui n’a ni besoin de développer un réseau d’expert, ni besoin de mettre en place un centre d’appel pour recevoir les demandes d’intervention clients. D’un point de vue économique, les assureurs peuvent ainsi faire baisser les tarifs de la prime d’assurance puisque les coûts d’expertise et les coûts de gestion de contrats sont diminués. Néanmoins, cet aspect est à relativiser parce que ce n’est au final pas cette partie de l’assurance qui coûte le plus cher dans la prime d’assurance totale (les frais de gestion ne représenteraient en réalité que 10 à 20% du coût total de la prime d’assurance). Comme il n’est alors plus nécessaire de faire des évaluations des dommages, les assureurs peuvent, grâce à l’utilisation d’indices, transférer leur risque à des réassureurs ou sur les marchés financiers. Même si de nombreux producteurs sont touchés simultanément, l’assurance ne fait alors pas faillite car elle s’est elle-même couverte en cédant son risque à un réassureur.
Les phénomènes d’anti-sélection et d’aléas moral (voir la section correspondante) disparaissent, encore une fois parce que l’indice est basé sur des éléments objectifs qui ne dépendent ni de l’assureur, ni de l’assuré. Le risque sera modélisé par exemple comme du risque purement météo. Tout sera défini au contrat et l’assureur ne prendra pas de risque lié au terrain ou au type exact de cultures. L’assureur se référera à une donnée météo, à une formule de calcul et indemnisera en fonction de l’indice.
Contrairement à l’assurance traditionnelle, qui va calculer une prime d’assurance en fonction de la fréquence d’un sinistre sur un coût moyen, l’assurance indicielle évacue la partie coût moyen et la transforme plutôt en cout forfaitaire : une indemnisation à hauteur de X euros euros en cas de dépassement d’un seuil (on peut aussi avoir des assurances indicielles progressives après déclenchement). L’indice et la tarification peuvent être plus ou moins compliqués à fabriquer et mettre en place. En viticulture ou en arboriculture, certains seuils de dégâts sont maintenant relativement bien connus de la littérature scientifique ou facilement estimables pour déclencher des assurances. Des assurances indicielles basées sur des stress thermiques ou des précipitations peuvent être construits assez facilement sur la base de stations météo connectées.
L’assurance paramétrique répond aussi aux contraintes fixées par l’assurance indemnitaire parce qu’elle est beaucoup plus flexible. Par exemple, en France, en rapport avec les niveaux de surfaces minimales couvertes, un contrat indemnitaire traditionnel en grêle tempête demandera à ce qu’une exploitation viticole couvre la totalité de ses surfaces de vignes (100%), qu’elle veuille en assurer la totalité ou non. Certains agriculteurs auront des capitaux par hectare à couvrir pour certaines parcelles alors qu’un assureur ne voudra par exemple assurer qu’une certaine somme maximale par hectare. La procédure peut être très simplifiée en assurance indicielle. Un assureur peut par exemple proposer des devis avec une couverture sur 20 hectares – avec telle valeur couverte – sans préciser les parcelles couvertes, chose qu’une assurance traditionnelle ne couvrirait peut-être pas à cause du phénomène d’anti-sélection. Les solutions proposées par l’assurance indicielle sont beaucoup plus sur-mesure avec des franchises et des seuils que le client peut affiner facilement. L’assurance indicielle peut permettre d’assurer non seulement une quantité de produit mais aussi la valeur d’un produit. On peut comprendre qu’un grand cru viticole, vu le prix de vente de sa bouteille, préfère assurer une valeur de bouteille qu’une quantité de jus de raisin.
On ne peut néanmoins par avoir le beurre et l’argent du beurre :
- L’assurance paramétrique est tellement différente de l’assurance traditionnelle qu’il faut aussi en accepter les hypothèses simplificatrices. Il y a déjà des efforts de compréhension, de familiarité avec les données, et de nouveaux réflexes à adopter dans le sens où un agriculteur n’est pas obligé d’assurer 80% des surfaces sur du gel, ni de considérer un rendement passé sur les cinq dernières années. L’agriculteur doit comprendre que si la donnée mesurée est validée (d’une station météo ou d’un satellite), il peut ne pas y avoir d’indemnisation malgré une perte. On peut néanmoins faire le parallèle avec l’assurance traditionnelle dans le sens où l’expertise humaine n’est pas forcément parfaite non plus. Le ou les indices doivent être compréhensibles par les agriculteurs. Des formules de calcul simples – même si imparfaites – sont parfois plus pertinentes pour que l’agriculteur sache comment il est couvert, et qu’il puisse faire le lien avec son expertise agro-météo (le risque pour les contrats indiciels étant d’être des usines à gaz parce que l’on veut borner tout un tas de paramètres). La question de la complexité de l’indice est une réalité. Imaginons par exemple un cas de gel avec 10% de pertes de rendement observées à une température de 0°. On peut avoir 0° avec 10% d’humidité, avec 90% d’humidité, ou encore 0° pendant 1h ou beaucoup plus. Avec le paramétrique, les exploitations acceptent la notion de réduire le risque à un prix bien tarifé. Le risque est réduit mais il n’est pas annulé. Ce n’est pas le même confort que sur l’assurance traditionnelle où, dans ce cas-là, l’agriculteur pourra protéger entre 10% et 90% de pertes de récolte, et c’est bien la perte de récolte réelle qui sera indemnisée. Il existe donc un risque que l’agriculteur interprète l’assurance indicielle comme une loterie ambiguë.
- L’agriculteur va potentiellement devoir s’équiper et investir dans de l’équipement (pour une assurance paramétrique sur du gel, il faut par exemple une station météo). Pour continuer sur les stations météo, si l’on voulait être très précis, il faudrait un maillage énorme sur le terrain. Entre le haut et le fond d’une vallée, même sans beaucoup de kilomètres qui les séparent, il faudrait disposer de plusieurs stations météo. Et comme l’assurance se déclenche à un moment donné, il faudra peut-être multiplier les capteurs, et en mettre au moins une station à l’entrée et à la fin de vallée.
- Un des grands débats qui a lieu actuellement est d’évaluer la capacité pour les agriculteurs de contester l’expertise paramétrique. Les outils se doivent d’être suffisamment crédibles et pas trop contestés. Le taux de fiabilité de l’indice va être très impactant. A 80% de fiabilité par exemple – ce qui peut paraitre acceptable, l’assureur va se retrouver avec des agriculteurs qui devraient être indemnisés mais à qui on expliquera qu’ils ne le seront pas. L’assureur peut alors craindre un taux de recours extrêmement important et on peut très bien imaginer que, dans un même village, on ait affaire à 2 éleveurs, le premier indemnisé alors qu’il ne devrait pas l’être et le deuxième non indemnisé alors qu’il devrait l’être. La perte de crédibilité serait totale. Notez que l’erreur de l’indice peut jouer à la fois sur le seuil d’indemnisation (est ce que j’indemnise ou est-ce que je n’indemnise pas ?) mais aussi sur le niveau auquel on estime la perte (en fonction de la valeur de l’indice qui est calculée). On pourrait néanmoins opposer ici que la confiance envers l’expertise terrain n’est pas forcément toujours plus sure. Il est nécessaire que toutes les parties prenantes comprennent les risques à la signature du contrat. Tout doit être explicité et tous les acteurs doivent être conscients de ce qu’ils acceptent. Précisons néanmoins qu’à condition d’avoir une référence absolue et juste a 100 %, ce qui n’est jamais le cas en agriculture, l’évaluation de la fiabilité d’un indice est donc généralement compliquée et les raccourcis dangereux.
- Certains assureurs imaginent qu’ils pourraient se passer d’experts sur les sinistres lourds en cadrant le dommage le plus possible et en le caractérisant avec un aléa. Un expert pourrait effectivement proposer à un arboriculteur de ne s’assurer contre le gel que de début mars à début avril, et fixer des seuils de température à chaque fois pour chaque niveau de dommage. De façon pragmatique par contre, le fait de travailler avec du vivant demande de l’humilité. Tout n’est pas aussi prédictible qu’on le souhaiterait. Le vivant est rarement linéaire – beaucoup de facteurs d’influence peuvent jouer, certains endroits peuvent geler, d’autres non, alors que la température est la même. Une perte de rendement peut s’expliquer par une combinaison de plusieurs facteurs, et pas un seul facteur climatique dans l’année (un peu sec en automne, un peu froid à quelques moments de la saison…). Cadrer un évènement climatique avec seulement un seuil de température peut être relativement limitant. Un stade de gel au 15 mars apparait sur une floraison à une année donnée alors que sur d’autres années, à la même date, la floraison n’aura peut-être pas encore eu lieu. Cibler un facteur pour construire une assurance indicielle n’est pas forcément toujours pertinent. Il peut également y avoir des phénomènes de seuils assez importants, des différences entre des vieilles vignes et des jeunes vignes. En 2021, certaines parcelles de vigne tardive n’avaient pas encore réellement démarré leur reprise au 8 avril (en plein pendant le gel observé cette année). Dans certains cas, des viticulteurs ont ainsi pu toucher 50% de leur indemnisation d’assurance alors qu’ils ont finalement fait un rendement classique en fin de saison. Sur certaines parcelles de vigne avec 90% de gel estimé au 8 avril, avec des yeux sortis qui gelaient, certains viticulteurs ont quand même pu atteindre des rendements de 40 hectolitres à l’hectare. Encore une fois, l’agriculture n’est pas linéaire (peut-être néanmoins que les rendements des années suivantes seront fortement impactés). En rendant des contrats d’assurance indiciels trop simples, quelqu’un finira toujours par prendre une claque, que ce soit l’agriculteur ou l’assureur. L’assurance n’est actuellement pas capable de prendre en compte toute la complexité du vivant – par exemple en vigne à la fois le porte greffe, la variété, le type de sol… En sera-t-elle vraiment capable un jour ?
- Avec de l’assurance indicielle, on peut malheureusement aussi faire de la spéculation parce que l’on déconnecte le paiement du coût du sinistre réel. En acceptant l’indiciel, l’agriculteur prend le risque que sa perte soit différente de ce que l’indice lui explique. En fonction de tel ou tel paramètre indiciel fixé, l’assuré peut être indemnisé d’une certaine somme d’argent mais c’est bien l’assuré qui doit évaluer si la somme d’argent est suffisante pour lui. En tant qu’agriculteur, je pourrais me dire que si je pense que l’assureur se plante, je peux acheter son contrat. Si l’assureur sous-estime par exemple le risque d’occurrence d’un vent supérieur à telle vitesse, moi n’étant pas agriculteur, je pourrais lui demander de m’assurer. Je pourrais ainsi jouer contre l’assureur.
Le risque de base
Quand nous avons discuté d’assurance indemnitaire, nous avons mis le doigt sur tout un tas de risques ou de phénomènes inhérent à ce format de contrat, notamment les phénomènes d’anti-sélection et d’aléas moral. L’assurance paramétrique, elle aussi, a le sien : il s’agit du « risque de base ». Le risque de base peut être défini comme le fait d’observer des écarts entre l’indemnisation touchée par les agriculteurs et les pertes subies par l’exploitation. En gros, l’assureur n’a pas déclenché l’assurance alors que le client a eu des dégâts ou, au contraire, l’assurance a été déclenchée alors que l’assuré n’a pas eu de dégâts. L’indice d’assurance peut donc être faiblement corrélé aux résultats des pertes individuelles. On peut découper ce risque de base en trois catégories :
- Le risque de base « spatial » matérialise les différences entre les conditions mesurées à un endroit donné et celles réellement observées au niveau de l’exploitation, par exemple en raison de la distance spatiale qui sépare l’exploitation de l’endroit où des données météorologiques ont été collectées. L’indice, dans ce cas-là, ne tient pas compte du fait que les conditions météorologiques sur la zone d’étude sont potentiellement très variables.
- Le risque de base « temporel » correspond au fait que la fenêtre temporelle qui a été choisie pour déterminer l’indice ou le paramètre de l’assurance n’est pas forcément la plus pertinente, par exemple entre les précipitations tombées sur l’année entière plutôt que celles tombées seulement pendant le cycle végétatif. Le risque de base temporel provient de la manière dont un contrat sélectionne des intervalles calendaires particuliers pour l’évaluation, tout en en excluant d’autres, ou dont le contrat regroupe les observations sur des périodes temporelles telles que les décades (10 jours) ou les saisons humides ou sèches
- Le risque de base de « conception » ou de « design » matérialise un peu grossièrement toutes les sources d’erreur restantes, par exemple, le fait d’avoir oublié des variables importantes (de météo ou autre) ou de mettre en œuvre le calcul d’indice avec des méthodes ou techniques mal adaptées et/ou biaisées.
La question de l’échelle spatiale de travail est donc fondamentale. Plus la zone couverte est grande, et plus les risques individuels auxquels sont confrontés les assurés sont hétérogènes. La variance des situations des agriculteurs (ou la variance idiosyncratique en référence au risque idiosyncratique que nous avons défini plus haut) sera donc d’autant plus importante, et l’indice sera moins à même de correctement prédire des résultats individuels. Pour que l’indice soit de qualité, il est important de pouvoir estimer correctement la distribution de probabilité de l’indice et de disposer de données de bonne qualité sur les variables qui déterminent l’indice (données météorologiques ou de végétation par exemple). Mais il faut également disposer de données sur les pertes attendues. Ces données sont souvent difficiles à obtenir car elles sont coûteuses à collecter, notamment dans les pays en développement, et leur disponibilité dépend également des différents types de contrats d’assurance indicielle. Le fait de ne pas disposer des données appropriées conduit à une mauvaise représentation de la véritable distribution de probabilité de l’indice et peut entraîner une mauvaise corrélation entre l’indice et les résultats des pertes individuelles. Des données de substitution sont nécessaires pour combler les années où aucune donnée n’est disponible, ce qui peut poser des problèmes dans certains pays où des historiques ne sont pas disponibles.
Pour améliorer la qualité des données, il est suggéré de ne pas s’appuyer sur des données de substitution ou des variables uniques pour déterminer les pertes individuelles pour les contrats basés sur les conditions météorologiques et de compléter les données agrégées au niveau du pays par des observations au niveau de l’exploitation pour l’assurance d’indice de rendement par zone. Les agriculteurs peuvent être la source ultime d’informations pour limiter le risque de base. Les approches participatives qui impliquent les groupes communautaires et les agriculteurs dans la phase de conception de l’indice peuvent aboutir à des produits présentant un faible risque de base.
Au fur et à mesure que l’échelle géographique se rétrécit, passant par exemple du pays, à la région et au département, on peut s’attendre à ce que la variabilité des situations des agriculteurs se réduise. En poussant le bouchon jusqu’au maximum, lorsqu’une mesure par satellite est parfaitement calibrée pour capturer la variation de la production et que la zone est réduite à la taille d’une parcelle individuelle et d’un seul type de culture, la variation idiosyncratique disparaît par définition. Une estimation satellitaire précise des rendements des cultures est importante non seulement parce qu’elle réduit directement le risque de conception, mais aussi parce que la résolution toujours plus grande des mesures satellitaires permet de rétrécir les zones d’assurance à des zones plus homogènes, chacune ayant son propre indice de rendement, sans augmentation sensible des coûts de fonctionnement. Néanmoins, il faut garder en tête que la réduction de la zone d’assurance à l’échelle d’une seule parcelle ou d’un seul agriculteur réintroduirait des problèmes de risque d’aléas moral, bien que les méthodes d’audit à double déclenchement puissent être adaptées à la télédétection et utilisées pour discipliner l’aléa moral en refusant les paiements aux exploitations dont les rendements diffèrent sensiblement de ceux de voisins choisis au hasard. Tout l’enjeu des concepteurs d’indices est donc d’identifier une unité spatiale suffisamment petite pour que l’abstraction soit significative, mais suffisamment grande pour faciliter la mise en place des contrats d’assurance indicielle.
Certaines littératures critiques reprochent néanmoins à des projets d’assurance indicielle d’avoir versé des indemnités à titre gracieux à des agriculteurs suite à des problèmes de risque de base pour éviter de risquer de perdre la confiance de leurs clients, de leurs bailleurs de fonds ou du gouvernement local (Johnson, 2021). Une sorte de script de la promesse de l’assurance (qui sera présente en cas de problème) pour stabiliser la réputation d’une entreprise tout en évitant la responsabilité légale, la censure réglementaire ou le désenchantement du secteur assurantiel.
De manière générale, l’ampleur du risque de base pour les différents produits indiciels est difficile à quantifier. Il est donc difficile de conclure si les produits d’assurance indicielle réduisent effectivement les risques.
L’exemple du contrat indiciel en prairies
Les contrats d’assurance indicielle se sont principalement développés sur les prairies. Mais pourquoi donc ? C’est déjà que la prairie n’est pas une culture comme les autres. C’est une culture qui est récoltée en plusieurs fois dans l’année (il y a plusieurs coupes) et qui est pâturée. La mesure de la production n’est donc pas vraiment possible, sauf pour les agriculteurs qui comptent leurs balles de récolte. Et de toute façon, comme la production est auto-consommée à 95% sur l’exploitation, la prairie n’est pas vraiment considérée comme une culture de vente – ça ne figure donc pas vraiment dans la comptabilité de l’exploitation – et l’agriculteur ne s’intéresse finalement pas forcément à une baisse de production. Si le niveau de production n’est pas mesuré, il n’y a donc pas d’historique pour se repérer et donc l’assurance indemnitaire classique est quasiment impossible à tarifer.
De nombreux pays se sont lancés sur des contrats d’assurance indiciel en prairie, notamment en utilisant des technologies de télédétection satellitaire, parce que c’est ce qui, par expérience, a l’air de fonctionner le mieux. La biomasse de la prairie peut effectivement être mesurée par des indices de végétation. Sur l’assurance prairies, la plupart des acteurs la réfléchissent à des échelles spatiales assez larges, par exemple à des niveaux communaux, des zones agronomiques ou de petites régions fourragères.
Le principe de l’indice en prairie est de suivre le profil de la croissance de la prairie – globalement entre février et octobre en France, avec des déclencheurs au moment du départ de la pousse jusqu’à la fin. L’idée est de comparer le profil de production d’une année donnée à ceux de la même zone sur des années précédentes – on compare donc les intégrales de production de biomasse sur différentes années. Il faut donc comprendre ici que l’on a besoin quand même d’un historique de données satellitaires pour pouvoir remonter dans le temps. Plusieurs vecteurs satellites peuvent être utilisés en fonction des résolutions spatiales et temporelles utilisées. Certains lecteurs penseront peut-être tout de suite aux satellites Sentinel 2, même si ce n’est en réalité pas ceux qui sont actuellement trop utilisés, déjà parce que l’historique de données n’est pas encore extrêmement large (Sentinel 2A a été lancé en 2015, et Sentinel 2B en 2017) mais aussi et surtout parce que la résolution spatiale assez fine de 10 mètres peut conduire à des phénomènes d’anti-sélection et d’aléas moral. L’indice doit également être corrigé ou harmonisé pour des effets de nuages, de topographie, ou de type de sol. Des indicateurs météo viennent complémenter le modèle et sont utilisés pour pénaliser artificiellement la production de biomasse au cours de la saison.
L’expérience des acteurs français sur le sujet aurait tendance à montrer que le peu d’utilisation des contrats indiciels en prairies (il n’y a pas de contrat indemnitaire pour les raisons évoquées en début de section) ne serait pas dû à la qualité de l’indice. Les indices seraient plutôt bien corrélés à la biomasse et certains services indiciels passeraient même en commission tous les ans avec des institutionnels de plusieurs secteurs différents (Idele, Meteo France…) pour en valider la pertinence. Les agriculteurs auraient en réalité plutôt confiance dans une mesure faite par satellite mais auraient une mauvaise connaissance de leurs profils de production, cela étant dû au fait que les agriculteurs font des arbitrages économiques – certes tout à fait légitimes, mais pour lesquels ils ne font pas forcément le lien avec leur profil de production de prairies. Les indices en prairies mesurent ce qui a poussé, et non pas ce qui a été récolté – et la grande différence est là. Dans les alpages, si la prairie a poussé de 2cm, je peux me poser la question d’aller récolter en tant qu’agriculteur. Je vais peut-être seulement récolter 1 tonne de matière sèche mais si j’ai 15 km de route à faire, peut-être que je vais décider de ne pas aller récolter en considérant que ça n’en vaut pas la peine. Mais si on pense à la prairie, 1 tonne, ça reste quand même une production que l’on ne peut pas complètement négliger, et dont l’état ne dépend pas de la non-pousse (parce que la prairie a vraiment poussé de 2 cm) mais plutôt de l’arbitrage ou de la pratique de l’agriculteur à ne pas être allé récolter. Avec des stocks de fourrage constitués au printemps, les regains de prairies à l’automne ne sont pas toujours pas récoltés, parfois parce qu’ils ne sont pas considérés de la même qualité que la prairie initiale. Il peut également y avoir des cas d’impossibilité de récolte – par exemple lors d’une inondation. Bref, autant de cas qui vont faire diverger l’indice, qui mesure un niveau de pousse, de ce qui aura été réellement récolté.
Autres technologies numériques au service de l’assurance
Les fournisseurs de données peuvent alimenter les assureurs sous des formats assez variés. Au cours de la saison, ce peut être mettre à disposition des indicateurs météo, valider qu’une parcelle a été plantée, évaluer le pourcentage de la parcelle ayant levé, estimer la date de la levée, comparer le développement de la biomasse sur plusieurs parcelles, ou encore appuyer les experts à l’aide d’indicateurs et de cartographies pour répondre à des réclamations d’agriculteurs.
Les outils numériques permettent de jouer sur les économies de gestion. Certains proposent ainsi le concept d’indices basés sur une photo, dans le sens où un agriculteur pourrait envoyer une photo de sa parcelle, horodatée et géolocalisée, pour mettre en avant les impacts d’un sinistre. Les experts eux-aussi, directement depuis le terrain, peuvent faire appel à des outils numériques pour mesurer des surfaces de dégâts de grêle et de gibier directement sur une carte, et de s’accorder avec l’agriculteur sur les surfaces délimitées. Des prises d’images à haute résolution (drone, avion) peuvent permettre également d’évaluer des pourcentages de levée ou des comptages de plantules pour proposer des conseils de resemis à un agriculteur. Notez que ces drones peuvent être utilisés pour des assurances bien plus larges pour l’agriculteur (problèmes judiciaires ou administratifs, problèmes de foncier..) mais nous concentrons dans cet article de blog sur la partie climatique.
Qu’attend-t-on des données issues de technologies numériques ? Déjà, qu’elles soient fiables : l’outil de mesure ne doit pas tomber en panne et les données doivent être certifiées par le fournisseur. Le fait de devoir certifier les données implique un peu indirectement que l’assureur ne développe pas ses propres outils de mesure dans le sens où il pourrait être accusé de jouer sur les deux tableaux. Il serait donc par exemple peut-être préférable qu’un assureur ne déploie pas son propre réseau de stations météo, mais préfère plutôt proposer un package d’assurance qui viendrait en complément d’une station météo d’un fournisseur tierce. L’assureur doit passer par un tiers de confiance. Dans l’exemple des données météo, ce peut être les données d’un opérateur tierce (type météo France) – on parle ici d’oracle, c’est-à-dire une source d’information tierce dont chacun reconnaît la sincérité et l’exactitude des informations. Ce peut être également les données d’un assuré (la station météo sur sa parcelle) que l’assureur ferait passer par un tiers de confiance pour en valider la qualité, ce tiers de confiance pouvant être un gestionnaire de stations ou de données météo, ou bien des experts en analyse de données qui pourront confirmer que la donnée est bonne (maintenances correctement réalisées, validations statistiques, validation avec des données climatiques spatialisées…). Pour l’assureur, peu importe la méthode utilisée par le tiers de confiance si la donnée est certifiée. Si le tiers de confiance prend le risque de certifier la donnée, le contrat peut être réalisé. Pour les stations météo, notons néanmoins que les modèles globaux (Météo France ou autres) sont assez fiables – et ce localement aussi, ce qui ouvre aussi des voies pour vérifier que la donnée envoyée par la station ne présente pas d’anomalies inexpliquées. Autre point à ne pas négliger, ces données doivent être représentatives de l’entité mesurée, notamment pour éviter le risque de base. A l’assureur de vérifier que les données sont bien représentatives.
En m’intéressant au domaine assurantiel, j’avais pensé pouvoir glaner des retours d’expérience sur des formats d’assurances décentralisées et des paiements en crypto-monnaies pour indemniser les agriculteurs. Je pensais donc entendre parler de l’utilisation de technologies « blockchain » (chaines de blocs) et de « smart contracts » (contrats intelligents). Je me suis vite rendu compte que ça n’allait pas être le cas parce que ces outils ne sont encore qu’utilisés très à la marge.
Le smart contrat est en gros un programme informatique dans lequel les termes du contrat d’assurance ont été spécifiés (par exemple : « verser une indemnité de tant à monsieur X dès que la parcelle a gelé ») et qui va exécuter une transaction (l’indemnisation de l’assuré) dans une blockchain pour la sécuriser dès que l’ensemble des conditions d’indemnisation du contrat prédéfini sont réunies (dans notre exemple dès que la parcelle a gelé). Le smart contract n’est pas le contrat au sens juridique mais un outil permettant de l’automatiser et de le sécuriser grâce à l’utilisation de la blockchain. Les smart contracts peuvent également être complémentés automatiquement par des données d’un organisme tiers – l’oracle, dont nous avons parlé juste avant, et qui une source d’information tierce dont chacun reconnaît la sincérité et l’exactitude des informations.
Dans le domaine assurantiel, blockchains et smart contrats pourraient ainsi permettre :
- De réduire les tarifs de la prime d’assurance en diminuant les coûts de gestion et de structure des contrats d’assurance parce que le système est automatisé (traitement de la déclaration, vérification de la réalité du sinistre, gestion des éventuels litiges via un oracle)
- D’accélérer les procédures assurantielles grâce à l’utilisation de données tierces provenant d’oracles ou d’objets connectés dans les parcelles (stations météo). En cas d’évènement de grande ampleur, comme une catastrophe naturelle, on pourrait imaginer filtrer les cas ne présentant aucune ambigüité pour se concentrer sur les situations les plus délicates
- d’imaginer l’assurance agricole de façon collaborative avec des assurés se regroupant au sein d’une communauté, déclarant des biens et payant une cotisation pour les assurer. L’argent pourrait être placé pour la plus grande partie sur un compte de séquestre et le reste investi dans un contrat d’assurance (auprès d’un réassureur par exemple). En cas de sinistre, l’assuré serait payé avec l’argent placé sur le compte de séquestre puis par le contrat d’assurance lorsque le compte de séquestre serait vide. L’année suivante, les membres de la communauté ne paieraient que la somme permettant de reconstituer le montant du séquestre et de payer la police de réassurance. Le but de l’assurance collaborative étant de redonner du sens à l’assurance en responsabilisant les assurés et en évitant le sentiment de payer sans ne jamais rien récupérer (même si nous avons bien discuté du fait que le propre de l’assurance n’était pas de gagner de l’argent pour un assuré)
Pour certains, ces technologies blockchains et de smart contracts seraient trop survendues. Si les contrats d’assurances sous blockchain font appel à des oracles, le lien avec une personne tierce serait encore trop présent, et il n’y aurait alors finalement pas trop de différences avec un contrat d’assurance classique. D’autres se demandent ce que la blockchain pourrait vraiment apporter de plus aux contrats actuels en ce sens que les problématiques du moment ne sont pas autour de la tangibilité ni de la robustesse du contrat. Juridiquement, les contrats tiennent la route, et les assureurs et assurés n’auraient pas de problème de tiers de confiance ou d’insolvabilité. La confiance entre un assuré et un assureur tiendrait à l’idée que se fait l’assuré de la promesse que donne l’assureur. Plusieurs interviewés rappelleront également que la dimension humaine est prépondérante dans le domaine assurantiel (le risque climatique a une dimension très émotionnelle et traumatique). Par rapport aux autres risques, le risque climatique est beaucoup plus cher et plus fréquent. Certains assureurs considèrent ainsi que tout ne pourra pas se régler avec des aspects purement automatiques. Il faudra nécessairement accompagner les exploitants dans des situations difficiles.
D’un point de vue logistique, l’automatisation totale peut être rendue difficile par le fait qu’il faille attendre le résultat d’expertise du terrain, notamment dans le cadre des contrats indemnitaires. Certains assureurs, pour pallier certaines lenteurs du déclenchement de paiement, verseraient des acomptes en cours de campagne lorsque les taux de perte détectés (dans le cadre d’un contrat indiciel par exemple) seraient déjà trop importants.
A noter également que les agriculteurs, en particulier dans les pays en développement, peuvent ne pas avoir accès à l’infrastructure nécessaire pour participer à un système d’assurance décentralisé basé sur la blockchain.
Les questions juridiques autour de la blockchain ne sont pas non plus évidentes et ne sont pas nécessairement tranchées (encadrement des relations entre les participants, gouvernance des blockchains, gestion des données personnelles, partage des informations entre assurées…). On pourrait également questionner la motivation des parties prenantes à la transaction (assureur et assuré) à fournir des informations authentiques et précises, notamment pour les petites exploitations (je vous renvoie vers un de mes derniers gros dossiers de blog sur le numérique vu par les sciences humaines et sociales).
Les micro-assurances indicielles dans les pays en voie de développement
Les mécanismes d’assurances en agriculture se développent également dans les pays en voie de développement. On aura ici plutôt tendance à parler de micro-assurances que d’assurances, dans le sens où les primes d’assurances et les indemnisations correspondent à des montants relativement faibles. Les modalités et les principes de fonctionnement restent néanmoins les mêmes entre l’assurance et la micro-assurance. L’assureur assure des montants moins importants parce que les niveaux financiers sont aussi plus faibles. L’écart se fait en termes de niveau de rendement assuré et niveau de performance de l’agriculteur. Certaines interviews m’auront permis de jouer sur des notions de vocabulaire, notamment en questionnant la différence réelle entre ce qui est considéré comme de l’assurance dans les pays développés – très souvent subventionnée et permettant des primes d’assurances plus faibles à payer pour l’agriculteur – et la micro-assurance dans les pays en voie de développement – parfois non subventionnée, qui assure des montants plus faibles. Critiquer l’assurance dans les pays développés mais ne pas critiquer la micro-assurance dans les pays en voie de développement pourrait sembler paradoxal.
Le principe d’assurance indiciel ou paramétrique trouve son intérêt dans les pays en développement parce qu’il permet de palier des endroits où la capacité administrative est faible, le crédit est limité et où les secours aux catastrophes passées ont pu être retardés. Ici, c’est la loi des grands nombres qui prime, c’est-à-dire que l’assureur se rémunère sur une petite marge mais qui, multipliée par un grand nombre d’agriculteurs assurés, permet à l’assureur de trouver son intérêt. C’est une assurance de masse avec un faible risque pour les assureurs parce que les assurés assurent des petits montants. Mais est-ce que ce format est rentable pour l’assureur ? On aurait tendance à penser qu’il faut que ça le soit mais d’un autre côté, l’assureur est aussi là pour fournir un service de sécurisation et les agriculteurs des pays en développement encourent eux aussi des risques graves et peuvent avoir besoin de s’assurer. Il y a donc ici aussi une notion de responsabilité des assureurs et réassureurs. L’assurance indicielle permet à l’assureur d’avoir également moins de frais de contrôle. L’assureur ne pourrait de toute façon pas expertiser l’ensemble des surfaces des agriculteurs assurés, déjà parce que le nombre d’agriculteurs est beaucoup plus important puisqu’ils cultivent de petites surfaces, et ensuite parce que les réseaux d’experts sur le terrain ne sont de toute façon pas toujours développés. Dans les situations où peu d’historique de données et peu de statistiques sont disponibles, les produits d’assurance indicielle trouvent plus de pertinence que les produits d’assurance classiques.
On retrouve néanmoins les mêmes limites que sur l’assurance indicielle classique, notamment avec le risque de base. Plus la répartition géographique des assurés est dispersée, plus la variabilité des conditions agricoles est importante, et plus le risque de base est fort. Il est donc important pour les assureurs et réassureurs d’avoir un portefeuille d’assurés diversifié dans plusieurs régions différentes parce que, même si les montants de micro-assurances sont faibles, une inondation ou une tempête peut affecter énormément de petits agriculteurs d’un coup.
Gardons néanmoins en tête que la micro-assurance n’est pas non plus la solution à tous les maux. L’Afrique de l’Ouest, par exemple, présente un paysage contrasté où près de 60% de la population est rurale, avec un secteur agricole qui représente 40 % du PIB, alors même que l’agriculture représente à peine 5 % des crédits à l’économie (CICA, 2020). La micro-assurance peut difficilement remédier comme par miracle à tous ces désordres mais elle peut, en revanche, si elle est soutenue, aider à une meilleure coopération entre les acteurs du territoire. Dans les pays en voie de développement, ces assurances indicielles peuvent être intéressantes en ce sens qu’elles peuvent permettent de garantir des crédits pris par les producteurs, notamment des crédits de campagne (comme des intrants) par exemple lorsque les conditions environnementales – notamment la pluviométrie – sont insuffisantes. Dans la mesure où l’absence de financement et l’accès au crédit peuvent être une des raisons expliquant une agriculture de subsistance et des rendements très faibles, la garantie de crédit peut s’avérer très intéressante. Le fonctionnement est le suivant : la micro-assurance sert à pré-financer des intrants (semences) et, si la pluviométrie est insuffisante, les producteurs ne doivent pas rembourser le crédit d’intrants. Encore faudrait-il que les primes de micro-assurances soient suffisamment abordables pour les petits producteurs, et que les primes n’augmentent pas de façon trop importante dès l’annonce d’un évènement climatique majeur.
Attention néanmoins aux déviances possibles de ces formats d’assurance dans ces pays-là. Quand cette assurance est un moyen pour des firmes agro-industrielles de pénétrer de nouveaux marchés et de vendre des semences hybrides, les questions de la lutte contre la pauvreté et les inégalités et de préservation des ressources naturelles doivent être remises au centre du débat.
Tentons de prendre un peu de recul
Que dire de la réforme en place ?
Un premier bilan rapide
Le premier défi de la réforme proposée en France est maintenant celui du nombre et de la mobilisation. Pour doubler le nombre d’assurés, et notamment atteindre 60% des surfaces assurées en grandes cultures et en viticulture, et 30% des prairies et en arboriculture, il faudra convaincre 70 000 éleveurs, agriculteurs et viticulteurs actuellement non assurés en MRC de passer le cap. D’après mes interviewés, l’objectif semble atteignable en grandes cultures par l’extension des contrats grêle en place. En viticulture, le gel de 2021 va dégrader la moyenne olympique renforçant la tentation de rester sur des contrats Grêle au rendement au potentiel. En arboriculture, il faudra voir si les offres proposées apparaitront suffisamment attractives pour remonter le faible taux d’assurés. Du côté de l’élevage, les agriculteurs semblent attachés au régime des calamités agricoles malgré ses insuffisances et n’ont jusqu’à présent pas été convaincus par l’assurance paramétrique sur les prairies.
Le diable se cache dans les détails. La réforme pourrait effectivement se jouer sur les critères et les modalités choisies. Et en termes de seuil, on a vu que ça pouvait y aller bon train (seuils de déclenchement par culture, niveau d’intervention de l’état, niveaux de franchises, prise en compte du règlement Omnibus…). Ceux qui sont sûrs de voir leur situation s’améliorer à court terme, ce sont peut être les assureurs, en ce sens que leur risque sera plafonné parce que leur engagement sera plus restreint. Au niveau des agriculteurs, il faudra surement attendre l’ensemble des modalités pour en tirer de réelles conclusions. Néanmoins, l’expérience acquise depuis 2005 montre que la tarification seule ne suffira pas. A ce stade, il ne semble pas y avoir de moyen clairement défini pour assurer la promotion de la réforme auprès des non-assurés, et plus spécialement auprès des éleveurs.
Peut-on demander à un agriculteur de payer pour un risque auquel il est soumis sachant que tous les citoyens dépendent de la production agricole ? La réforme proposée par le gouvernement acte le principe de solidarité par la remise à niveau du fonds de solidarité nationale. L’assuré, comme le non assuré, y aura accès en cas de perte de récolte importante (même si ce n’est pas dans la même proportion). On ne peut donc pas dire non plus que tout le poids de l’assurance est porté sur les seuls épaules de l’agriculteur. Certains acteurs, notamment la confédération paysanne, défendent des modèles encore plus solidaires, basés par exemple sur le mécanisme de la contribution volontaire obligatoire (CVO), avec en gros l’idée derrière la tête de faire cotiser les acteurs de la filière alimentaire qui brassent pas mal d’argent. La contribution volontaire obligatoire ne relève pas de l’État mais résulte d’accords interprofessionnels. Ce sont ainsi les professionnels concernés qui doivent solliciter l’État pour qu’il étende la CVO à tous les acteurs de la filière. Autrement dit, il faudrait que dans chaque filière intervenant en aval dans la chaîne des productions agricoles, plus de 70 % des acteurs se mettent d’accord pour demander au Gouvernement d’étendre à tous ce dispositif de contribution. Avec le nombre de filières en place, cette solution est-elle réellement plausible ? On peut également se demander si les acteurs de la filière agroalimentaire, même s’ils cotisaient en plus dans le cadre de la CVO, seraient prêts à assumer une hausse des prix pour le consommateur. Le déséquilibre est tel au niveau de la filière qu’il est possible que ce coût soit répercuté sur l’agriculteur…
La mise en place du pool d’assurance
Le pool d’assureurs proposé devrait répondre à un manque de visibilité et une demande de transparence accrue du système assurantiel. Et cette transparence est multi-forme. C’est d’abord une transparence sur les tarifs pour que les acteurs soient au courant des résultats de l’assurance MRC, de l’évolution des tarifs de l’assurance et de ses options, de son état d’équilibre ou de déséquilibre, ou encore de ce qui tient au risque assurable (par le privé) et au risque non assurable (pris en charge par la solidarité nationale). Il faut des systèmes comparables pour que les assurés n’aient pas le sentiment de se faire rouler et pour faire évoluer les mentalités.
Néanmoins, il ne faudrait pas que le pool d’assurance, sous prétexte d’une volonté positive de dynamiser le marché (avec un partage fort des données entre assureurs) ne se traduise par une uniformisation des offres ; le risque étant de faire se retirer tous les petits assureurs du marché. C’est par plus de diversité d’offres et de compétition entre les offres que chaque agriculteur pourra y trouver son compte. Il faut quand même dire qu’à l’heure actuelle, les contrats sont quand même déjà assez homogènes parce que le système assurantiel est réglementé. Les contrats diffèrent légèrement dans les modèles tarifaires et les modèles mathématiques utilisés. Rajoutons que les experts sur le terrain sont des indépendants, ce ne sont pas des employés des compagnies d’assurances. Ces experts peuvent ainsi travailler pour plusieurs compagnies, et utiliser à chaque fois la méthode d’expertise de l’entreprise pour laquelle ils réalisent une évaluation de sinistre. Avec la réforme, les contrats devraient être encore plus homogènes, non seulement parce que les cahiers des charges vont rester identiques mais aussi parce que les pouvoirs publics vont exiger que les modalités de gestion de sinistre soient les mêmes. Les méthodologies vont aussi être harmonisées et institutionnalisées. Les tarifs pourront alors être très proches mais pas exactement les mêmes au regard du droit de la concurrence. Partager les données pourra permettre également de préciser les taux de perte et potentiellement de s’exonérer de certaines expertises. On peut imaginer que, pour une zone pédoclimatique homogène avec des taux de pertes mesurées réellement par un expert, si un agriculteur localisé dans cette zone appelle pour un aléa climatique, les mesures déjà réalisées par l’expert pourront être utilisées comme valeur de référence. Il faudra bien sûr faire attention à ce qui est de l’ordre du transposable d’une parcelle à une autre (une erreur à la marge acceptée par les assurés et assureurs) et ce qui ne l’est pas, avec des parcelles trop différentes et des mesures non représentatives.
Certains diront malgré tout que le pool d’assureurs reste aussi une façon pour les principaux assureurs du marché de partager leurs mauvais résultats avec le reste du pool (les principaux assureurs perdent actuellement de l’argent avec l’assurance récolte). Il faut bien comprendre que les risques vont être regroupés au sein de ce pool d’assurance. C’est-à-dire que l’assureur qui touche 5% des primes d’assurances sur le pool aura aussi à gérer 5% des sinistres de l’ensemble du pool. Mais si, en tant que petit assureur, j’ai fait en sorte d’avoir un portefeuille de clients diversifié, je devrai partager aussi en moyenne les sinistres des gros assureurs qui auront un portefeuille peut-être plus risqué que le mien (parce que les principaux assureurs souffrent actuellement des phénomènes d’anti-sélection et d’aléas moral dont nous avons parlé). Les assureurs principaux du marché sont des assureurs multi-branches et ne proposent pas que des assurances climatiques aux agriculteurs, ils assurent également sa voiture, ses tracteurs, ou encore ses bâtiments. L’assurance récolte est donc aussi contrebalancée sur d’autres formats d’assurance.
Pour d’autres, le pool d’assurance va permettre à tous les assureurs d’arriver avec leurs sinistres, leurs primes, et leur sinistralité. Les nouveaux assureurs sur le marché pourraient ainsi profiter des données, de l’historique et de l’expérience des assureurs déjà présents sur le marché depuis longtemps. Les nouveaux entrants pourraient ainsi ne pas avoir besoin de développer des modèles tarifaires et bénéficier des données des anciens.
La réforme en cours de l’assurance pourra potentiellement conduire à une augmentation du tarif de l’assurance. Comme les équilibres techniques des principaux assureurs ne sont pas atteints (ratios sinistres à prime), les agriculteurs seront certainement assurés, non plus avec 25-30% de franchise mais avec 20% de franchise (si le règlement européen Omnibus est mis en place). La prime d’assurance sera donc augmentée pour les assurés. On pourrait craindre que la première réaction des agriculteurs soit de ne pas vouloir assumer cette hausse de prix. La responsabilité des mauvais équilibres techniques des principaux assureurs pourra paraitre ainsi plus diluée au travers du pool d’assurance.
Attention néanmoins au fait que les modalités de ce pool ne sont pas complètement fixées. Les espagnols, au sein de leur système AgroSeguro, ont mutualisé les données, les méthodes de gestion de données, les primes, les sinistres, et le système d’information, l’actuariat, ou encore la recherche et développement. Le pool prévu en France ne semble pas aller jusque-là. Rappelons qu’en Espagne par exemple, un pool d’assurance existe, certes, mais qu’il avait été créé à l’époque parce qu’il n’y avait pas de capacité de réassurance privée. Il a fallu créer un pool pour créer de la compétence. En France, cette capacité existe déjà.
Le budget alloué est-il suffisant ?
L’Etat a récemment acté que le fonds de solidarité nationale serait doté de près de 600 millions d’euros, soit un doublement du budget alloué jusqu’à maintenant. Ce budget sera en partie pris sur la PAC, pour un tiers, le reste provenant directement de l’Etat. Est-ce un montant important ? Est-ce un montant suffisant ? Pour donner un ordre de grandeur, 600 millions d’euros, c’est la deuxième ou troisième ligne budgétaire après la PAC. C’est un peu du même niveau que la défiscalisation sur les bio-carburants. Ca n’est donc pas un montant complètement négligeable. Ce montant, indicatif, est de toute façon assez théorique. Avec les simulations de la DGPE (Direction Générale de la Performance économique et environnementale des entreprises), si toutes choses étaient égales par ailleurs (avec les données de sinistralité d’aujourd’hui et la même répartition des cultures assurées), plusieurs interviewés s’accordaient à dire que le budget pourrait couvrir, en moyenne, les données de sinistralité, pour un doublement des surfaces couvertes, c’est-à-dire pour deux fois plus de contrat d’assurance récolte souscrits par les agriculteurs.
Plusieurs inconnues restent malgré tout dans l’équation. Quel va être l’impact sur le budget si le taux de pénétration de l’assurance en arboriculture et en prairies augmente (il est actuellement de moins de 5%) ? Si les surfaces assurées doublent mais que le portefeuille de risques évolue lui aussi, le coût de l’assurance a des chances d’être plus salé que prévu. Et ce sans compter que le déréglement climatique en cours va très certainement augmenter le taux de sinistralité sur les années à venir. D’un point de vue plus terre à terre, le choix de suivre le règlement européen Omnibus en réduisant les franchises des contrats d’assurance devrait augmenter l’enveloppe budgétaire de l’assurance de manière assez importante (l’application du règlement Omnibus est une vraie amélioration du risque mais ça coûte cher). Omnibus permet de diminuer les franchises des contrats d’assurance de 25-30% (seuil actuel) à 20%. A l’heure actuelle, un agriculteur pourrait tout à fait demander à réduire la franchise de son contrat pour la passer de 30% à 20%. Le prix du contrat d’assurance (la prime d’assurance) augmenterait assez fortement avec ce rachat de franchise parce que la distribution des sinistres suit en gros une distribution normale (une gaussienne) autour de 25% de franchise. Néanmoins, il faut bien comprendre qu’à l’heure actuelle, la subvention accordée par l’Etat ne couvre pas la tranche des 20 à 30% de franchise, elle ne s’applique que pour la partie au-dessus des 30% de franchise. Si le règlement Omnibus était appliqué, l’Etat devrait subventionner la franchise dès 20% – la subvention augmentant fortement par construction puisque le prix du contrat d’assurance augmenterait très largement aussi. Avec beaucoup de souscriptions, et des franchises basses, le budget de l’Etat pourrait donc s’avérer insuffisant.
Le sujet de l’assurance est d’une telle importance que certains en appellent même à en faire un sujet international, et pourquoi pas à créer un troisième pilier de la PAC. La production agricole est un enjeu très important de stabilité géopolitique – l’actualité ukrainienne nous le rappelle douloureusement (certaines institutions prévoient d’ailleurs déjà des pénuries dans certaines parties du monde dans les mois à venir). Avec les risques que le déréglement climatique fait planer sur la production agricole mondiale (sécurité alimentaire, malnutrition…), ce sujet ne peut pas être pris à la légère.
La question des références de rendement
Les niveaux de récoltes assurables dans les contrats d’assurance privés sont calculés à partir d’une moyenne de rendement dite « olympique », moyenne basée sur les rendements observés sur les cinq dernières années en enlevant la meilleure et la moins bonne année (on parle également de moyenne triennale puisque la moyenne est réalisée sur trois de ces cinq années). Comme nous l’avons vu dans ce dossier, l’utilisation de cette moyenne olympique est assez critiquée sur le terrain parce qu’avec le déréglement climatique en cours, les rendements observés sont susceptibles de diminuer fortement, et donc le niveau de rendement assurable également. Certains proposent plutôt de passer par la moyenne décennale, qui reviendrait alors à calculer la moyenne sur les 10 dernières années, donnant un horizon un peu plus homogène au calcul de rendement passé. Techniquement, pour un assureur l’utilisation d’une moyenne sur 10 ans (au lieu de 5) n’est pas très compliqué. La difficulté réside dans le fait d’aller chercher des vieux historiques (par exemple dans les dossiers d’un agriculteur).
Il est néanmoins raisonnable de penser que cet écart entre moyenne olympique et moyenne décennale va progressivement être réduit dans le temps. Nous assistons en effet à une accélération de la dégradation des potentiels de production. En étant optimiste, on pourrait penser que cette dégradation n’est peut-être pas vouée à se prolonger indéfiniment si de nouvelles pratiques, itinéraires, et rotations viennent stabiliser de nouveaux systèmes d’exploitation. Dans les faits, hélas, on peut plutôt craindre une accélération exponentielle des dégâts liées au changement climatique avec de fortes rétroactions positive entre climat, rendement, maladies, ravageurs, ou encore espèces invasives. Ces rétroactions pourraient entrainer un effet domino rendant les évolutions et adaptations très difficiles. Sur le plan juridique, l’indemnisation de l’accélération de la dégradation des potentiels de production que mesurerait l’écart entre moyenne olympique et moyenne décennale pourrait être considérée comme relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole. Pour rattacher cette aide au régime des catastrophes naturelles (Cat Nat), on pourrait jouer sur l’imprécision relative de la notion de Catastrophe naturelle qui prévoit de laisser au gouvernement le soin d’interpréter et de qualifier les faits.
Le concept de moyenne olympique est imposé par la réglementation communautaire applicable aux indemnisations du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) en vertu des accords de Marrakech de 1995 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Pour certains, sortir de la moyenne olympique changerait la nature de l’indemnisation versée ; cette indemnisation devenant alors une aide sectorielle et non plus une aide exceptionnelle. En prenant un peu de recul par rapport au déréglement climatique en cours, on peut également considérer que décaler le délai de la moyenne olympique (en la faisant par exemple passer à 10 ans) aurait un intérêt momentané́ dans le sens où avec une tendance longue au réchauffement climatique, on ne ferait en réalité que reporter le problème de quelques années. Dans un contexte où les performances de rendement des cultures se dégradent et où les rendements de référence vont évoluer à la baisse, on peut néanmoins se demander si des limites ont été déterminées ou prévues quant à la diminution des rendements de référence.
Notez que l’assurance paramétrique se passe très bien des moyennes olympiques de l’assuré. Ce sont les pertes historiques sur le plus long historique possible (30 ans si possible) qui font foi. La tendance moyenne de ces séries historiques est enlevée (on parle de « detrending » en anglais) pour tenir compte des évolutions passées (tendance à l’amélioration des production, changement climatique déjà ressenti …)
Dans les contrats traditionnels d’assurance récolte, l’objet de la garantie, ce sont les pertes de l’année ‘n’. Ce ne sont que les pertes de récolte (ce sont souvent des pertes de quantité, même si certaines dispositions existent sur la perte de qualité, les frais de resemis, ou encore les frais additionnels de récolte). Sur l’assurance multirisque climatique subventionnée, il n’y a rien sur les pertes de fond. Si des pieds de vigne sont détruits, ce n’est pas pris en compte. Dans le cas des assurances paramétriques, c’est un peu différent parce que l’objet de la garantie prend en compte toute perte pécuniaire relative aux évènements quelle qu’elle soit. Ce n’est donc pas uniquement une baisse de rendement mais ce peut être des frais additionnels de la lutte contre le réchauffement climatique (ce serait bien ici en lien avec une perte pécuniaire).
De manière générale, la question de la référence est toujours un sujet tabou. La référence rassure parce que nous avons l’impression de nous comparer à quelque chose qui fait foi, quelque chose de précis qui ne pourra pas être remis en question. Dans le domaine de l’assurance, cette notion de référence est en réalité assez subjective. Une référence de niveau de rendement sur la base de coupes ou d’échantillonnages sur le terrain dépendra de l’expertise de l’opérateur. D’après plusieurs de mes interviewés, certains tests d’expertise, réalisés en conditions contrôlées lors de journées et/ou d’évènements d’assureurs (par exemple par l’association internationale d’assurance grêle) auront révélé des écarts de près de 30% entre des mêmes sinistres évalués par différents experts. L’idée n’est pas ici de remettre en cause l’expertise des opérateurs de terrain, bien au contraire, mais de requestionner la notion de référence qui est peut-être trop souvent considérée comme la vérité absolue. Il faut d’ailleurs garder en tête que lorsqu’il n’existe aucune référence sur une zone donnée pour une culture d’intérêt, (et si l’agriculteur n’a aucune référence), ce sont vers des sources publiques et ou voisines qu’il faudra se retourner (le niveau de rendement sur une parcelle voisine par exemple), ce qui – vous en conviendrez – n’est pas nécessairement de la plus haute précision. Cette notion de référence reste de toute façon importante parce que les assureurs se doivent d’avoir des valeurs opposables à mettre dans leur contrat d’assurance.
Vers une démutualisation du risque et une individualisation de la société ?
N’assisterions-nous pas à une tendance à la démutualisation des risques assurantiels et à une individualisation de la société ? On pourrait avoir l’impression que l’assuré refuse de payer une assurance sans retour sur son investissement, chose qui, nous l’avons déjà discuté, va à l’encontre du principe même de l’assurance. La démutualisation semble s’insinuer tranquillement par la sélection en faisant des primes d’assurances adaptées à chaque assuré. Et ce sont les réassureurs qui reconstituent la mutualisation par un portefeuille d’assurés diversifié. L’économie numérique et les technologies associées offrent la possibilité de créer des offres individuelles sans augmenter de manière significative la valeur d’un produit. L’individualisation de l’offre d’assurance implique à la fois l’évaluation individuelle du risque par l’augmentation du nombre d’informations collectées sur l’assuré et l’objet de l’assurance, mais aussi la préparation d’une offre d’assurance individuelle à la demande de l’assuré. Pourrait-on arriver à des assurances hyper individualisées comme des assurances au niveau du profil génétique des assurés, sur les fumeurs, ou encore sur des contrats routiers pour distinguer les gros rouleurs des petits rouleurs ? Ne serions-nous pas alors arrivés à un point de non-retour ? Le déréglement climatique auquel nous faisons face est un problème tellement systémique et qui demande des modifications si profondes de nos comportements que la tendance à l’individualisation de la société a de quoi faire peur.
Compléments de discussion
Aujourd’hui, les assureurs régissent par zone mais peut-être faudrait-il déjà que l’assurance soit régie au niveau national. Le déréglement climatique demande à prendre du recul. Les risques climatiques sont très hétérogènes entre régions. Même si certains aléas climatiques peuvent causer des dégâts catastrophiques à l’échelle d’une année sur certaines régions – on a vu le cas en 2021 avec l’épisode de gel, l’ensemble de la France n’a pas été touché. Un portefeuille de risques au niveau national permettrait de continuer à mutualiser les risques.
Le marché de l’assurance agricole en France est très déséquilibré, avec deux assureurs se partageant la majorité des parts de marché. Un marché plus équilibré, disons par exemple cinq acteurs au-dessus de 10% de parts de marché, pourrait peut-être permet de dynamiser le secteur. L’influence des acteurs sur le marché est très importante, avec la possibilité de mettre de la pression au vu de leur capacité d’assurance actuelle. On pourrait craindre que les principaux assureurs du marché ne proposent que des solutions dans le cadre de la PAC (le contrat grêle, par exemple, n’est pas subventionné par la PAC contrairement au contrat multi-risques climatiques).
Certaines productions – porte-graine fourragères et potagères – sont aujourd’hui dépourvues d’offre d’assurance récolte (ou avec des primes à des niveaux prohibitifs). On peut également penser aux systèmes diversifiés et agrosystèmes complexes de petite échelle (pourtant connus comme facteurs de résilience d’une exploitation) pour lesquels il semble encore compliqué à l’heure actuelle de proposer des assurances systémiques. L’assurance récolte est souvent accusée d’être un frein à une meilleure durabilité écologique des pratiques agricoles, parce qu’elle inciterait au retournement des prairies et découragerait la diversification des cultures. Comment ces systèmes et/ou cultures seront couvertes dans le cadre de la réforme ? Nous n’en savons visiblement pas grand-chose.
Assurance indemnitaire ou assurance indicielle ?
Le marché de l’assurance semble être plutôt organisé entre les tenants du tout indemnitaire ou du tout paramétrique, la plupart des boites d’assurance, de courtage ou d’insuretech sont spécialisées dans un type d’assurance. Mais a-t-on vraiment besoin de choisir définitivement entre ces deux formats assurantiels ? Ne peut-on pas plutôt imaginer que ces deux formats soient complémentaires et que finalement, aucun ne remplace l’autre ?
Assurances indemnitaires et paramétriques ne jouent déjà pas sur les mêmes échelles spatiales. Au niveau d’une ferme française (50 à 100 hectares), au vu des indices à disposition et de la diversité pédoclimatique sur les exploitations, la granularité est assez limitée pour espérer avoir une corrélation paramétrique parfaite entre un indice et la réalité du sinistre. A l’échelle d’un bassin de production, d’un syndicat, d’une union de producteurs ou encore d’une coopérative par contre, le paramétrique semble être beaucoup plus pertinent. D’un point de vue technique, l’assurance paramétrique permet effectivement d’économiser fortement en termes de capacité d’expertise terrain et de frais de gestion. Ce format d’assurance oblige néanmoins l’assureur paramétrique à un gros travail en amont du contrat pour lier les indices aux pertes de l’exploitant et réduire au maximum le risque de base. En France, l’approche indicielle pourrait également avoir vocation à se substituer, pour l’intervention de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) en activation du nouveau Fonds de solidarité pour l’agriculture, à l’approche indemnitaire aujourd’hui en vigueur. Si la réforme de l’assurance agricole fonctionne comme prévu, on peut s’attendre à une augmentation substantielle du nombre d’assurés – et ce d’autant plus que les assureurs seront maintenant obligés d’assurer un agriculteur qui le demande.
A l’heure actuelle, les assureurs n’auront pas la capacité de répondre à une telle demande de contrats d’assurance. La population d’experts est dimensionnée pour expertiser 30% des surfaces (c’est le taux de souscription actuel à des contrats d’assurance en grandes cultures et viticultures). Au 1er janvier 2023, en passant de 30 à 100% des surfaces potentiellement assurables, que le client choisisse des garanties complémentaires ou qu’il choisisse d’être sous le régime du fonds des calamités agricoles, les experts ne pourront pas tripler leurs effectifs. Le développement de l’indiciel pourrait être une façon d’y répondre. Il faudra peut-être déjà faire prendre conscience aux acteurs du marché que l’assurance paramétrique n’est pas une rupture du système assurantiel en place mais bien une approche technique comme une autre. Cela demandera néanmoins de la formation – notamment pour les conseillers sur le terrain – pour qu’ils puissent se sentir à l’aise avec ce type de contrats. Entre un contrat indemnitaire et un contrat indiciel qui protégerait une culture pendant seulement la période de 3 semaines la plus à risque en terme de sécheresse, on peut s’attendre à ce que le conseiller ne soit pas forcément à l’aise à proposer un contrat indiciel à l’agriculteur et préfère pousser plutôt un contrat multi-risque plus classique. La réforme de l’assurance ne mentionne pourtant pas grand-chose quant au déploiement et à la promotion de l’assurance paramétrique.
La différence majeure entre les deux assurances est que l’assurance indemnitaire est subventionnée, alors que l’assurance paramétrique ne l’est pas. Il est donc nécessaire que le risque de base de l’assurance paramétrique soit très faible pour qu’elle soit préférée, ou alors qu’il n’existe pas d’offre indemnitaire. On peut par exemple penser à des risques non assurables comme un risque sanitaire. Comme ce risque n’est pas assurable en indemnitaire, on pourrait tout à fait l’assurer en paramétrique avec un indice de pression maladies. Peu importe alors la perte de production de rendement. C’est la valeur de l’indice de pression maladies qui est assurée. Encore une fois, l’aléa moral peut modifier le comportement de l’assuré en ce sens qu’un agriculteur assuré contre le risque fongicide ne va peut-être pas surveiller sa parcelle avec autant de précaution que s’il n’était pas assuré. Même exemple sur la qualité des céréales. Pour un agriculteur en contrat avec sa coopérative ou négoce et engagé à niveau de qualité de grain (PS, protéine …), on peut imaginer reconstruire rétroactivement une corrélation entre des indices et la qualité de la collecte de la coopérative avec une base de données météorologiques (autant dire qu’il y a intérêt à ce que la corrélation soit bonne pour que le contrat soit renouvelé). Dans d’autres cas, il n’y a pas d’offre indemnitaire tout simplement parce qu’il n’y a pas d’expertise terrain. C’est par exemple le cas de la prairie dont on a parlé plus haut parce que l’expert peut refaire un bilan fourrager sur l’année en cours, mais pas sur les années précédentes.
L’assurance paramétrique est aussi particulièrement intéressante pour les cas où les historiques de données sont manquantes et que le risque ne peut pas être correctement modélisé. L’assurance paramétrique permet de répondre à des interrogations très concrètes d’assurés sur des choses mesurables : une assurance sur des intensités de pluie, des hauteurs d’inondation, du gel. En Afrique, là où il n’y a pas forcément de réseaux d’experts et de séries historiques, il ressort qu’il semble intéressant de conjuguer l’indiciel pur (indice de végétation, humidité du sol, température) et des mesures terrains ponctuelles réalisées par les clients eux-mêmes. Dans le cadre de certains contrats, c’est l’assuré qui prend une photo de sa culture et l’envoie ensuite pour qualifier les types de dégâts. Force est de constater que, de toute façon, il restera toujours des cas très complexes de paramétrique avec un risque de base qui nécessiteront le passage d’un expert.
Pour les fervents défenseurs du paramétrique, il apparait difficile de leur faire accepter le recours à une contre-expertise humaine dimensionnée, dans le sens où cette contre-expertise viendrait ternir l’image de pureté de l’assurance indicielle. A l’échelle d’une structure comme une coopérative ou un négoce, on pourrait accepter par exemple que 5% des sinistres soient contre expertisés. Il est pourtant possible d’imaginer dans le futur, sur des sinistres simples ou avec un aléa qui ferait que tout un bassin soit touché (dans le cas d’une sécheresse par exemple contrairement à un aléa grêle qui se matérialise plutôt sous la forme de couloirs de grêle), que l’on bascule sur des systèmes d’assurances paramétriques mais que l’on garde une partie indemnitaire pour les sinistres plus compliqués à modéliser et pour contre-expertiser des éventuels résultats. C’est donc finalement peut-être une approche hybride qu’il faudra plutôt faciliter, où l’indiciel viendra aider ou augmenter l’expertise humaine, mais jamais vraiment la remplacer. Les technologies numériques pourraient permettre de générer des cartes de situation croisant données météo, observations de la végétation et impact d’un évènement, et qui, croisés avec une culture donnée, permettrait de donner à l’expert une fourchette des zones vraiment sinistrées ou pas.
Assurance et déréglement climatique
Faut-il forcément s’assurer ?
La première question est peut-être déjà de savoir si l’on peut s’assurer. Un agriculteur ne peut en effet accéder à un produit d’assurance, de même qu’il ne peut constituer d’épargne – qu’elle soit de précaution ou non, que s’il dégage suffisamment de de revenu pour cela. Un agriculteur avec un excédent brut d’exploitation (EBE) de 10.000 euros, et qui plus est volatil, ne peut pas épargner, ni s’assurer. Force est de constater que le pourcentage d’exploitations agricoles qui ne permettent pas de générer un tel revenu ou qui ne le permettent pas de façon stable est assez terrifiant.
A l’autre bout du panier, ceux qui n’ont pas besoin de s’assurer sont ceux qui ont les reins assez solides pour tenir le coup de plusieurs mauvaises productions successives – on peut penser par exemples aux grands crus viticoles. Le principe de l’assurance, c’est de payer la valeur du produit pour pouvoir le remplacer. Si un grand cru perd l’entièreté de sa production suite à une grêle et qu’il est assuré, il touchera certes une indemnisation importante. Pourra-t-il néanmoins racheter le même grand cru ? Rien n’est moins sûr, et l’on peut alors se demander si une telle assurance a finalement du sens. Si, dans un autre cas, je suis producteur bovin et de maïs ensilage, et qu’il grêle, il me faut un capital pour racheter du maïs ensilage (ou de la paille ou autre). Dans ce cas-là, l’assurance grêle joue son rôle premier.
Pour une exploitation plus classique avec un EBE raisonnable, il semble qu’il y ait toujours du sens à protéger un contrat de vente. Il existe des situations où il n’est pas nécessaire de s’assurer et les agriculteurs ont raison de ne pas le faire. D’autres, au contraire, où des agriculteurs devraient ou auraient dû s’assurer. On peut effectivement se demander comment certaines exploitations peuvent tenir sans s’assurer lors d’aléas climatiques réguliers sur les exploitations. Certaines situations sont plus compliquées, là où les agriculteurs sont assurés mais où l’assurance à elle-seule n’est pas suffisante.
Outre les agriculteurs dans des situations économiques désastreuses, l’argument du coût de l’assurance – en ce sens qu’il serait trop cher – pose question. Pour les agriculteurs bien lotis, au vu du prix de vente de certaines productions, le coût de l’assurance parait en réalité assez dérisoire. Dans le cas de grands crus viticoles, l’assureur n’assurera bien sûr pas au prix de la bouteille, mais le débat ne semble pas vraiment être là. Quand on voit les chèques de certains assureurs pour les gros sinistres, on peut effectivement se demander comment les agriculteurs non assurés arrivent à survivre. Le coût de l’assurance doit s’évaluer dans une réflexion beaucoup plus large de l’exploitation. L’agriculteur doit se demander ce qu’il attend de l’assurance, doit prendre en compte ses charges et ses emprunts, et considérer où il est dans son parcours professionnel (ce n’est pas la même chose pour un agriculteur nouvellement installée avec beaucoup d’emprunts et un agriculteur déjà installé depuis longtemps). Les formules assurantielles sont extrêmement nombreuses. Sur cet argument de coût, attention néanmoins à ne pas trop se défausser sur un risque climatique qui serait trop cher et impliquerait forcément une intervention de l’Etat. Les assureurs peuvent eux-aussi avoir mal tarifé leur risque ou ne pas avoir proposé d’offres suffisamment pertinentes pour la filière.
Le contrat multirisque climatique est subventionné à 65% (au moins pour le niveau de garantie socle). Avec une tarification de cet ordre-là, une exploitation peut s’attendre à recevoir de l’argent. Lorsque l’agriculteur paye une assurance récolte de 100€, l’assureur reçoit les 100€ qu’il utilisera ensuite pour payer le courtier d’assurance (disons 10€), les frais de gestion (disons 20€) et pour payer les sinistres (les 70€ restants). L’agriculteur, quant à lui, paye donc 100€, reçoit 65€ de subventions de l’Etat (contrat subventionné à 65%) et peut s’attendre à toucher 70€ d’indemnisation en cas de sinistre. En espérance, l’agriculteur peut donc gagner de l’argent lors d’un sinistre ; il aura finalement payé 35€ de contrat d’assurance (100-65) et aura reçu l’indemnisation de l’assurance suite au sinistre. Pour les petites exploitations, ou même les exploitations de taille classique, les cotisations des primes d’assurances peuvent ne pas être négligeables au regard du chiffre d’affaires de l’exploitation. On peut néanmoins penser qu’en mutualisant les risques – avec plus de souscription à des contrats d’assurance, les coûts des contrats d’assurance diminueraient suite à des franchises très basses.
Atteindre un taux de couverture élevé pose la question récurrente de l’obligation de l’assurance. Simple dans son principe, l’obligation est débattue dans de nombreux pays. En France, cette solution n’a pas été retenue car elle aurait été politiquement lourde à assumer. Cette proposition ne pourra devenir secondaire que s’il y a une très forte généralisation de l’assurance et qu’on ne pourra plus attendre grand-chose de la mutualisation des risques assurantiels. Rajoutons également qu’aujourd’hui, de jeunes agriculteurs ne se voient pas accorder de prêts s’ils n’ont pas souscrit une assurance récolte.
Comment évoluent le risque et l’assurance avec le déréglement climatique ?
Les rapports existants sur les résultats de l’assurance et les dépenses des assureurs liés au déréglement climatique sont assez clairs, le budget et les coûts explosent. Des risques qui étaient exceptionnels avant deviennent maintenant récurrents voire complètement normaux. L’assurance fonctionne sur la loi des grands nombres, lorsque les aléas sont distribués de manière identique et indépendante et que le nombre d’assurés est important. Si ces nouveaux coûts deviennent la norme, il y aurait en gros deux solutions. Soit les assureurs continuent à payer comme ils faisaient avant et comme les primes d’assurance ne couvrent plus les sinistres sur longue période, l’assureur coule. Soit les assurés continuent à payer et pour que le système survive, il va falloir augmenter fortement les primes d’assurance. Comment alors s’adapter face au changement climatique et comment faire de l’assurance un outil d’incitation ? Avec des assurances de plus en plus chères, la tentation sera de les subventionner toujours plus (c’est par exemple le cas avec la subvention du prix à la pompe d’essence). La tendance sera inflationniste et pourra masquer l’évolution sourde des risques climatiques de plus en plus présents qui appellent en réalité à une adaptation des systèmes de production. Nous ne pouvons pas faire que compenser. Compenser ça va un temps, mais ça va coûter de plus en plus cher et ça n’est clairement pas toujours la meilleure des solutions.
Nous en avons déjà discuté mais les assureurs ne peuvent pas assurer quelque chose qui devient habituel. Un incendie qui a lieu tous les 20 à 30 ans est assurable. Lorsque la fréquence passe tous les deux ans, l’assurabilité n’est plus vraiment possible, que ce soient pour des questions d’aléas moral ou de pratiques car le risque a disparu. Alors que certaines situations étaient encore assurables à un bon prix, le déréglement climatique va pousser les assureurs à considérer que tel ou tel risque se réalise et que ça n’est donc finalement plus vraiment un risque (ça pose d’ailleurs problème pour un certain nombre d’exploitants pour lesquelles les conditions d’exploitations évoluent et qui ne peuvent par exemple ne plus produire les mêmes cultures). Il peut y avoir des assurances sur une tendance climatique mais il faut que l’assurance soit portée sur quelque chose qui ne soit pas prévu. S’il est prévu par exemple qu’on atteigne +2°C de réchauffement, on pourra imaginer assurer le fait d’obtenir 3°C au lieu de 2°C, c’est-à-dire que l’on assurerait le fait que le réchauffement soit plus rapide qu’attendu (vous admettrez que ce n’est pas très satisfaisant pour tout le monde parce qu’entre +2°C et +3°C, ça va piquer un peu). Aucune assurance ne paierait pour l’augmentation d’un indice planétaire de référence s’il était prévu que cet indice augmente. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une déviation par rapport à l’attendu. A partir du moment où les paramètres extérieurs deviennent trop marqués et que le sytème dérive, il devient alors nécessaire de rendre ce système indépendant des paramètres extérieurs pour que l’assurance continue à fonctionner. Il faut par exemple arrêter de construire en zone inondable, prendre des précautions vis-à-vis des pratiques agricoles, ou encore arrêter de produire certaines cultures en zones de risques.
Le changement climatique va accroître simultanément les besoins de protection des agriculteurs et le coût de l’assurance. Les assureurs, eux aussi, devront s’adapter. Premièrement, rien que dans la façon de prendre en compte les risques historiques (encore trop modélisés par des séries temporelles historiques alors que le climat n’est plus stationnaire), les modèles d’évaluation et de tarification des risques devront évoluer. La demande des agriculteurs pour de nouvelles solutions assurancielles passera par un élargissement de l’offre de couverture en termes de productions et de nature des risques (nous avons par exemple évoqué les assurances chiffres d’affaires et l’assurance marge). Le défi pour les assureurs est de répondre à ces besoins et d’élargir leur activité à de nouveaux territoires, tout en maîtrisant la hausse des primes. Si l’assurance paramétrique est une des voies dont nous avons largement discuté pour réduire les frais de gestion de l’assureur, il en existe de nombreuses autres (et de rappeler que les frais de gestion d’un contrat d’assurance ne sont pas si élevés que ça au regard du tarif complet de la prime d’assurance). On peut notamment penser à l’amélioration des circuits de distribution de l’assurance qui sera de plus en plus couplée à la fourniture de crédit et d’intrants, probablement dans le cadre d’une agriculture contractuelle, et qui mobilisera les différents maillons des filières agroalimentaires. Les assureurs pourront proposer de nouveaux services aux producteurs assurés, autour d’informations météorologiques, de conseils dédiés aux pratiques agricoles, ou encore à l’analyse de modèles climatiques pour accompagner l’assuré dans son futur risque et le conseiller sur la manière de s’en protéger ou de s’y adapter. L’assureur pourra également fortement pousser un comportement de prévention de risque – par de la sensibilisation et de la formation – dans le sens où certains risques ne seront bientôt plus assurables. Pour un assureur, accompagner ses sociétaires par la formation semble tiré du bon sens. Les assureurs forment par exemple à la conduite pour réduire les risques d’accident. Que ça soit en agriculture ou dans l’habitation ou dans l’automobile, c’est dans l’intérêt de l’assureur de réduire les (plus gros) risques pour assurer la mutualisation. Investir dans la prévention, c’est une façon pour les assureurs d’investir dans la gestion du risque.
Pour un assureur, c’est la volatilité des risques autour de la moyenne qui est important, ce n’est pas l’espérance (sauf si on assiste à une tendance à la hausse des risques et si la série des sinistres n’est pas stationnaire comme c’est le cas avec le déréglement climatique en cours). Face au risque climatique, on pourrait assister à un désengagement des assureurs (par des forfaits, par des économies de gestion avec de l’assurance indicielle…). C’est par exemple ce qui s’est avec les contrats d’assurance vie. Dans les produits d’épargne, les contrats d’assurance vie ont réduit les risques financiers pour les assureurs parce que les contrats sont passés de contrats majoritaires à taux minimum garantis (l’assuré souscrivait un contrat d’assurance vie et l’assureur lui proposait un taux annuel de 2% pendant 8 ans) à des contrats où l’assuré est celui qui porte le risque (l’assuré définit le type d’investissement souhaité et l’assureur lui donne le taux de rendement obtenu par le fonds). Les contrats majoritaires à taux minimum garantis fonctionnaient bien pour les assureurs lorsque les taux d’intérêt des obligations achetées par les assureurs (achetées avec l’argent des primes d’assurance) étaient très élevés. Quand les taux d’intérêt ont baissé, les taux minimums garantis devenaient en proportion de plus en plus importants pour les assureurs par rapport à ce qu’il était possible de réaliser. Dès les années 2000, dès que les taux d’intérêt des obligations sont passés sous les 4%, les assureurs ont pris conscience du risque parce qu’il leur fallait garantir aux assurés des taux annuels de 2% sur leur contrat d’assurance vie (avant les années 2000, les taux d’intérêt de ces obligations pouvait être supérieur à 10%). Quand les taux d’intérêt des obligations baissent, il faut comprendre que les assureurs investissent dans des obligations avec des taux d’intérêt de plus en plus faibles. Quand les taux remontent, l’assureur se retrouve avec des moins-value sur les obligations qu’il a puisqu’il les a achetées avec des taux d’intérêt plus faible que les taux actuels. C’est un problème pour lui parce que si les assurés décident de rompre leur contrat d’assurance, l’assureur devra revendre ses obligations pour rembourser les assurés, mais il devra les revendre en moins-value à cause des faibles taux d’intérêt de ses obligations. L’assureur, face à la montée des risques, réduit sa part de risque en en transférant une partie sur les assurés, et se retranche derrière des activités de gestion.
Les réassureurs sont méfiants à l’idée que l’Etat puisse leur prendre des parts de marché, comprenez-ici que l’Etat indemnise des risques qui seraient assurables. Pour les réassureurs, l’Etat doit rester sur la partie tendancielle du déréglement climatique, en épongeant des pertes certaines compte tenu des changements climatiques. Les réassureurs, quant à eux, doivent se positionner sur la partie aléatoire. Le risque doit rester assurable donc aléatoire, c’est-à-dire qu’il faudrait faire attention à ce que l’agriculteur se responsabilise et que l’assurance ne crée pas le risque. Au Maroc, par exemple, l’assurance s’est développée et certains agriculteurs ont commencé à semer des céréales sur des zones de colline. Même si l’exemple présenté ici est assez caricatural, des cas similaires existent en France avec des maïs grains semés en zone inondable. Pour rémunérer leur capital investi, les réassureurs ont besoin d’une tarification adaptée, d’une sélection des risques (et donc de responsabiliser les agriculteurs), et d’une visibilité sur le long terme.
Peut-on assurer autre chose qu’un risque climatique ?
Le déréglement climatique est en cours ; c’est un état de fait, et l’espèce humaine en est responsable. Les risques climatiques vont grandissant. Ne serait-il pas temps de voir l’assurance sous un autre prisme ? En d’autres termes, au lieu d’assurer un risque climatique qui, comme nous en avons largement discuté, sera bientôt non assurable, ne vaudrait-il pas mieux assurer autre chose ? Assurer par exemple la transition d’un agriculteur vers des pratiques plus résilientes face au déréglement climatiques ? Sur cette question ouverte, les interviewés ne sont clairement pas tous sur la même longueur d’onde.
Une première réponse est que nous aurons toujours besoin de manger. Suite au déréglement climatique, il existera (et il existe déjà) de nombreuses zones où il ne sera peut-être plus pertinent de faire de l’agriculture, pour des raisons économiques ou tout autre. Le déréglement ouvrira peut-être aussi de nouvelles zones actuellement non cultivables (le GIEC est d’ailleurs très clair sur le fait que l’adaptation au déréglement climatique se fera également en profitant également des bénéfices apportés par le déréglement climatique). Dans certains autres endroits, la prime d’assurance augmentera certainement mais il est à penser que les risques climatiques seront toujours assurables.
Pour certains assureurs, tarifer un risque de transition, ça reste quelque chose de costaud. Pour évaluer un risque, il faut trouver un rendement de référence, avoir accès à un historique (la culture va être sensible différemment aux aléas et donc il faut avoir des statistiques longues pour savoir combien de fois l’assurance serait intervenue), et comprendre l’impact que peuvent avoir ces pratiques sur le rendement ou sur la résilience de l’agriculteur. Dans le cas où il n’y a pas d’historique, l’assureur a le droit de dire en quelque sorte que le bien n’est pas géré en « bon père de famille » et sera ainsi en droit de refuser d’assurer. Il y a des cas où les assureurs assurent volontairement, d’autres où ils le font par défaut et encore d’autres cas où ils ne prendront pas le risque de le faire. Si la production est plus résiliente au déréglement climatique, ça doit être reflété dans la prime, mais il ne semble pas que les systèmes de tarification soient aussi évolués que ça.
L’assurance actuelle ne fait pas d’investissement (ne prend pas des risques d’investissement) ou des risques de non performance d’une activité. L’assurance assure un dommage. Et un dommage lié à des causes extérieures, qu’elles soient climatiques ou pas. Dans le cas d’une transition agricole, si le risque de non-performance de la transition est lié directement à l’agriculteur, les assureurs considèrent qu’elle n’est pas assurable en ce sens qu’il y aurait trop d’aléas non extérieurs (compétences techniques, volonté ou encore santé de l’agriculteur). Pour que l’assurance fonctionne, le risque doit avoir une dimension aléatoire. Ce risque ne doit pas être systématique ni trop dépendre du comportement de l’agriculteur. Pour ces causes internes, l’agriculteur devrait se tourner vers l’investissement plutôt que vers l’assurance. Plus précisément sur les changements de pratiques, certains interviewés considèrent que l’agriculteur trouvera un moyen de se rémunérer, par exemple via la PAC (avec les futurs éco-schémas) ou avec des systèmes volontaires (le label bas carbone – je vous invite ici à revoir un autre de mes articles de blog sur le carbone). Les systèmes existants devraient donc permettre de rémunérer les agriculteurs qui ont changé leurs pratiques. Cette rémunération n’est pas vue ici comme une façon de supporter le risque de perte de rendement associé à une transition, mais plutôt d’appuyer l’investissement sur du matériel et des pratiques. Pour une transition en bio par exemple, les assureurs auront tendance à considérer que le risque de voir la production baisser est quasi certain dans les premières années. D’où l’existence d’aides à la conversion et au maintien de l’agriculture bio (l’aide au maintien a été supprimée une fois qu’il était considéré que le marché était suffisamment matur). Et de rajouter que l’agriculteur qui met en place une autre pratique peut être aussi soumis à un risque supplémentaire. En appliquant moins de traitement, un agriculteur bio sera peut-être plus sensible à certaines agressions extérieures lors d’une sécheresse ou d’un gel. De manière générale, les assureurs semblent avoir du mal à établir ce qu’une telle assurance de transition couvrirait réellement.
Certains assureurs considèrent au contraire qu’il est possible d’établir des profils de risque avant, pendant, et après des phases de transition (bio, agriculture de conservation, réduction de doses…). Le principal problème n’étant pas dans la modélisation du risque (donc l’assurabilité) mais plutôt dans le fait qu’il faudra suffisamment d’agriculteurs engagés pour que la filière se mobilise (fournisseurs, distributeurs…).
A terme, il est possible que l’assurance ne rapporte plus grand-chose aux assureurs et qu’il soit nécessaire d’en faire évoluer les concepts. Il faudrait en effet des dispositifs de sécurisation ou d’adaptation au changement climatique plutôt que de subventionner l’assurance. En assurant un risque de transition vers une nouvelle culture ou une nouvelle pratique agricole (agriculture de conservation des sols, transition vers le bio…), l’assureur y perd à l’instant « t » s’il ne raisonne que sur la culture qu’il vient d’assurer parce que l’agriculteur manque forcément de compétences, et n’a pas toujours les bonnes références. Mais est-ce vraiment sur le temps court qu’il faut raisonner ? Aujourd’hui, l’assurance dommages aux biens est annuelle dans la majorité des cas. Comme une transition agricole s’envisage sur plusieurs années, la donne change. En créant une relation de partenariat avec son assuré sur du temps long, l’assureur peut partir du principe que la filière va faire évoluer ses pratiques, revenir sur un niveau de rendement très acceptable, et être beaucoup plus résiliente face au déréglement climatique grâce à son évolution de pratiques. Le principe étant de ne pas voir la culture toute seule mais de la voir au cœur d’un système beaucoup plus systémique. De manière générale, la question à 100 francs est de savoir si l’évolution des pratiques peut contrebalancer les effets du déréglement climatique et rendre viable une activité d’assurance dans le secteur agricole.
Pour s’engager dans une transition, il est aussi fondamental de faire en sorte d’assurer la parité de risque entre des nouvelles pratiques – agroécologiques ou autres – et les pratiques conventionnelles. Parce qu’elles manquent de références de rendement et d’historicité, les pratiques dites « non conventionnelles » ne sont pas encore suffisamment intéressantes d’un point de vue assurantiel pour les agriculteurs, soit parce que le niveau de rendement assuré est trop faible (l’assurance ne couvre vraiment pas grand-chose ou alors il faut vraiment payer cher pour être couvert), soit parce que les offres sont trop peu nombreuses. Les assurances traditionnelles pénalisent donc en quelque sorte, directement ou indirectement, ces pratiques-là. Peut-être faudrait-il qu’une partie du fonds de solidarité ou du futur dispositif soit dédié à l’accompagnement des transitions et nouvelles pratiques. Il pourrait également être confié à ce dispositif une mission d’accompagnement à la prise de risque dans les investissements de transition agro-écologique : en amorçage de marché dans des situations où les assureurs ne disposeraient d’aucune référence leur permettant de tarifer des produits, par exemple lors d’investissements dans de nouvelles cultures sur des terres où elles ne sont plus produites depuis un trop grand nombre d’années. La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pourrait garantir une réassurance au-delà d’un seuil de dégradation du taux de sinistres à primes permettant aux assureurs de proposer des produits rendant la prise de risques possible.
Là où les assureurs pourraient jouer un rôle intéressant, c’est de donner une prime plus intéressante aux agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses, en mettant en place un système d’incitation, par exemple pour les agriculteurs qui suivent des cahiers des charges précis (HVE, Bio, Semences non enrobées, Mise en place d’infrastructures ou de moyens de préventions…) – encore faut-il que ces cahiers des charges soient suffisamment explicites et à disposition. Pourrait-on mettre en place une assurance glyphosate pour les agriculteurs qui s’en passent ? Certains investisseurs demandent par exemple à des assureurs à ce que des parcelles assurées ne soient par exemple pas issues de la déforestation. C’est donc toute la logique de l’assurance qu’il faudrait changer pour en faire un véritable outil d’incitation – en couvrant mieux des démarches innovantes que des démarches classiques. Ca n’est visiblement pas trop la logique des assureurs actuels, qui préféreront se sécuriser en premier lieu. Si, dans les futures missions de l’assurance, c’étaient à la fois la promotion du dispositif et la prise en compte de nouvelles pratiques qui étaient mises en avant, la mise en œuvre de nouvelles pratiques pourrait être sécurisée. Autrement, il est fort possible que tout le monde se renvoie la balle, les assureurs reprochant aux pouvoirs publics de ne pas prendre leur responsabilité et inversement. C’est peut-être également le type de transition auquel il faut s’intéresser. Pour un agriculteur qui va transitionner vers une agriculture plus résiliente au sens d’une moins grande production de gaz à effet de serre, la collectivité peut par exemple y trouver tout son intérêt, mais ce n’est pas nécessairement pour autant que cette transition va changer le risque climatique d’un agriculteur.
On entend même parler d’assurer le carbone dans le sens où des changements de pratiques induisent la génération de crédits carbone (je vous renvoie ici vers un autre dossier carbone sur mon blog). Imaginons une forêt que j’exploite tous les ans. Si j’arrête de la couper, je génère potentiellement des crédits carbone ; le pari étant que je vais générer un revenu par les crédits carbone de la pousse des arbres au lieu de l’exploitation de la filière bois. La question importante est de se demander ce qui est en fait réellement assuré si ma forêt brule. Est-ce le coût de remise en état pour regénérer le biotope ? Ou alors le coût du crédit carbone ?
Innovation et culture du risque
Un manque de culture du risque de la filière agricole
Le monde a changé. Celui qui se croyait épargné du fait de sa localisation géographique est aujourd’hui frappé. La résilience des exploitations agricoles nécessite une maîtrise du risque sur le revenu des agriculteurs, non seulement en termes de volatilité mais aussi de seuils de perte relatifs à des niveaux de consommation. La maîtrise des risques apporte à l’agriculteur la confiance nécessaire (moins de charge mentale et de stress) pour développer sa capacité d’investissement dans des actifs classiques (matériel, bâtiments, cheptel) ou des actifs de création de valeur pour le consommateur (conversion bio, circuits courts, …) car les prêts bancaires sont garantis, outre les garanties classiques et souvent partielles, par une stabilité pluriannuelle du résultat de l’exploitation. L’assurance climatique apporte ainsi la garantie d’une stabilité financière annuelle de l’exploitation agricole en ce sens qu’elle permet de lisser les résultats d’exploitation sur plusieurs années. Elle permet de ne pas bloquer le capital de l’agriculteur – qu’il aurait gardé pour s’auto-assurer, et d’utiliser ce capital pour investir (dans des pratiques résilientes par exemple). On peut également considérer que l’assurance n’est pas une approche centrée sur l’analyse des risques globaux mais aussi un élément qui apporte une proposition élargie, en voyant l’assurance en terme d’une composante d’un package plus large en lien par exemple avec une offre de financement. On pourrait prendre par exemple le cas d’un constructeur de machine à vendanger qui aimerait intégrer dans le prix de sa machine un bout de contrat indiciel pour que, en cas de mauvaise récolte, l’agriculteur reçoive un petit capital parce que la machine est moins amortie. Il y aurait ici un lien entre l’usage du bien et l’évènement climatique. Comme nous l’avons discuté, l’assurance n’est qu’une seule des nombreuses stratégies de gestion du risque. Entre les leviers techniques, agronomiques, financiers et stratégiques, l’agriculteur dispose de nombreux moyens pour augmenter sa résilience face au déréglement climatique.
Le concept de gestion de risques est encore trop peu considéré dans les formations à caractère agricole. Au vu du dérèglement climatique en cours, on pourrait s’en surprendre. Il est pourtant fondamental que les contenus des formations initiale et continue évoluent dans le sens d’une transmission de connaissances mais aussi d’une plus forte sensibilisation aux enjeux des risques en agriculture. L’assurance est encore actuellement trop considérée dans une approche transactionnelle où les assurés désirent que leur assurance soit rentable, alors que ce n’est pas ce pour quoi l’assurance a été mise en place. Les agriculteurs devraient voir les assurances comme des outils financiers plutôt que comme de vrais outils de protection de leur rendement et revenu de l’année. Les réseaux de conseil doivent également se développer pour accompagner les stratégies d’entreprise agricole et de gestion des risques pour les chefs d’exploitation. On observe par exemple qu’actuellement, la majorité des contrats d’assurances multi-risques sont à l’échelle de la culture, alors que des contrats à l’échelle de l’exploitation existent. Dans un contexte de recherche de résilience, n’y a-t-il pas plus de sens à considérer l’ensemble des cultures en même temps et de n’assurer que les coups durs ? Les agriculteurs doivent avoir les moyens de se projeter dans des scénarios agro-pédo-climatiques à 20 ans dans leur localité, de façon pédagogique et pratique, pour évaluer les risques auxquels ils sont (seront) soumis et d’imaginer les façons de s’y adapter. Les agriculteurs doivent apprendre à cartographier leurs risques, les analyser, et les maitriser voire en transférer une partie (vers les assurances par exemple). Les exercices de prospective trouveront ici tout leur intérêt.
C’est une véritable culture du risque que les agriculteurs doivent développer. En étant un brin provocateur, on peut se demander aussi si le fait de subventionner l’assurance ne pousse pas les agriculteurs à s’enfermer dans leur subvention et à ne pas prendre de risques. N’est-ce pas le propre du chef d’exploitation de prendre des risques, même si l’on sait que les débuts d’une phase de transition seront de toute façon difficiles ? Certains agriculteurs sont bien évidemment dans des situations économiques catastrophiques, et il est nécessaire que des dispositifs existent pour les accompagner, mais il faut garder en tête également que, pour l’adaptation aux risques, il en relève aussi de la responsabilité d’action de chaque agriculteur.
Un rôle partagé des acteurs de la filière agricole dans l’assurance
L’assurance n’est pas que du ressort de l’agriculteur. L’ensemble de l’écosystème gravitant autour de lui peut avoir un rôle à jouer. Une réflexion globale de l’assurance entre toutes les parties prenantes peut être bénéficiaire pour l’ensemble des acteurs :
- Pour l’assureur, c’est l’occasion de s’appuyer sur des services existants autres que l’assurance pour accroître la sensibilisation et la pénétration des contrats, pour compenser le manque de personnel et de canaux de distribution propres sur les marchés ruraux, pour utiliser l’image positive d’un partenaire et obtenir des clients qu’ils essayent l’offre d’assurance, pour réduire les coûts de distribution, ou encore pour réduire les phénomènes d’anti-sélection.
- Pour les coopératives, équipementiers et autres distributeurs, c’est l’occasion d’utiliser l’assurance pour la promotion des ventes d’intrants agricoles et pour se différencier de ses concurrents, pour augmenter la fidélisation vis-à-vis d’un produit, ou encore pour générer un flux de revenus supplémentaires en termes d’incitations fournies par l’assureur. La coopérative peut ne pas considérer l’activité de l’assurance comme une activité lucrative et l’utiliser comme un moyen de maintenir ou d’accroître sa part de marché, une raison supplémentaire de proposer des primes d’assurance plus intéressantes aux exploitants. Des semenciers et coopératives peuvent vendre des semences avec une assurance contre un risque de sécheresse qui ferait que la semence ne lèverait pas. Le service ressemblerait à un « satisfait ou remboursé » avec, si la semence ne pousse pas, un remplacement de cette semence pour l’agriculteur. On peut également imaginer des offres en carence d’approvisionnement pour garantir à un utilisateur (une coopérative ou une filière plus spécifique) un niveau de volume et/ou de qualité pour son sourcing.
- Pour l’agriculteur, c’est l’occasion de réduire les coûts de transaction de l’assurance en ne négociant qu’avec une seule entité plutôt que deux s’il passe par exemple par sa coopérative, d’avoir un accès plus facile au crédit et à de meilleurs intrants agricoles, d’avoir un allègement du remboursement du prêt et accès à un autre prêt pour la saison suivante, ou encore une facilité de paiement de la prime si le prestataire de services groupés préfinance ou subventionne la prime
J’en profite pour rappeler encore une fois que les acteurs de la filière agricole disposent d’autres moyens que l’assurance pour accompagner les agriculteurs dans la gestion des risques.
Un manque de compétences et d’innovation des assureurs
Si les chefs d’exploitation agricole manquent d’une véritable culture du risque, on pourrait reprocher aux assureurs d’être relativement peu innovants en termes de proposition d’offres assurantielles. On peut comprendre qu’avec des ratios de sinistres à primes en dessous du point d’équilibre, les leaders du marché se positionnent sur une posture défensive et ne fassent pas trop évoluer leurs offres. Les offres standards pourraient pourtant évoluer vers des offres plus fines, tout comme les parcours clients. Un maïsiculteur des landes sur une centaine d’hectares ne fait en réalité pas qu’un seul type de maïs, mais peut-être bien du maïs semence ou encore du maïs popcorn, autant de cultures différentes qui appellent des profils de risques différents. De la même façon, comme nous en avons parlé, les assurances MRC traditionnelles se concentrent sur des assurances de rendement. Des offres autres, déjà utilisées dans certains pays – assurances marge ou assurances chiffres d’affaires – pourraient être testées.
Il y a également un pas important à franchir des assureurs agricoles pour numériser leur process. Certains assureurs ne sont pas encore prêts, d’un point de vue système d’informations, à gérer des entités géométriques comme des parcelles, ce qui sera de toutes les manières un frein au déploiement des services d’assurance indicielle. Avec des systèmes d’information au code postal, impossible de pouvoir gérer finement des caractéristiques spatiales de parcelles ou encore d’exploitations. Le déploiement des offres indicielles, par la construction d’indices multi-sources (végétation, météo…) nécessite généralement une modélisation mathématique, une manipulation des données et une expertise en matière de simulation des cultures, autant de compétences différentes que les assureurs n’ont pas nécessairement internalisées. Ces compétences ont d’ailleurs parfois été plutôt récupérées par des ré-assureurs qui travaillent sur des portefeuilles de clients à risques et très diversifiés, pour ensuite faire redescendre les offres dans les réseaux des opérateurs assurantiels classiques.
La mise à disposition de données aux experts sur le terrain est également rendue difficile par le fait que plusieurs assureurs n’en sont pas encore au stade d’équiper leurs experts avec des outils numériques. Un assureur pourra certes sous-traiter l’expertise à des sociétés spécialisées, encore faudra-il avoir des systèmes d’information connectés entre eux.
En guise de conclusion
Le déréglement climatique causé par l’espèce humaine a de quoi faire frémir les assureurs et les réassureurs. Les évènements climatiques sont de plus en plus fréquents et incertains, et le coût de la sinistralité ne fait qu’augmenter. Dans le secteur agricole, les conséquences de ce déréglement se font déjà ressentir et pourraient s’avérer dramatiques dans les années à venir, pour les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de la population qui aura toujours besoin de manger. Rajoutons à cela des tensions géopolitiques qui augmentent considérablement la pression sur les denrées alimentaires – certains acteurs annoncent de futures pénuries alimentaires en Afrique du Nord suite au conflit russo-ukrainien, et la sécurité alimentaire ne sera plus garantie.
Il semble malgré tout y avoir une prise de conscience collective que l’agriculture doit opérer sa transition et que la question de la résilience est fondamentale. Néanmoins, en période de transition, un agriculteur est fragile. Pour pouvoir s’engager dans des voies de transition et avoir la volonté d’investir, il faut avoir confiance et se sentir protégé. En France, la réforme en place entend s’attaquer aux limites de l’assurance agricole actuelle et a la volonté de démultiplier le nombre d’agriculteurs assurés, et ce toutes filières confondues. Les formats d’assurances sont extrêmement nombreux – entre la diversité des risques couverts, le choix des franchises et des garanties, ou encore les formats d’assurance indemnitaire ou indiciel, il ne semble y avoir que l’embarras du choix.
L’assurance a été créée historiquement pour permettre le commerce en méditerranée parce qu’il y avait une garantie qu’en cas de naufrage du navire, le commerçant n’ait pas à supporter tout seul la perte des marchandises. La transition nécessite une prise de risque et l’assurance est un des leviers pour s’en protéger. Mais peut-être est-il temps de réfléchir l’assurance autrement. Y-at-il encore du sens à assurer directement un risque climatique ? Ne vaudrait-il pas mieux au contraire assurer une transition agricole plus résilience face aux évènements climatiques pour éviter de repousser une énième fois le problème ?
Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur TipeeeBibliographie complémentaire aux entretiens
Aon (2021). Weather, Climate and Catastrophe Insight : https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
Benami, E., Carter, M.R. (2020). Can digital technologies reshape rural microfinance ? Implications for savings, credit, & insurance. Agricultural & Applied Economics Association
Bouton (2017). Solutions indicielles de protection du revenu agricole – Modélisation et Tarification. Mémoire d’actuariat, ISFA.
CCR & Météo France (2018). Conséquences du changement climatique du le cout des catastrophes naturelles en France à horizon 2050.
Clement, K.Y., Botzen, W.J.W, Brouwer, R., Aerts, J.C.J.H (2018). A global review of the impact of basis risk on the functioning of and demand for index insurance
Confédération Internationale du Crédit Agricole (2020). Une contribution aux objectifs de développement durable. Pour une agriculture plus résilience et mieux protégée face aux aléas climatiques. Livre blanc sur l’assurance agricole.
Descrozailles, F. (2021). Rapport sur la gestion des risque en agriculture.
ENESA (2018). 40 ans de Système d’Assurances Agricoles. Entité Gouvernementale d’Assurances Agricoles. O. A. (ENESA)
France Assureurs (2016). Quel impact sur l’assurance contre les aléas naturels à l’horizon 2040 ? Synthèse de l’étude changement climatique et assurance.
France Assureurs (2021). Quel impact sur l’assurance contre les aléas naturels à l’horizon 2050 ? Synthèse de l’étude changement climatique et assurance.
GIEC (2021). Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
GIEC (2022). Climate Change 2022. Impact, Adaptation et Vulnerability. Summary for Policymakers. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Haut Conseil pour le Climat (2021). Renforcer l’atténuation, Engager l’adaptation. La version grand public. Un résumé du troisième rapport annuel du Haut conseil pour le climat.
Lepoivre, B. (2020). L’assurance des prairies. Fourrages, 244, 87-92
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (2021). L’assurance multirisque des récoltes
Mortensen, E. & Block, P. (2018). ENSO Index-Based Insurance for Agricultural Protection in Southern Peru. Geosciences, vol 8 – 64.
Johnson, L. (2021). Paying ex gratia : Parametric insurance after calculative devices fail. Geoforum, 125
Schuster, C.E. (2020). Weedy Finance : Weather insurance and Parametric Life on Unstable Grounds. Cultural Anthropology, 36:4.
Shift Project (2021). Rapport sur la stratégie de résilience des territoires. Volume 1, Comprendre.
Xiong, H., Dalhaus, T., Wang, P., & Huang, J. (2020). Blockchain Technology for Agriculture : Applications and Rationale. Frontiers in Blockchain, vol 3.
Personnes Interviewées
| Nom | Structure |
| Philippe ALBERTINI | ProBTP |
| Luc BOUCHER | DiagoRisk |
| Nicolas CHATELAIN | Partner Re et APREF |
| Timothée CRAIG | Exo Expert |
| Frédéric DESCROZAILLES | Assemblée Nationale |
| Jean-Marie DETERRE | Axa |
| Henri DOUCHE | SCOR |
| Bernard FINAS | Jola |
| Bruno LATOURRETTE | SCOR |
| Olivier LELIEVRE | Expert Indépendant |
| Jérôme LEROY | Weenat |
| Bruno LEPOIVRE | Crédit Agricole |
| Charles MAURY | Climate Insurance |
| Jean-Baptiste ORNON | Axa Climate |
| Antoine POUPART | Invivo |
| Aymeric ROUCHER | Descartes Underwriting |
| Antoine ROUMIGUIE | Airbus |
| Cécile TARTARIN | Geosys |
| Pascal VINE | Groupama |
| Ewan WHEELER | Acre Africa |

2 commentaires sur « L’assurance climatique agricole en pleine réforme »